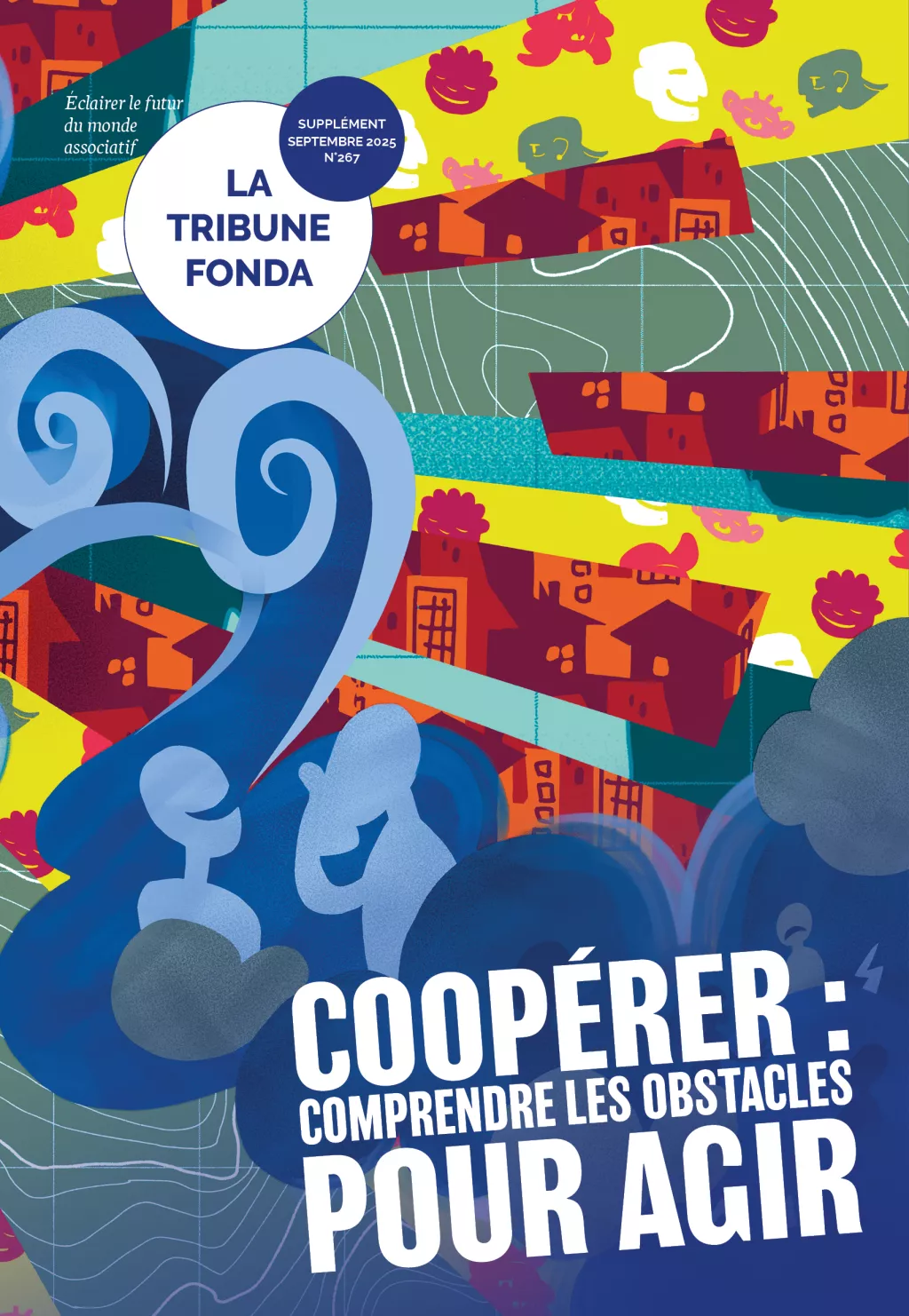Coopération, collaboration, collectifs, alliances, coordination, co-construction : derrière le florilège des vocables utilisés et la palette des nuances, on voit émerger l’intuition qu’aucun sujet ne pourra être abordé de manière isolée ou linéaire.
Dès lors se pose la question de faire ensemble, en portant notre attention sur la nature et les modalités de nos interactions et non plus seulement sur la multiplication des initiatives individuelles, fussent-elles de grande qualité.
Agir en système
Dans cet esprit, un groupe de fondations, d’associations et d’acteurs académiques a lancé en 2021 l’initiative collective « Agir à la racine », créant les conditions d’un cheminement collectif sur la manière de pratiquer une philanthropie systémique et de faire évoluer les rapports entre associations et fondations1, afin d’apporter une réponse durable et profonde aux problèmes rencontrés.
Cette expérience et les échanges avec les associations ont abouti à la formulation d’un « Appel pour une transformation des pratiques philanthropiques »2 qui invite à repenser nos modalités de coopération et à agir en système.
Agir en système, c’est reconnaître que chacune des parties prenantes joue un rôle dans les dynamiques à l’œuvre, et ne saurait s’en abstraire.
Les parties prenantes peuvent être des personnes concernées, associations, fondations, entreprises, institutions publiques ou acteurs de la recherche.
La résolution de problèmes complexes doit nous inciter à travailler collectivement en pluridisciplinarité, à croiser différents points de vue, à favoriser la diversité des acteurs autour de la table. Par exemple, des constructions collectives, parfois déroutantes parce qu’elles n’entrent dans aucune case, s’avèrent transformatives sur des enjeux aussi complexes que le chômage, la pauvreté, le logement, le climat, etc.
Pour émerger, ces initiatives ont besoin de financeurs capables de se décentrer suffisamment pour accepter de faire confiance au processus, faire preuve de patience quant aux résultats, et reconnaître l’utilité de créer des résonances, des ponts, des solidarités parmi les acteurs de l’intérêt général.
Susciter les interactions et nourrir des alliances est au cœur de ce que peuvent produire les fondations, entre elles, avec les associations, avec les pouvoirs publics, avec les entreprises. Cela nécessite du temps, des savoir-faire et des financements pour la coordination, l’ingénierie, la réflexion et le travail en commun.
Financements, impact, confiance : les trois dimensions d’un changement de regard
Le cadre de coopération au sein de l’écosystème philanthropique a besoin d’une révision profonde et coconstruite pour permettre aux initiatives d’intérêt général d’exprimer pleinement leur potentiel, tout en assurant la santé des organisations et de leurs équipes.
Cela suppose de porter un regard nouveau sur au moins trois sujets : les modalités de financement, l’exigence d’impact et la question de la confiance.
De manière paradoxale, moins l’environnement devient prévisible, plus l’engagement sur le temps long est nécessaire. Le morcellement des financements, la réduction des subventions publiques, les processus d’attribution sélectifs et compliqués mettent en péril la stabilité des associations et de leurs équipes, mais aussi l’émergence de nouvelles initiatives. Sans des soutiens financiers adéquats de long terme, les objectifs de transformation, de coopération et de transition sont hors d’atteinte.
La philanthropie peut travailler à la mise en place de modèles de financement qui garantissent des soutiens pluriannuels, structurels, à la fois robustes et flexibles, capables de répondre aux besoins des associations et de soutenir des expérimentations sur le long terme — indépendamment du temps politique, économique ou financier.
Faire évoluer le cadre de coopération nécessite par ailleurs de prendre du recul sur l’exigence d’impact pour s’accorder sur ce qui a de la valeur.
Fondations, associations, personnes concernées peuvent travailler ensemble à définir ce qui compte, ce qui est pertinent, ce qui a été créé de dif- férent et comment l’apprécier depuis la sélection jusqu’au suivi des projets.
S’agissant d’évaluation, la restitution qualitative de l’action et de ses effets, la rencontre et l’échange, ainsi que l’analyse des résultats obtenus par la recherche en sciences sociales sont également riches d’enseignements vivants et à même d’être partagés avec le plus grand nombre.
Enfin la coopération restera un vœu pieux sans l’instauration d’un climat de confiance.
En effet, la confiance constitue une condition nécessaire à l’émergence d’une pratique qui privilégie l’expérimentation et les apprentissages, la coexistence de points de vue différents et in fine la capacité à intégrer l’incertitude.
Toutefois la confiance ne se décrète pas plus que la coopération.
L’observation de diverses pratiques philanthropiques nous montre qu’elle nécessite tout d’abord de faire évoluer les représentations, pour mieux se comprendre et se connaître.
Les rencontres sur le terrain, la mixité des profils au sein des fondations et des associations, la participation des premiers concernés aux décisions programmatiques, l’implication des philanthropes et des collaborateurs des entreprises mécènes dans des actions concrètes contribuent à favoriser ce changement de regard.
Fondations et associations peuvent se considérer comme de véritables partenaires, en rendant explicites leurs besoins et contraintes respectifs, et en reconnaissant la complémentarité de leurs ressources : capacité à créer de la soutenabilité économique d’une part, professionnalisme et expertise terrain d’autre part.
Coopération et dialogue, leviers d’un apprentissage collectif
Depuis quatre ans, Racines s’attache à incarner et promouvoir un espace sécurisé dans lequel il est possible d’expérimenter et relier les pratiques de coopération, que ce soit ensemble ou à travers les actions de ses membres : le programme Inventer demain de la Fondation de France3, les soutiens aux collectifs apportés par la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale, la Réponse collective de la Fondation Entreprendre4 ou encore le projet Act’Ice soutenu conjointement par la Fondation de France, le Chant des Étoiles et Entreprendre &+…
Ces expériences ont été repartagées à travers les webinaires5 ou le parcours de formation conçu pour accompagner des professionnels de la philanthropie sur ce chemin.
En matière de systémie et de coopération, il convient de reconnaître que les approches sont multiples : il n’existe pas de formule magique, mais plutôt une diversité d’expérimentations dont on peut s’inspirer et dont on peut apprendre.
En privilégiant le questionnement au contrôle, la philanthropie systémique cherche à développer de nouvelles formes de coopération en faisant évoluer sa propre posture.
Avec une approche plus flexible et plus ouverte, dans un dialogue de pair-à-pair, les fondations peuvent contribuer à devenir de véritables moteurs de transformation de nos sociétés. C’est pourquoi Racines développe aujourd’hui une cartographie qui permet de mieux identifier les possibilités de coopération au sein du secteur, crée un centre de ressources pour les acteurs de l’intérêt général qui souhaitent adopter une approche systémique et s’ouvre à une plus grande diversité d’acteurs dans une logique de mouvement.
- 1
Voir la Tribune Fonda n°257 « Associations et fondations face aux changements systémiques », mars 2023.
- 2
En 2025, l’Appel de Racines a déjà recueilli près de 300 signatures. Il est toujours possible de le signer sur le site de l’initiative collective agiralaracine.fr.
- 3
Lire à ce sujet « Acteurs clés de changement : coopérer pour inventer demain » dans ce numéro.
- 4
Également dans ce numéro, le retour d’expérience d’Éric d’Engenières « Comment la Fondation Entreprendre raconte, transmet et valorise les apprentissages de ses démarches de coopération ».
- 5
Les rediffusions sont disponibles sur la chaîne Youtube « Initiative Racines ».