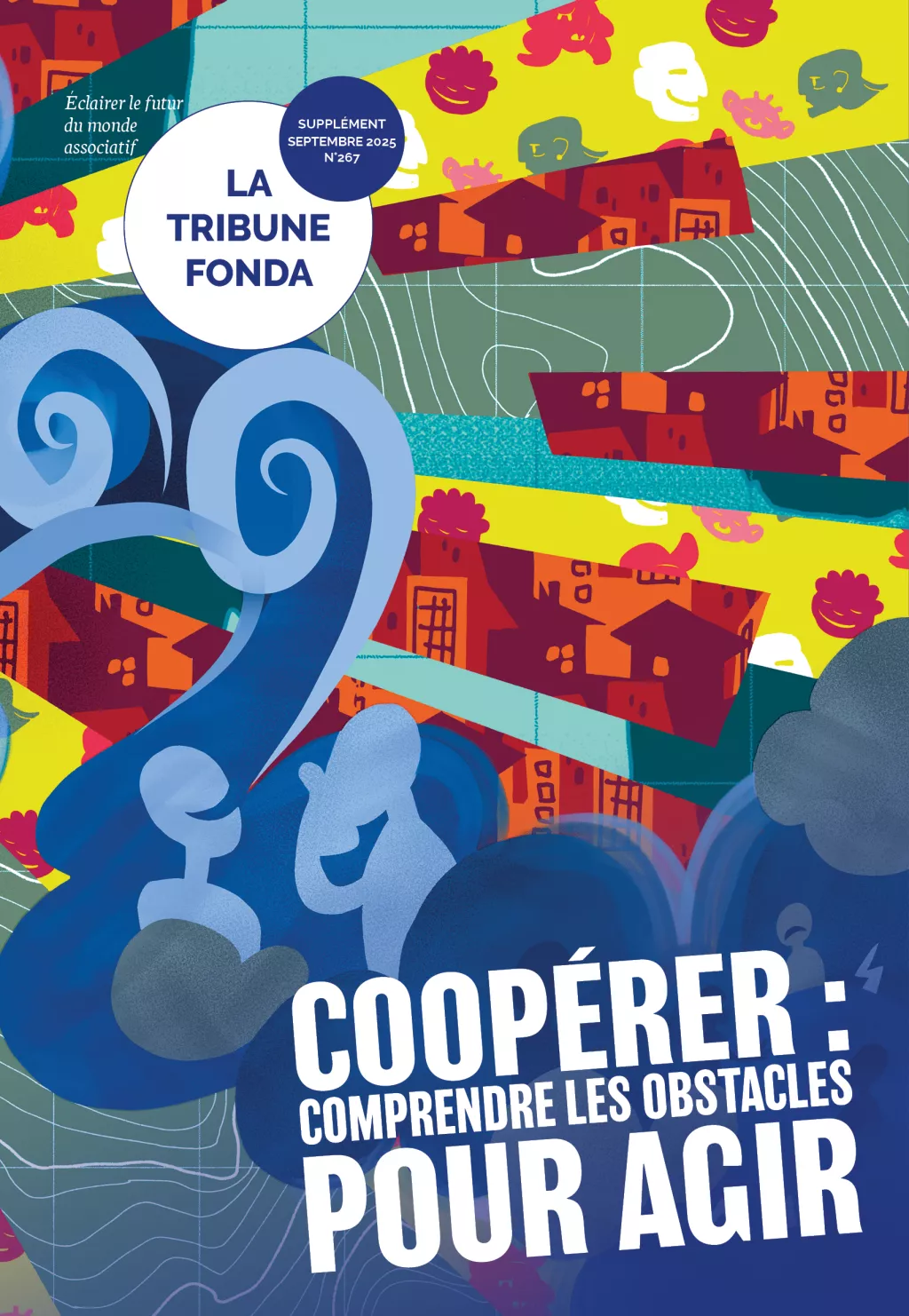Avec la Fondation de France et le Réseau national des Maisons des associations (RNMA), nous avions choisi de consacrer les Rencontres entre pairs du 2 juillet 2025 à ce qui freine le développement de la coopération, d’où le sous-titre « comprendre les obstacles pour agir ».
À la fin de cette journée, nous réalisons que c’est la coopération qui est en fait le remède à ce qui nous empêche aujourd’hui d’agir.
Individualisation, fragmentation, marchandisation et obsolescence des organisations
Le contexte des actions évoquées durant ces rencontres se caractérise par quatre tendances majeures. La première, la plus fondamentale d’un point de vue anthropologique, est l’individualisation de la société. Il ne s’agit pas d’individualisme, le besoin et le désir de vivre et d’agir ensemble sont toujours là, mais ils doivent respecter les attentes et les exigences de personnes attachées à leur singularité.
La deuxième tendance est la fragmentation de la société1. Cette société d’individus se reconfigure sur le plan des appartenances et des modes d’adhésion à des mouvements collectifs, mais aussi à travers des phénomènes d’exclusion, d’inégalité et de discrimination.
Là où l’individualisation suscite l’empathie, la fragmentation multiplie les situations de conflit.
La troisième tendance, ressentie profondément par les acteurs de l’intérêt général, notamment les associations, est le mouvement de la marchandisation. La financiarisation de l’économie tend vers la subordination à la logique marchande de toutes les activités de production de connaissances, de services, mais aussi de soins, d’entraide et d’assistance. Perçue comme une menace, cette tendance trouve tout de même rapidement ses limites, comme l’ont montré les scandales des Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Éhpad)2 et des crèches privées3.
Enfin, quatrième tendance relevée par plusieurs témoignages, c’est l’obsolescence des organisations. Les formes dominantes de l’entreprise, de l’administration et même de l’association, conçues pour être des outils de rationalisation et d’optimisation de l’action collective, sont désormais perçues par les acteurs comme des freins à l’action, qu’il s’agisse de l’excès de normes, du cloisonnement des compétences ou des labyrinthes de la décision.
La coopération comme remède
L’approche coopérative émerge comme une aspiration transversale à contrer ou surmonter ces tendances. Elle est d’abord une réaction spontanée, empathique, aux situations de crise ou de catastrophe.
Nos amis de Remontons la Roya nous ont raconté comment, au-delà de la catastrophe elle-même, les conditions de la reconstruction ont accompagné une volonté collective de renaissance des formes d’action coopérative ancrée dans la mémoire paysanne du territoire.
Le travail de la Fonda sur la société de l’engagement4 vient illustrer cette analyse. S’engager dans une société d’individus, c’est adopter une attitude volontaire pour rechercher des moments, des formes ou des situations dans lesquelles l’individu peut contribuer à l’action collective par sa coopération.
Trois scénarios pour 2040
À travers la diversité de ses formes, l’engagement transcende les formes organisationnelles, ce qui est à la fois un facteur de vitalité et de déstabilisation des organisations de l’action collective. On peut illustrer cette ambivalence par trois scénarios schématiques à horizon 2040.
Le scénario tendanciel, celui qui prolonge la tendance dominante observée aujourd’hui, est celui de l’extinction du politique.
Le déclin et l’obsolescence des organisations s’étendent aux institutions politiques et provoquent le recul de la démocratie dans le monde entier. Un quart de la population mondiale vit aujourd’hui en démocratie, contre la moitié il y a vingt ans5.
Si l’on entend par politique le jeu complexe d’institutions, de normes, de cadres de délibération, de règles du jeu écrites ou implicites, de débats, de confrontations et de rapports de force qui débouchent sur la structuration pacifique de l’action collective, c’est bien à sa disparition que nous assistons au profit du fait accompli, de la violence et de l’emprise religieuse ou quasi-religieuse.
Dans ce scénario, l’attitude coopérative manifeste la résilience des vaincus, des dominés et des invisibles. Elle est ce par quoi le collectif se réinstitue en silence.
Le scénario utopique est celui de la société des communs.
On imagine que la démarche, consistant à gérer des ressources, à partager des connaissances ou à prendre soin de la société et de ses membres, pourrait devenir le cadre commun des formes d’action collective. À partir de la volonté et des expériences de coopération menées à l’échelle des territoires, des communautés professionnelles ou des situations d’intérêt commun, se construirait progressivement, par un mouvement ascendant, une fédération des communs6.
Le troisième scénario consiste à tracer un chemin critique qui permettrait de faire entrer en résonance l’aspiration à la liberté et au pouvoir d’agir, les expériences coopératives et les formes institutionnelles de la renaissance démocratique : contrat public d’engagement réciproque permettant de déterminer les responsabilités coopératives, fondement juridique des chartes de coopération, apprentissage de la coopération au cœur du parcours éducatif, outils de suivi et de capitalisation des expériences coopératives.
- 1
Lire à ce sujet l’échange entre Marion Ducasse, Christine Duval et Laurence de Nervaux « Fragmentation sociale » lors de la deuxième journée d’étude organisée par la Fonda dans le cadre de l’exercice de prospective « Vers une société de l’engagement ? » le 20 novembre 2023.
- 2
On citera l’ouvrage du journaliste Victor Castanet, Les fossoyeurs, paru chez Fayard en 2022.
- 3
Également du journaliste Victor Castanet, Les ogres, paru chez Gallimard en 2024.
- 4
La Fonda, Vers une société de l’engagement ?, 2025.
- 5
Bruno Tertrais, La guerre des mondes, Éditions de l’Observatoire, 2023.
- 6
C’est la vision défendue par Pierre Dardot et Christian Laval dans Commun, essai sur la révolution au XXIe siècle, La découverte en 2014.