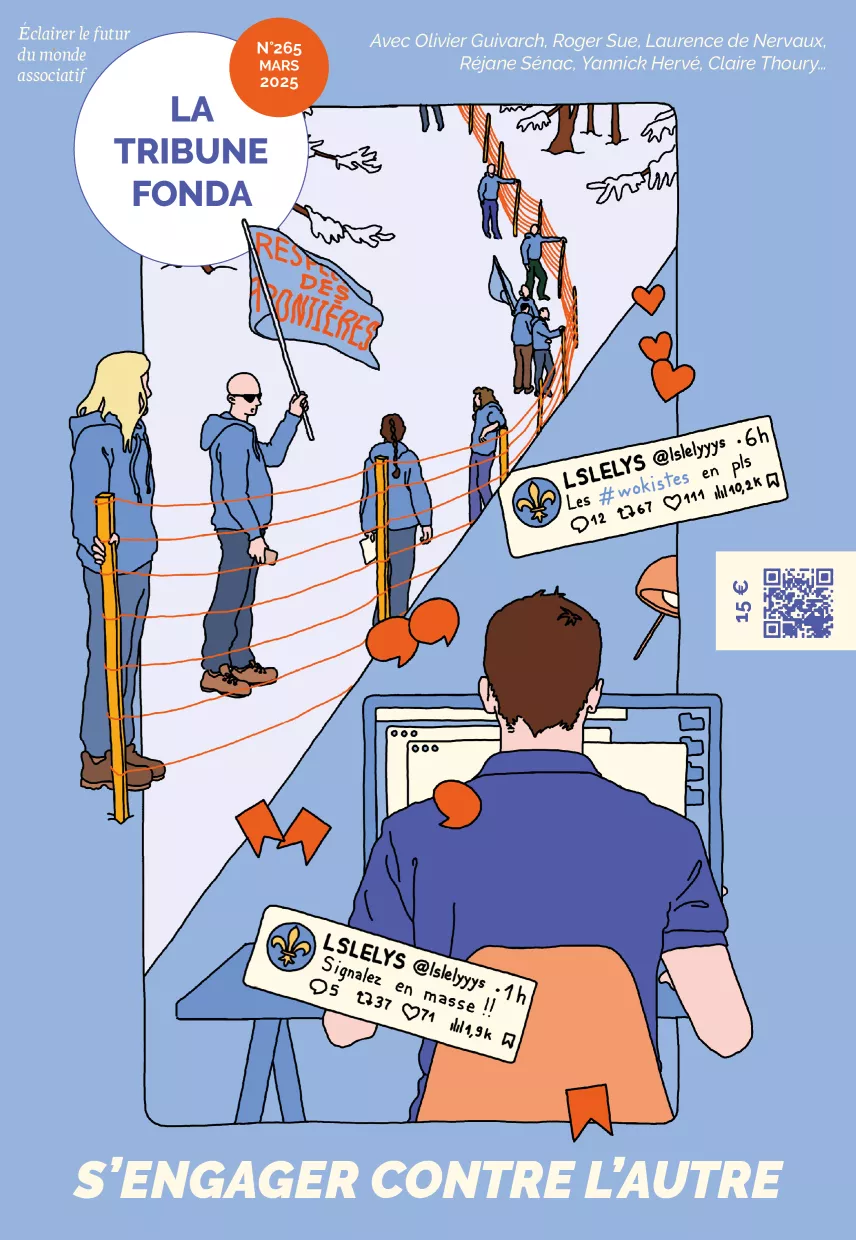Le rapport Vigie, éclairer les enjeux prospectifs
Futuribles International est l’acteur de référence des activités de prospective en France. Depuis 2006, nous publions un rapport bisannuel1 éclairant les enjeux prospectifs du moment, appelé rapport Vigie. L’édition de 2020 portait par exemple sur les ruptures géopolitiques à l’horizon 2050, quand celle de 2023 est intitulée Êtres humains, être humain en 2050.
Il s’agit d’une prospective anthropologique des sociétés occidentales à l’horizon 2040-2050. Sept champs de transformation sont étudiés : le vivant, les territoires de vie, la naissance et la mort, les interactions humains-machines, le genre, le savoir et le temps. Je souhaiterais traiter plus précisément dans ce texte du chapitre consacré aux savoirs et institutions, sous-titré « Qui croire ? Que croire ? ».
Une « constitution des savoirs » jusqu’au XXe siècle
Il existe une interaction étroite entre la façon dont fonctionnent les institutions et le rapport aux savoirs.
La façon dont la vérité est élaborée, admise, vérifiée et transmise dans la société est fondamentalement l’affaire des institutions, que cette vérité soit dogmatique, religieuse ou scientifique.
En Occident, les institutions publiques se sont construites à partir du XIIIe siècle grâce à des hiérarchies dans la production et la détention du savoir.
On peut considérer qu’il y a eu, entre le XVIIIe et le XXe siècle, une « constitution des savoirs », soit un système équilibré et régulé dans lequel les institutions de l’État exercent un contrôle et une tutelle sur la production du savoir, tout en laissant les producteurs de savoirs indépendants.
Les universités et établissements publics de l’État, qui garantissent la liberté de la recherche et de l’enseignement, en sont une illustration. Les sociétés contemporaines démocratiques se sont développées grâce à cette constitution des savoirs. Mais celle-ci a été progressivement fragilisée tout au long du XXe siècle par la massification de l’enseignement et le développement des médias de masse.
L’ère de la post-vérité au XXIe siècle
Dès la fin du XXe siècle, l’information et la connaissance ont changé de statut. Elles étaient jusqu’ici rares et longues à produire. Soigneusement conservées, l’information comme la connaissance étaient parcimonieusement diffusées à une élite.
Dans la civilisation numérique, elles deviennent toutes deux des flux illimités de données, accessibles instantanément. Cela aboutit à la désacralisation de la science et à la manipulation généralisée de l’information, autant par des amateurs que par des professionnels2.
Le sociologue Gérald Bronner parle de dérégulation de l’ensemble du système du savoir3.
Cette dérégulation est source d’instabilité et fragilise l’ensemble des institutions de diffusion, de contrôle et de transmission des savoirs, comme l’école et les médias. Une telle situation appelle à reformuler une éthique de la connaissance, que ce soit dans les modes de régulation de la diffusion de l’information4, comme dans la transmission de la connaissance5.
Scénarios prospectifs à horizon 2050
Dans le chapitre du rapport Vigie que j’ai corédigé avec Cécile Désaunay et Marie Ségur, nous avons exploré quatre hypothèses prospectives à horizon 2050.
Première hypothèse : en 2050, le savoir est devenu une industrie comme les autres. Les puissances économiques prennent un contrôle idéologique sur la production et la diffusion des informations. Avec leur logique de marché, elles se confrontent aux institutions publiques qui veulent réguler le monde de la connaissance, tandis que les autres font prévaloir des logiques de marché.
Deuxième hypothèse, les États reprennent le contrôle et la certification des savoirs. Toutes les opinions ne se valent pas. Ainsi, la vérité scientifique n’est pas une opinion parmi les autres sur des sujets comme l’efficacité d’un vaccin, l’histoire de la galaxie ou le réchauffement climatique. Au sein de la production scientifique, il est admis que la construction de la vérité n’est pas un processus linéaire. Plusieurs vérités légitimes peuvent cohabiter dans un premier temps, à condition qu’elles soient énoncées et exposées. Les controverses sur ces vérités font l’objet de régulation dans un second temps.
Notre troisième hypothèse est que les différentes zones géopolitiques s’opposent et promeuvent des vérités concurrentes. Elles cherchent à étendre leur influence en verrouillant les médias et les réseaux sociaux.
Il s’agit du scénario d’une guerre de tous contre tous, au-delà des affrontements militaires et économiques.
Des communautés numériques alternatives apparaissent pour chercher une vérité factuelle dans ce monde fragmenté. Une quatrième hypothèse est l’adoption d’une charte planétaire pour faire de la connaissance un bien commun.
Enjeux pour l’avenir
Cette exploration des futurs possibles met en lumière la déstabilisation en cours du rapport à la vérité. Elle doit conduire à s’interroger sur l’émergence de nouvelles formes de régulation dont l’école et l’intelligence artificielle (IA).
L’école est un enjeu clé pour l’avenir en matière de rapport au savoir. Les enfants et les adolescents sont confrontés à un flux de connaissances illimité. Face à cette situation, il est pour l’instant demandé à l’école de répondre à cette situation d’incertitude. C’est une charge qu’elle ne peut pourtant assumer seule. L’école doit au contraire apprendre aux jeunes à apprendre en construisant leur autonomie dans cet univers de savoirs.
Le développement de l’intelligence artificielle n’est par ailleurs que l’exploitation économique du flux de données et d’informations. Cela pose en des termes radicalement nouveaux la question de la régulation des savoirs, et donc plus généralement de l’architecture des institutions.
- 1Initialement annuel, le Rapport Vigie paraît tous les deux ans depuis 2014.
- 2
Dominique Cardon, « Pourquoi avons-nous si peur des fake news ? », AOC, 21 août 2019.
- 3
Gérald Bronner, Apocalypse cognitive, Presses universitaires de France (PUF), 2021.
- 4
Pascal Vasselin et Franck Cuveillier, La Fabrique de l’ignorance, ZED, 2020, [en ligne].
- 5
Myriam Revault d’Allonnes, La Faiblesse du vrai. Ce que la post-vérité fait à notre monde commun, Seuil, 2018.