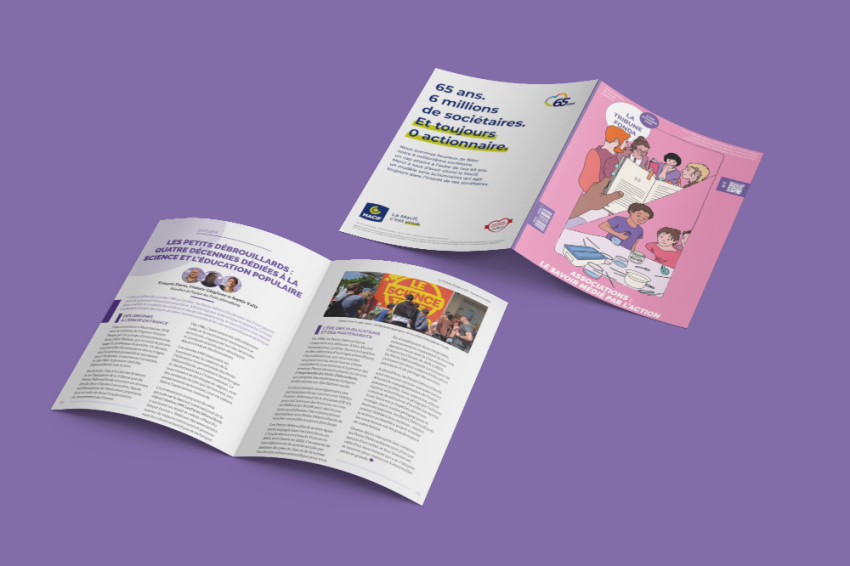Sommaire
L’éducation populaire, « faire ensemble » pour s’émanciper entretien par Emmanuel Porte
Peuple et Culture : une éducation populaire créatrice de savoirs depuis 80 ans [Initiative]
A-t-on encore besoin des think tanks aujourd’hui ?, une table ronde organisée par le Labo de l’ESS avec Charlotte Debray (la Fonda), François-Xavier Demoures (Terra Nova), Dominique Méda (Institut Veblen), Jérémie Peltier (Fondation Jean Jaurès) et Lucile Schmid (Fabrique Écologique)
Les Petits Débrouillards : quatre décennies dédiées à la science et l’éducation populaire [Initiative]
« Les associations sont des lieux de production de connaissances ! », entretien avec Stéphanie Bost, Paul Bucau et Floriant Covelli
La Cabane de la recherche, une recherche de proximité avec et pour la société [Initiative]
Questions d’asso, un podcast comme lieu d’échange entre associations [Initiative]
Les limites du bénévolat et les gardiens de l’ordre Encarta par Robert Fernandez
Savoir et agir dans la société de l’imaginaire par Yannick Blanc
Condensé
L’éducation populaire, « faire ensemble » pour s’émanciper entretien par Emmanuel Porte
Mouvement international protéiforme, l’éducation populaire se compose d’associations qui favorisent un accès aux loisirs, au sport et à la culture au plus grand nombre et en particulier aux plus démunis. Les associations qui se réclament de l’éducation populaire partagent un projet politique qui n’est pas de former les individus à la citoyenneté, mais plutôt d’expérimenter la citoyenneté dans un espace collectif. Ces espaces de production de citoyenneté dans un cadre collectif ne sont donc pas réservés aux enfants. Toute une partie de l’éducation populaire s’adresse aux adultes avec les universités populaires par exemple, leur permettant de rencontrer d’autres personnes, se construire une citoyenneté active et in fine atteindre une forme d’émancipation individuelle.
À lire pour aller plus loin: INJEP, Cahier de l’action n° 61 « Les méthodes d’éducation populaire : outils d’animation ou leviers d’émancipation ? », 2023.
Peuple et Culture : une éducation populaire créatrice de savoirs depuis 80 ans [Initiative]
A-t-on encore besoin des think tanks aujourd’hui ?, une table ronde organisée par le Labo de l’ESS avec Charlotte Debray (la Fonda), François-Xavier Demoures (Terra Nova), Dominique Méda (Institut Veblen), Jérémie Peltier (Fondation Jean Jaurès) et Lucile Schmid (Fabrique Écologique)
Souvent sous formes associatives, les think tanks, ou laboratoires d’idées, ont une place à part entière dans l’économie du savoir. Au-delà d’un rôle de médiation entre l’action et la pensée, ou de traduction, ils peuvent proposer un langage commun pour des acteurs qui n’ont pas forcément l’habitude de travailler ensemble et faire émerger des sujets peu visibilisés. Les think tanks ont néanmoins été historiquement contestés pour leur externalisation de la pensée politique hors des partis politiques ou la rigueur moindre de leurs travaux comparés aux travaux universitaires. Dans un contexte politique inquiétant, les think tanks portant des idées progressistes peinent à assurer les conditions de leur indépendance de façon pérenne.
À lire pour aller plus loin: Labo de l’ESS, « “À quoi servent les think-tank aujourd’hui ?” Une table ronde de laboratoires d’idées », Le Mag’, 18 juin 2025, [en ligne].
Les Petits Débrouillards : quatre décennies dédiées à la science et l’éducation populaire [Initiative]
« Les associations sont des lieux de production de connaissances ! », entretien avec Stéphanie Bost, Paul Bucau et Floriant Covelli
Aujourd’hui, il n’y a pas en France de réseau de connaissances structuré sur le fait associatif. Peu de connaissances universitaires sur ce sujet existent, et souvent elles ne se diffusent pas au sein du monde associatif. À l’inverse, les publications des associations qui documentent leurs actions sont peu connues du monde académique. Pourtant, dès la loi 1901, les associations ont été pensées comme des lieux de mise en commun de connaissances. De plus, les associations ont des connaissances uniques sur les territoires dans lesquels elles agissent.
À lire pour aller plus loin: Alliss, Prendre au sérieux la société de la connaissance, mars 2017, [en ligne].
La Cabane de la recherche, une recherche de proximité avec et pour la société [Initiative]
Questions d’asso, un podcast comme lieu d’échange entre associations [Initiative]
Les limites du bénévolat et les gardiens de l’ordre Encarta par Robert Fernandez
Dans les années 2000, Wikipédia s’est imposée comme l’encyclopédie en ligne grâce à un objectif précis, un seuil d’accès relativement bas, un faible sentiment d’appropriation sociale du contenu, mais surtout une mobilisation bénévole exceptionnelle par son ampleur et sa durée. Au fil des années Wikipédia a permis à des milliers de contributeurs de devenir producteurs de savoirs. Néanmoins ce modèle est aujourd’hui confronté à des tensions intrinsèques : comment garder un seuil d’accès facile et éviter la création d’une « barrière conceptuelle », qui encourage à consulter Wikipédia, sans y contribuer.
À lire pour aller plus loin: Joseph Reagle and Jackie Koerner, Wikipedia@20, MIT Press, 2019.
Savoir et agir dans la société de l’imaginaire par Yannick Blanc
La production de connaissances est structurée depuis l’époque moderne par un ensemble d’institutions académiques sélectives, exclusives et hiérarchiques : sociétés savantes, universités, instituts de recherche, grandes écoles, académies. Ce système tout entier est aujourd’hui fragilisé par la massification de l’enseignement supérieur, la mise en concurrence généralisée des chercheurs et la dérégulation de l’accès aux informations et aux connaissances. C’est dans ce contexte de déclin des institutions du savoir qu’émerge ce que le prospectiviste américain Jim Dator a appelé la dream society, soit la société du simulacre, de l’événement, ou de l’imaginaire. Née de la croissance exponentielle de production d’images, la dream society transforme radicalement les conditions de l’action collective. Pour les associations, il ne s’agit plus de défendre les acquis démocratiques de la civilisation du texte et de la transmission du savoir, mais d’explorer et d’inventer les langages et les pratiques permettant de faire revivre la délibération et le faire ensemble dans la société de l’imaginaire.
À lire pour aller plus loin: Futuribles international, « Qui croire ? Que croire ? », Êtres humains, être humain en 2050, Rapport Vigie, 2023.