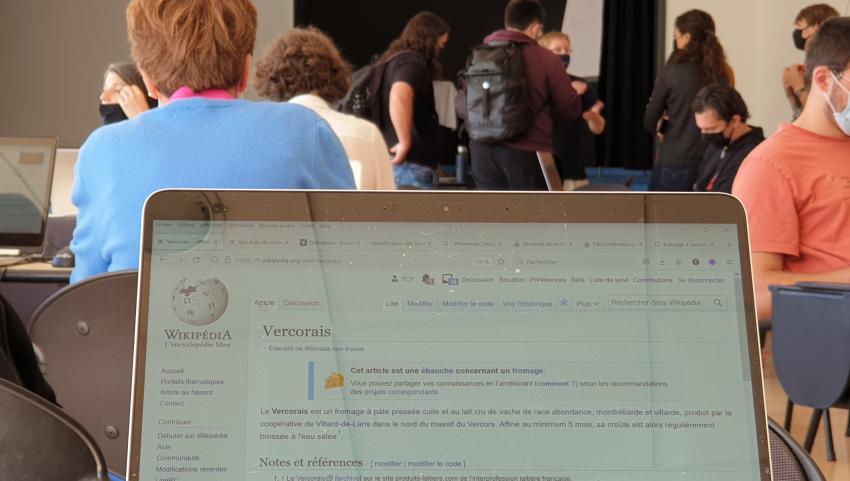En juin 2019, Robert Fernandez a contribué avec « The Limits of Volunteerism and the Gatekeepers of Team Encarta » à l’ouvrage Wikipedia@20, édité par Joseph Reagle and Jackie Koerner et publié au Massachusetts Institute of Technology (MIT) Press. Nous reproduisons ici un extrait de l’article traduit avec son aimable autorisation.
Huit encyclopédies en ligne au début des années 2000
À l’entrée dans un nouveau millénaire, l’encyclopédie en ligne n’était qu’un rêve. Microsoft Encarta a fait son apparition sur le web cette année-là et la vénérable Encyclopædia Britannica y était présente depuis 1994.
Cependant, leurs modèles d’abonnement, leur portée limitée et leurs fonctionnalités web 1.0 ne correspondaient pas à ce qu’avaient en tête les personnes élevées au culte de Ford Prefect et Hari Seldon, figures emblématiques de la culture geek1.
Une véritable encyclopédie en ligne universelle devait naître : la seule question était de savoir quelle forme elle prendrait et qui la créerait. Lorsque Wikipédia est apparue un an plus tard, le 15 janvier 2001, son rôle d’encyclopédie mondiale était loin d’être acquis. Dans sa thèse de doctorat, Benjamin Mako Hill a étudié les débuts de huit encyclopédies web2.
Wikipédia aurait tout aussi bien pu devenir une nouveauté oubliée de la bulle Internet, tout comme les sept autres.
Interpedia était la plus ancienne des huit et pouvait s’appuyer sur la base de participants et l’infrastructure préexistante d’USENET. H2G2, avec son célèbre logo inspiré du Guide du voyageur galactique3 et le soutien de la BBC, semblait être un candidat encore plus prometteur.
Everything2 bénéficiait d’un financement important et de l’attention de Slashdot, l’un des premiers moteurs de trafic web, comparable à Reddit aujourd’hui. Aaron Swartz, alors adolescent, a lancé TheInfo. En 2001, qui aurait pu imaginer que tous ces projets seraient tombés dans l’oubli et que Wikipédia deviendrait un nom connu de tous ?
3 facteurs clés de succès
Hill conclut que Wikipédia a réussi grâce à trois facteurs clés quand aucun des autres projets n’a réussi à en réunir plus de deux. Le premier est la familiarité de l’objectif ou du produit. Bon nombre de ces projets n’étaient pas tout à fait des encyclopédies, ou pas seulement des encyclopédies.
Avant de rejoindre Wikipédia, j’étais « éditeur » sur Everything2, un projet qui semblait englober (presque) tout. C’était une perspective qui offrait une liberté enivrante, mais qui semait aussi la confusion chez les personnes qui ne savaient pas comment contribuer, étant donné le choix presque illimité de sujets, de formats et de styles.
A contrario, Wikipédia avait un objectif commun suffisamment précis et familier pour que tout le monde puisse le comprendre, et suffisamment large pour englober les intérêts et les particularités de chacun. C’est « l’encyclopédie que tout le monde peut modifier ».
Que faisons-nous ? Nous modifions, une tâche spécifique et familière, mais qui peut englober tout, depuis les querelles sur les virgules jusqu’à la rédaction de longs essais. Que modifions-nous ? Une encyclopédie, quelque chose de spécifique que tout le monde peut facilement identifier, mais qui peut littéralement porter sur n’importe quoi, des plantes aux trains en passant par les Pokémon.
Le deuxième facteur cité par Hill était un seuil d’accès relativement bas. Afin d’atteindre une masse critique de contributeurs, il faut que la contribution soit facile. Cela inclut toutes sortes de facteurs technologiques, sociaux, psychologiques et même esthétiques. Quiconque a déjà abandonné en cours de route un achat sur un site d’e-commerce a fait l’expérience de ce problème.
Wikipédia a réussi à réduire ces barrières grâce à son logiciel wiki permettant une collaboration pratiquement en temps réel.
Le langage de balisage était suffisamment simple pour être facilement compris, du moins par les utilisateurs avertis du web 1.0.
Le dernier facteur était le faible sentiment d’appropriation sociale du contenu. De nombreux sites partaient du principe qu’une forme de récompense sociale sous forme de reconnaissance inciterait les gens à participer.
Sur Everything2, par exemple, cela prenait la forme d’un système de points d’expérience et de niveaux similaire à celui des jeux vidéo. On pourrait penser que le manque de reconnaissance et de contrôle de vos contributions sur Wikipédia serait un facteur dissuasif, comme je l’ai ressenti initialement.
L’engagement de Wikipédia en faveur de la neutralité a conduit à un ton neutre, largement dépourvu de la voix de l’auteur. Ce qui ne lui a pas nui, au contraire.
Cela a permis d’installer Wikipédia comme bien commun et partagé.
De nombreuses personnes ont également été incitées à contribuer davantage, en raison de l’absence de propriété implicite du contenu.
Les gens sont plus enclins à modifier et à améliorer un texte s’ils ne le perçoivent pas comme appartenant à quelqu’un d’autre. « Ironiquement, écrit Hill, le fait que Wikipédia ait rendu la paternité moins visible a ouvert la voie à une collaboration plus profonde et plus répandue. »4
Pourquoi comprendre ce processus est-il important ? Pour savoir comment changer, il faut savoir comment on a réussi au départ. Pourtant, les conclusions de Hill sont largement méconnues, même parmi les spécialistes, et certainement parmi la plupart des rédacteurs principaux de Wikipédia.
Comme le note Hill, il est courant d’attribuer le succès de Wikipédia à une combinaison de chance, de moment propice et de supériorité technologique, malgré l’absence de données empiriques pour étayer ces conclusions. Même Joseph Reagle, dans Good Faith Collaboration, conclut son examen approfondi de Wikipédia en écrivant qu’elle est « née presque par un heureux hasard »5.
Le rôle des bénévoles
Sans les bénévoles, Wikipédia n’aurait bien sûr jamais vu le jour. La mobilisation bénévole la plus importante et constante connue a donné naissance à la ressource d’information la plus vaste et la plus utilisée de l’histoire de l’humanité. Son succès est tel que toute tentative de décrire avec précision l’ampleur de ce qui a été accompli ressemble inévitablement à une hyperbole.
L’ensemble du projet Wikipédia (ou plus exactement, l’ensemble des projets) a été entièrement mené par des personnes qui ont donné bénévolement de leur temps pour créer du contenu ou collecter des fonds afin d’assurer le fonctionnement des serveurs.
Naturellement, une grande partie du débat sur Wikipédia a porté sur le dévouement, l’ingéniosité, l’intelligence, et autres traits positifs des bénévoles.
Ce que ce débat omet de mentionner, c’est que, souvent, les bénévoles ne sont pas des personnes sympathiques.
Ils agissent en fonction de leurs propres intérêts, de leurs besoins sociaux et psychologiques. Ils ne sont exempts ni de préjugés et de rancunes. Leurs motivations sont néanmoins tout à fait appropriées, car aucun acte ne peut être purement altruiste.
De nombreux projets bénévoles réussissent précisément parce qu’ils ont trouvé le moyen d’exploiter l’énergie des bénévoles et de satisfaire leurs besoins légitimes pour les inciter à poursuivre leur participation. Dans la pratique, cependant, de nombreux bénévoles, consciemment ou non, font passer leurs propres besoins avant la mission qu’ils prétendent servir.
Le jalt, un altruisme teinté de jalousie
Dans son article le plus connu sur Linux, Yochai Benkler a inventé le mot « jalt » pour décrire le mélange de jalousie et d’altruisme qui anime ceux qui travaillent sur des projets bénévoles6.
Bien qu’il soit rarement évoqué dans ce contexte, le jalt est devenu l’un des moteurs principaux pour un certain nombre de participants très actifs sur Wikipédia.Un peu de jalousie est inoffensive, mais les vrais problèmes commencent lorsque les personnes commencent à se croire tout permis.
L’exemple le plus courant de jalt consiste à « mordre les nouveaux venus », c’est-à-dire se montrer hostile envers les éditeurs novices sur Wikipédia7. Le risque est identifié depuis les débuts de Wikipédia, mais il grandit à mesure que les politiques, les procédures et l’utilisation de jargon et d’acronymes se développent comme du lierre.
Il est facile de tomber dans cette pratique, même pour les éditeurs bien intentionnés, qui se lassent d’avoir à traiter la même question pour la centième fois. C’est encore plus facile pour les nombreux éditeurs qui proclament fièrement leur agressivitéet, pour citer Tennessee Williams, s’imaginent être des modèles de franchise8.
Combien de bénévoles partent ou ne s’engagent pas ?
Malgré tous les indicateurs montés en épingle par les partisans des projets Wikimedia, un indicateur non négligeable qui n’est jamais cité est la perte des bénévoles qui partent ou ne s’engagent jamais en raison des barrières à l’entrée, dont l’une des plus citées est l’hostilité des éditeurs historiques.
Comme nous l’avons vu dans le cadre théorique de Hill, un faible obstacle à l’entrée a été un facteur clé de la croissance explosive et du succès de Wikipédia. Les éditeurs nécessaires pour créer, maintenir et mettre à jour des millions d’articles ne continueront pas à rejoindre le projet si ceux qui y participent déjà sont hostiles.
Cela est d’autant plus critique que Wikipédia devient une partie intégrante de l’infrastructure en ligne et de l’information, et que de moins en moins de gens la considèrent comme un projet distinct auquel ils peuvent participer eux-mêmes. J’ai appelé ailleurs ce problème la « barrière conceptuelle », c’est-à-dire l’incapacité ou la réticence des gens à se considérer comme ayant la capacité et les compétences nécessaires pour éditer Wikipédia9.
Des études ont montré que de nombreux lecteurs considèrent Wikipédia comme l’un des nombreux résultats des moteurs de recherche, et non comme une ressource distincte qu’ils pourraient façonner par eux-mêmes10.
Ce problème ne fera que s’aggraver à mesure que de plus en plus de personnes interagiront avec les informations de Wikipédia de différentes manières : sur des appareils mobiles, via le Knowledge Graph de Google, lues par Alexa ou d’autres appareils intelligents.
Il est impossible de recruter de nouveaux contributeurs bénévoles sur Wikipédia s’ils ne parviennent pas à surmonter les barrières à l’entrée, ou même à concevoir Wikipédia de la même manière que ses contributeurs actuels.
Une barrière à l’entrée parmi d’autres
La communauté Wikipédia a hérité des premiers projets Internet dont elle est issue une antipathie envers les nouveaux contributeurs.
Parfois, cette antipathie s’exprime sous la forme d’une hostilité directe envers les contributeurs eux-mêmes, d’autres fois sous la forme d’une résistance aux changements et aux améliorations qui facilitent le recrutement ou l’expérience des nouveaux contributeurs.
Ce n’est pas un hasard si l’interface actuelle de Wikipédia, très textuelle, ressemble beaucoup à celle de 2001 et n’est pas adaptée aux utilisateurs d’Internet d’aujourd’hui. C’est le résultat direct de cette résistance au changement et à l’innovation.
Les bénévoles établis se sentent en droit de tout refuser. Ils s’opposent aux possibles améliorations, car celles-ci rompent avec leurs habitudes ou ne correspondent pas à leur vision dont les choses devraient être faites, sans se soucier du tort que cela cause au projet et à la mission pour lesquels ils sont censés se porter volontaires.
Ils sont indifférents aux analyses telles que celle de Benjamin Hill sur les raisons du succès de Wikipédia et leur préfèrent une explication impliquant le hasard ou l’inévitabilité, car ce qui compte n’est pas la réussite de Wikipédia, mais leur propre satisfaction et leur sentiment de légitimité.
Wikipédia a réussi à dépasser des projets tels que Microsoft Encarta et l’Encyclopædia Britannica parce qu’elle a baissé les barrières à l’entrée et privilégié la flexibilité et l’innovation. Au cours des deux dernières décennies cependant, les bénévoles établis se sont érigés en nouveaux gardiens d’un ordre établi.
- 1
Ford Prefect et Hari Seldon sont les protagonistes des deux œuvres les plus célèbres traitant d’encyclopédies de science-fiction. Ford Prefect est un chercheur extraterrestre travaillant pour l’encyclopédie éponyme dans Le Guide du voyageur galactique, tandis que le protagoniste de la série Fondation d’Isaac Asimov est le psychohistorien Hari Seldon, créateur de l’Encyclopedia Galactica. Une wikipédienne de renom, Rosie Stephenson-Goodknight, a maintes fois évoqué l’influence d’Hari Seldon sur son travail.
- 2
Benjamin Mako Hill, Essays on volunteer mobilization in peer production. Thèse de doctorat, Massachusetts Institute of Technology, 2013.
- 3
Traduit en français par Le Guide du voyageur galactique, The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, abrégé notamment en H2G2, est une œuvre de science-fiction radiophonique produite par la BBC et imaginée par l’écrivain britannique Douglas Adams à partir de 1978.
- 4
Benjamin Mako Hill, Ibid.
- 5
Joseph Reagle, Good Faith Collaboration, MIT Press, 2010.
- 6
Yochai Benkler, « Coase’s Penguin, or, Linux and the Nature of the Firm », Yale Law Journal n°112, 2002.
- 7
Wikipédia, « Please Do Not Bite the Newcomers ».
- 8
« All cruel people describe themselves as paragons of frankness » déclarait Tennessee Williams dans Le train de l’aube ne s’arrête plus ici en 1963.
- 9
Robert Fernandez, « Wikipedia’s conceptual barrier », Wikipedia Signpost, 2015.
- 10
Mónica Colón-Aguirre and Rachel Fleming-May, « ’You Just Type in What You Are Looking For’: Undergraduates’ Use of Library Resources vs. Wikipedia. », The Journal of Academic Librarianship n°38, 2012.