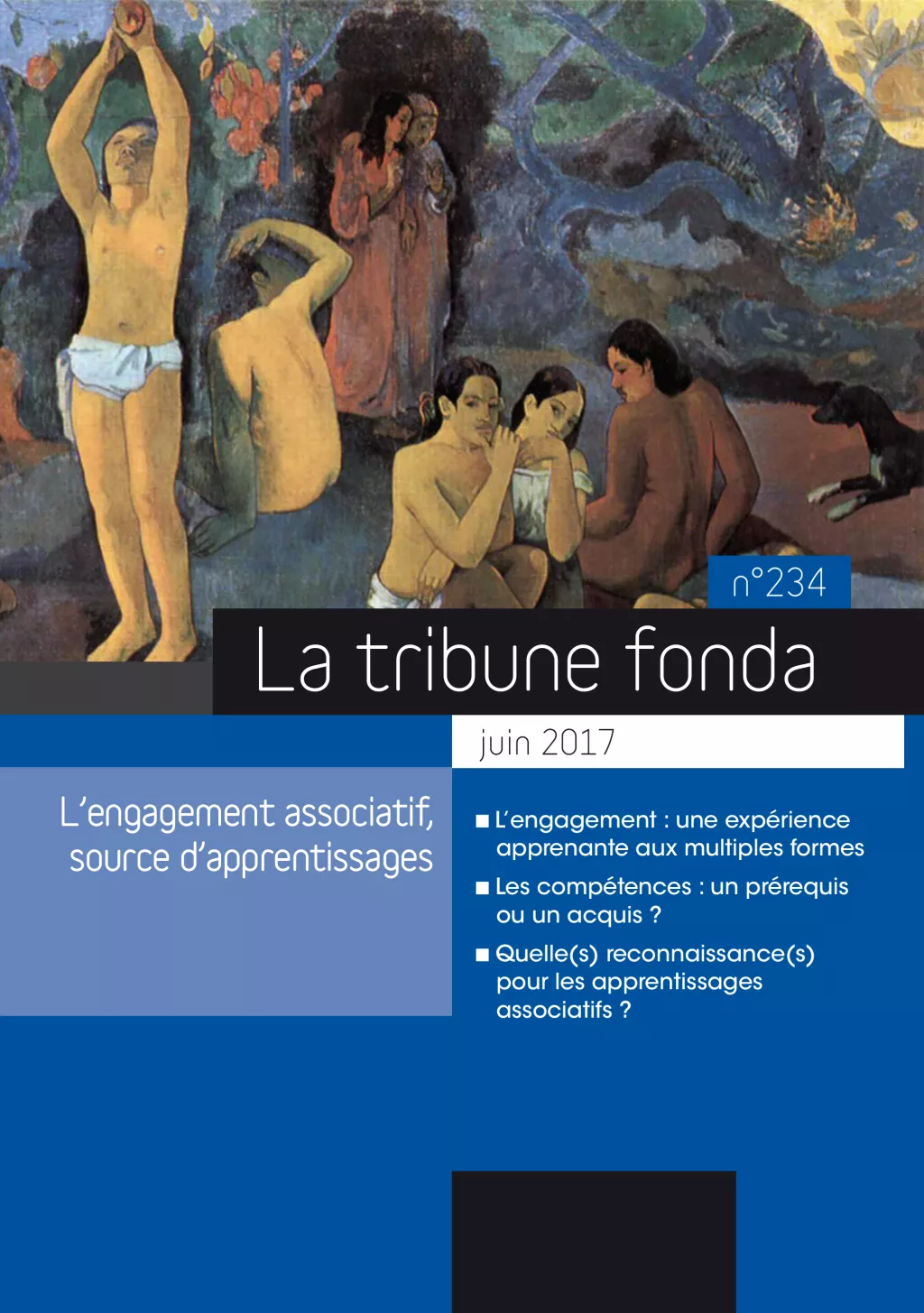L’éducation populaire, enjeu historique
Plusieurs périodes peuvent être distinguées où l’essor de l’EP suit un scénario constant. Le développement naît toujours après une période de profonde crise sociale et de perte de crédibilité de l’élite (la guerre de 1870 et la répression de la Commune, les deux guerres mondiales ou la crise économique des années 1970). La sortie de ces crises exige une plus grande convergence des forces vives du pays pour répondre à des défis importants et ouvre des horizons nouveaux auxquels peu de personnes étaient préparées.
C’est le cas pour le début de l’industrialisation avec l’exode rural, l’avènement de la République et la séparation de l’Église et de l’État, la deuxième révolution industrielle et le socialisme, la résistance et l’organisation scientifique du travail, la bureaucratisation et la fin des grandes idéologies, l’économisme et la mondialisation. Dans ces moments, pour répondre aux désirs d’engagement d’un plus grand nombre d’acteurs, des mouvements s’organisent, trouvent leur inspiration chez des penseurs de la période précédente et créent de nouvelles méthodes pratiques qu’ils diffusent.
Chaque période est marquée par la vigilance face aux errements antérieurs, elle ouvre des perspectives, développe des terrains nouveaux, tout en renforçant les dynamiques antérieures. Ainsi, dans la première, l’accent est mis sur la connaissance avec les cercles d’études, les bourses du travail, les mutuelles, le compagnonnage, puis l’école pour tous. La deuxième intègre la compréhension de la société, la responsabilité, la culture, la santé physique, le sport et après 1936 le retour à la nature et les vacances dont s’inspireront les maquis. La période suivante ouvre un champ plus considérable pour rejeter le fascisme, développer la démocratie, assurer l’égalité, la protection sociale universelle et la santé psychique, soutenir les familles, insérer les personnes marginalisées, promouvoir le logement pour tous… La dernière voit apparaître un foisonnement d’associations qui couvrent l’ensemble des secteurs de la société, y compris des champs réputés être du domaine de l’intime (parentalité, conjugalité, sexualité…) et l’écologie globale. Chaque étape correspond également à la mobilisation de nouveaux domaines théoriques : la philosophie, la théologie, l’économie, la culture et l’histoire, puis l’anthropologie, les sciences humaines, les arts, la médecine, la neurologie et la thérapie, la communication, la biologie, l’écologie…
Les échanges d’expériences s’ouvrent également à des territoires plus larges de l’Europe au Monde avec les Ong et à l’utilisation de nouvelles technologies.
Avec cette extension, les trois courants initiaux : laïc éducatif et socialisme, « bourses du travail » proche des syndicats, et personnaliste avec le christianisme social, deviennent moins exclusifs et concurrents, et certains thèmes nouveaux (libéralisme social, Europe, écologie) peuvent être plus clivant socialement et bousculer l’unité de ses courants.
Avec l’ampleur des réseaux associatifs et la crise des années 1970, le financement évolue progressivement du don à la subvention, à la réponse aux appels d’offres, aux mécénats et aux fondations d’entreprises, de la gratuité aux aides sociales ou fiscales, des structures marchandes associatives au marché privé. La diversité des modèles économiques est importante. Parallèlement, durant la période des Trente Glorieuses, les équipements se développent et l’investissement des bénévoles est complété par un grand nombre de salariés spécialisés ou d’emplois aidés. Ces mouvements seront suivis de transformations sociales importantes, d’institutionnalisation, de normalisation de certains secteurs et parfois d’instrumentalisation. Ces évolutions, les recompositions politiques et les changements générationnels à la tête des associations, provoqueront des abandons, des tensions et même des scissions.
Pourtant, les méthodes et les savoir-faire créés subsistent, ils se diffusent, y compris pour les entreprises. Les différentes périodes font apparaître une philosophie globale que résume bien P. Freire : « Personne n’éduque personne, personne ne s’éduque seul, les hommes s’éduquent ensemble par l’intermédiaire du monde. » Ce qui a pour conséquence de se sentir responsable individuellement et collectivement de notre éducation, notre histoire, notre culture, nos valeurs ; d’affirmer sa dignité et son éducabilité ; de prendre conscience de la place que l’on occupe dans la société et des rapports en jeu en visant son émancipation ; de développer son esprit critique et sa capacité de proposition ; d’expérimenter sa capacité d’agir ; de savoir s’allier pour agir et transformer les situations insatisfaisantes ; d’inscrire son action dans une histoire et un avenir.
Ces points communs restent constants et partagés par de nombreux acteurs associatifs. Par contre, il est évident que des ruptures se sont produites et que les associations sont devant des défis importants pour être acteurs dans une société complexe. La période ouverte depuis une vingtaine d’années exige de s’inscrire dans une perspective dont les contours peuvent s’entrevoir dans le foisonnement des associations et des compétences mobilisées actuellement.
De nouveaux défis
Avant de préciser les compétences nécessaires pour aborder ses défis internes ou externes, nous nous proposons d’en décrire trois succinctement.
Une société plus complexe
Nous sommes dans une société fragmentée. La diversité culturelle et les pratiques sociales positives de découverte, de tolérance, d’empathie, de confiance, de mobilité, de volonté de réaliser ou les technologies, l’importance des communs… peuvent apparaître comme la face positive. Mais elle coexiste avec l’isolement, la violence et la délinquance, les difficultés d’inclusion, les inégalités affichées, l’emprise médiatique, la prégnance d’une culture économique et financière, les risques environnementaux, l’utilisation perverse des réseaux, avec des populations qui cumulent toutes les difficultés…
La situation est d’autant plus déstabilisante que les systèmes de valeurs et d’apprentissage qu’offraient la tradition ou le progrès se sont affaiblis et que chacun est rendu responsable de la construction de sa réussite et de son autonomie. Tous les secteurs de la vie sociale, culturelle, économique et écologique sont concernés de manière systémique, y compris des domaines traditionnellement plus intimes comme la parentalité, la conjugalité ou la relation aux anciens. Chacun est invité à s’engager dans une société en mutation, en acceptant l’incertitude et le caractère imparfait de toutes solutions. Cela suppose de sortir d’une attitude purement défensive et contestataire afin de penser aux interactions de proximité et dans des horizons plus larges pour imaginer et réaliser, par le dialogue, des pratiques sociales plus démultiplicatrices. Une situation qui exige des coopérations accrues.
Une mobilisation continue des capacités de transformation
Au-delà des solutions à inventer face à de telles évolutions, la question des méthodes se pose de manière plus impérative. Progressivement, le discours social est passé de l’éducation à la formation, ce qui invite les associations à distinguer éducation et pédagogie. La première est en grande partie le résultat d’effet de nombreux facteurs, en partie peu maîtrisables, qui favorisent la socialisation, alors que la pédagogie renvoie à un processus construit qui vise l’atteinte d’objectifs explicites au-delà de la transmission de contenu. Le distinguo est important quand les apprentissages se font massivement en situation d’action. La dimension formative doit être organisée et animée rigoureusement.
Dans une société mobile, la difficulté réside dans la formation des formateurs et intervenants. S’ils savent apprendre à apprendre, ils doivent pouvoir imaginer des situations totalement nouvelles pour transférer des apprentissages dans d’autres situations et permettre à chacun de trouver une place qui ne lui est pas assignée d’avance. La confrontation « théorie / pratique » dans une société complexe doit être multidimensionnelle, ce qui nécessite des compétences de formateurs et de responsables qui restent, dans beaucoup de domaines, à inventer. Le choix d’une confrontation exigeante avec l’expert, le consultant, le coach… nécessite aussi une démarche de dialogue exigeante, sinon la conception de l’expert apparaîtra technocratique, un savoir uniquement descendant qui fascine certains, en rebute d’autres et les déresponsabilise dans leur recherche d’amélioration. La mobilisation des compétences nécessite également d’intégrer les savoirs que chacun a acquis dans d’autres lieux associatifs, sociaux ou professionnels. Or, si chacun a indéniablement des compétences à offrir, le fonctionnement des associations et l’intégration des nouveaux arrivants ne favorisent pas toujours un transfert efficace.
Au-delà des techniques à ajuster, la difficulté réside dans la capacité à distinguer sa compétence propre de celle des autres équipes de travail, afin de pouvoir transférer des savoirs dans un univers associatif où les métiers sont peu repérés, souvent changeants, et où le cadre organisationnel et institutionnel est plus faible. Cela ne s’improvise pas.
Prendre toute la dimension de l’engagement des bénévoles
Chacun investit avec son projet de vie et on ne peut lui imposer un comportement ou le retenir sans qu’il trouve une satisfaction à ce qui lui est proposé. C’est un défi important, car toute organisation, y compris volontaire, doit chercher à utiliser au mieux ses ressources pour mener à bien ses projets et asseoir sa crédibilité. Il s’agit donc de gérer la tension entre l’engagement et les exigences organisationnelles. Ce qui invite à reconnaître la pluralité des attentes des bénévoles et des salariés qui s’avèrent moins homogènes que ne le laissent supposer les discours.
Une étude récente fait apparaître quatre positions assez contrastées : les uns adhèrent à l’ensemble des valeurs et au projet de l’association, mais en refusent les contraintes de gestion ; d’autres, en se sentant militants, souhaitent une organisation efficace et des résultats ; un troisième groupe veut avant tout mettre son expertise au service d’une cause et souhaite des règles claires ; le dernier regroupe des personnes qui cherchent à occuper leur temps, et qui ne souhaitent pas un cadre trop rigide.
Cette typologie n’est peut-être pas commune à toutes les associations, mais alerte sur une diversité des motivations et invitent à une attention particulière, car, seul le « faire ensemble » génère un état émotionnel positif, valorise les talents, construit de la confiance en soi et dans les autres, atténue les clivages sociaux, ouvre des alternatives et donne sens à la vie.
Reconnaître une professionnalité
Ces trois défis font apparaître la question de la professionnalité des membres ainsi que l’importance d’une éthique de la mobilisation des engagements. J’utilise plus volontiers le terme « professionnalité » plutôt que celui de professionnalisation qui a une connotation d’obligation externe d’évolution.
La professionnalité part de la réalité d’une activité, de la mobilisation des savoirs et des expériences pour réaliser une mission, construire des relations de qualité et chercher des améliorations possibles. C’est l’individu qui est l’auteur de cette construction. L’organisation, la définition de l’activité, les apports de méthodes ne fournissent qu’un cadre qui va plus ou moins la faciliter. C’est la capacité à s’investir dans une action que l’on souhaite efficace. Le désir de s’impliquer dans une action, la quête de méthode, l’acceptation d’essais – erreurs et le bricolage pour trouver la solution d’un problème, sont inhérents à la construction d’une professionnalité. Elle est propre à chaque personne, et contingente à un univers organisationnel, associatif et institutionnel qui délimite les marges octroyées. Le projet global, même généreux et partagé, est insuffisant pour aider à développer sa professionnalité dans des situations complexes. C’est pourquoi la structure doit permettre d’échanger des astuces, d’acquérir une intelligence des différentes facettes du problème ou du projet, de connaître les réseaux ressources, d’appréhender les limites, le sens de l’activité, les raisons d’agir et le sens des opportunités. La professionnalité s’acquière aussi dans une participation à l’élaboration de l’activité, à son évaluation. Elle nécessite un soutien pour analyser son action et capitaliser ses savoir-faire.
Aujourd’hui, la reconnaissance de cette professionnalité fait débat parmi les militants et bénévoles. Pour certains, elle risque de contribuer à une profonde transformation de l’engagement en attirant des profils particuliers sur des aspects techniques au détriment du projet politique ; pour d’autres, les activités plus complexes demandent que la technicité soit reconnue pour rendre l’engagement attractif et fidéliser le bénévole. Au-delà des discussions internes, les différentes parties prenantes sont intéressées, car elles cherchent à évaluer la qualité et la crédibilité des actions, et la certification constitue pour eux un moyen de rendre visible le professionnalisme malgré l’évolution constante des activités.
Cependant, la reconnaissance rencontre plusieurs freins dans sa mise en œuvre. Tout d’abord, la VAE et la certification renvoient à la nécessité de formations accessibles par la VAE. Or, elle est encore peu structurée dans les activités exercées par les associations, et la logique des blocs de compétences (ensemble de savoirs validant une partie de la formation), trop souvent organisés en fonction de la formation initiale est dénoncée par les organismes validant les CQP (certificat de qualification professionnelle). Ils souhaitent une approche qui parte de séquences professionnelles. Bien que cette option soit maintenant retenue, les tensions avec l’Éducation nationale restent assez fortes.
D’une manière plus générale, les études menées en France et en Europe, y compris auprès des représentants du personnel, montrent que si les compétences associatives sont réelles, on peine à les identifier. La créativité, la mobilité dans les responsabilités et les activités, et une faible capitalisation des savoirs ne facilitent pas le repérage de compétences transférables dans d’autres situations. On est « en face d’un océan de compétences, mais d’un centimètre d’épaisseur » (Michel Rocca, 2003 ). Or, les organismes certificateurs privilégient la profondeur des savoirs à leur étendue et organisent l’analyse par rapport à des formations existantes. Difficulté que l’on retrouve pour intégrer l’expérience associative dans une biographie de carrière.
L’analyse rétrospective de parcours présentés par des militants associatifs montre qu’ils minimisent généralement les dimensions politiques et stratégiques. En l’absence de référence extérieure connue et stabilisée, le travail de mise en forme du récit est délicat. Il s’organise plus pour répondre aux préférences des institutions de formation et du jury et laisse dans l’ombre les articulations avec les autres facettes de la vie sociale et familiale.
Le bénévole ou le salarié peut tenter de sa propre initiative la VAE, mais cette démarche ne dispense pas l’association de penser une stratégie plus globale et collective intégrant les formations et la capitalisation périodique des savoirs et des compétences acquises. Les VAE collectives, peu mobilisées, peuvent constituer une aide dans ce domaine. C’est un enjeu qui demande un accompagnement adapté et une place dans le fonctionnement de l’association. Cela nécessite aussi de bonnes relations internes, une implication de la gouvernance et des alliances avec les organismes de formation et les décideurs locaux.
Ce tour d’horizon fait apparaître qu’il existe au sein du mouvement associatif, même dispersé et diversifié, de nombreux points communs qui peuvent et doivent être mobilisés pour relever les défis importants, demandant une ingénierie sociale, des coopérations et des alliances rénovées. Une synergie est à construire pour inventer des activités, des méthodes, des pratiques qui permettent au « tiers secteur » de passer résolument du « faire pour » au « faire avec » en privilégiant l’accompagnement et la participation.