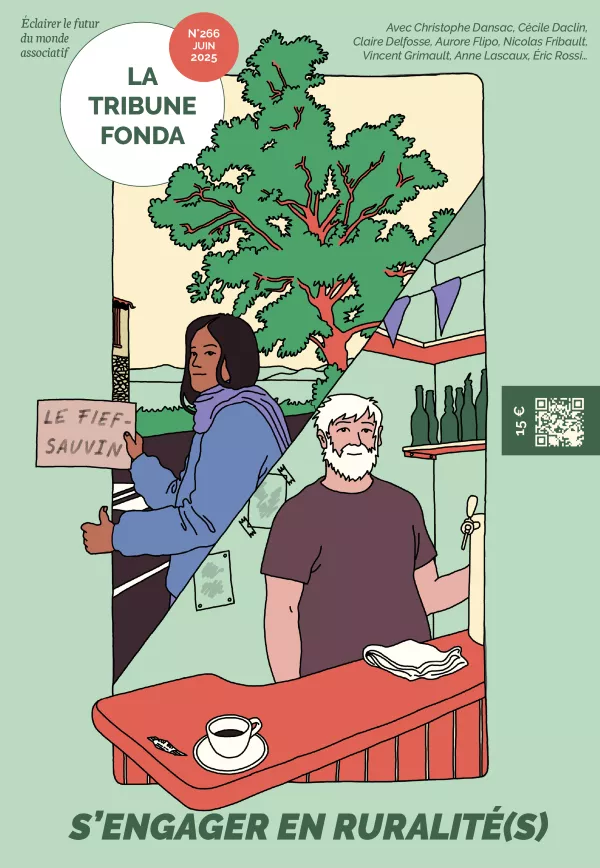L’Observatoire des jeunesses et des politiques jeunesse du Lot est né à la suite d’un diagnostic jeunesse réalisé en 2018. Nous avions alors constaté un déficit de connaissance sur les jeunes.
L’Observatoire est porté par le Département Carrières sociales de l’Institut universitaire de technologie (IUT) de Figeac. Dans le cadre de leur formation aux méthodes de recherche en Sciences humaines et sociales (SHS), les étudiants et étudiantes de l’IUT se destinant à l’intervention sociale enquêtent chaque année sur les jeunes du Lot, encadrés par notre équipe de recherche.
Grâce aux résultats d’une enquête de ce type, nous proposons le concept de « jeunes sans Cité » pour décrire les jeunes ruraux1.
Les jeunes ruraux, des « jeunes sans Cité »
Cette expression, construite en miroir de celle de « jeunes des Cités », veut rendre compte d’une double réalité constatée dans les travaux sur les jeunes ruraux.
Le terme « cité » peut prendre deux sens : avec une minuscule, un espace à habiter, et avec une majuscule, l’espace politique.
Premièrement, les jeunes ruraux vivent dans un environnement qui est dépourvu des archétypes de la ville comme des centres commerciaux, des pôles culturels, des cinémas multiplex ou des réseaux denses de transport en commun.
Ils ne bénéficient pas, ou sont très éloignés, des équipements de type skate-parks ou city stades, emblématiques des cultures urbaines.
Soit autant d’éléments qui privent les jeunes ruraux d’une cité au sens des modèles urbains, majoritaires dans les médias qui façonnent les cultures juvéniles.
Deuxièmement, la Cité est l’espace public et politique à l’intérieur duquel les citoyens peuvent, par leur participation, s’affirmer comme membre d’une collectivité politique agissante2. Ainsi le partage de la civitas, la participation à égalité de droits, doit s’ouvrir à tous les membres de la société et en particulier aux jeunes.
Or, en milieu rural, les jeunes disposent de moins d’espaces pour exprimer ce « droit de Cité »3 : ils sont éloignés des instances de participation et des espaces de représentation comme les Conseils de Jeunes n’existent pas ou peu en milieu rural. Les créations de junior associations ne sont pas légion non plus. Les équipements socioculturels susceptibles de faciliter des formes de participation, comme les accueils jeunes, les Maisons des jeunes et de la culture (MJC) ou les centres sociaux, y sont rares.
Même les possibilités d’exercer les fonctions de délégués de classe dans les collèges et lycées peuvent être compromises, car des difficultés de mobilité peuvent freiner l’engagement comme nous l’avions constaté dans notre travail de 2017. En effet, quid des réunions hors des horaires des bus scolaires ?
Dans ces conditions, les « jeunes sans Cité » peuvent-ils s’engager de la même façon dans ces territoires ruraux, malgré de moindres opportunités ? Les enquêtes de l’Observatoire des jeunesses du Lot, conduites en 2022 sur les collégiens et en 2023/2024 sur les lycéens, montrent qu’ils ne sont pas en reste sur la question de l’engagement.
Des jeunes ruraux plus engagés
Tout d’abord, même si les jeunes ruraux4 sont plus éloignés des espaces d’engagement, ils en ont une connaissance similaire. Service civique, Service national universel (SNU), conseils de jeunes, écodélégués et ambassadeurs contre le harcèlement sont autant connus que par les jeunes urbains. A contrario, junior associations ou Associations temporaires d’enfants citoyens (ATEC) le sont aussi peu en ville qu’en campagne.
Quand on demande à 829 collégiens et collégiennes « Avez-vous déjà participé (sans y être obligé ou être payé) à l’organisation d’un événement dans votre ville, village, ou quartier ? », les jeunes ruraux sont moins nombreux à répondre « jamais » ou « rarement » (60 % contre 69 % pour les urbains).
Ils sont plus nombreux à répondre « de temps en temps » (27 % contre 22 %) et « souvent » (12 % contre 9 %). Cette question posée à 1774 lycéens et lycéennes donne les mêmes résultats en faveur des jeunes ruraux (souvent : 17 % contre 11 %).
Quand on leur demande à quel point ils sont prêts à être bénévoles dans le futur, les jeunes ruraux répondent significativement plus positivement que les jeunes urbains, tant chez les garçons (59 % prêts contre 45 %), que chez les filles, qui sont d’ailleurs plus nombreuses à l’être (71 % contre 66 %).
Au niveau des causes pouvant mobiliser les lycéens et lycéennes, les jeunes ruraux ne diffèrent pas des jeunes urbains, hormis par une plus grande attention accordée à la question de la réduction des déchets et de la pollution.
Notons que dans cette enquête, pour l’ensemble des lycéens et lycéennes, les causes environnementales, comme la réduction de la pollution et la préservation des espèces, sont en retrait par rapport à celles des violences et du harcèlement, des inégalités entre sexes, des préjugés raciaux ou encore de la pauvreté et de la faim.
La propension à l’engagement n’est pas contrariée par l’usage des réseaux sociaux, bien au contraire : plus le niveau d’usage est haut, plus les jeunes sont susceptibles de s’engager, que ce soit dans des fonctions de représentation ou dans des activités bénévoles.
Des inégalités sociales persistantes
Les inégalités sociales face à l’engagement restent fortes pour les ruraux comme les urbains : les jeunes ayant des parents plus diplômés sont beaucoup plus prêts à être bénévoles, et ceux ayant des parents les moins aisés financièrement sont moins prêts que les autres à accepter des fonctions de représentation5.
Notre enquête 2023-2024, explorant le rapport entre mixité sociale vécue, soit dans le cercle des proches, et propension à l’engagement, démontre que les deux sont positivement corrélés : plus on vit de mixité sociale, plus on s’engage.
Or elle montre aussi que la mixité sociale vécue est plus faible chez les jeunes ruraux. Malgré cela, leur propension à s’engager est plus forte, et cela démontre la spécificité de la ruralité à l’égard de l’engagement.
- 1
Cécile Vachée, Christophe Dansac et Sophie Ruel, Les jeunes ruraux, des « jeunes sans Cité » ? Une étude quantitative des implications citoyennes des jeunes Lotois, 2017.
- 2
Christine Delory-Momberger et Bernard Friot, « Avoir droit dans la cité. Vulnérabilités et pouvoir d’agir », Le sujet dans la cité n° 3, 2012, [en ligne].
- 3
Étienne Balibar, Droit de cité : Culture et politique en démocratie, Éditions de l’Aube, 1997.
- 4
Les jeunes ruraux sont identifiés comme tels par la classification 2015 de l’Insee de leurs communes d’habitation. Il faut noter que le Lot est majoritairement rural, et que les communes urbaines restent très modestes, ce qui peut amoindrir le contraste entre ruraux et urbains.
- 5
Lire à ce sujet Cécile Vachée, Christophe Dansac et Sophie Ruel, « Invisibilité des jeunes en milieu rural, comment les “jeunes sans Cité” “s’en sortent” ? : Effet des pratiques de citoyenneté sur la mobilité géographique et la reconnaissance sociale », Vie sociale n° 29, 2020.