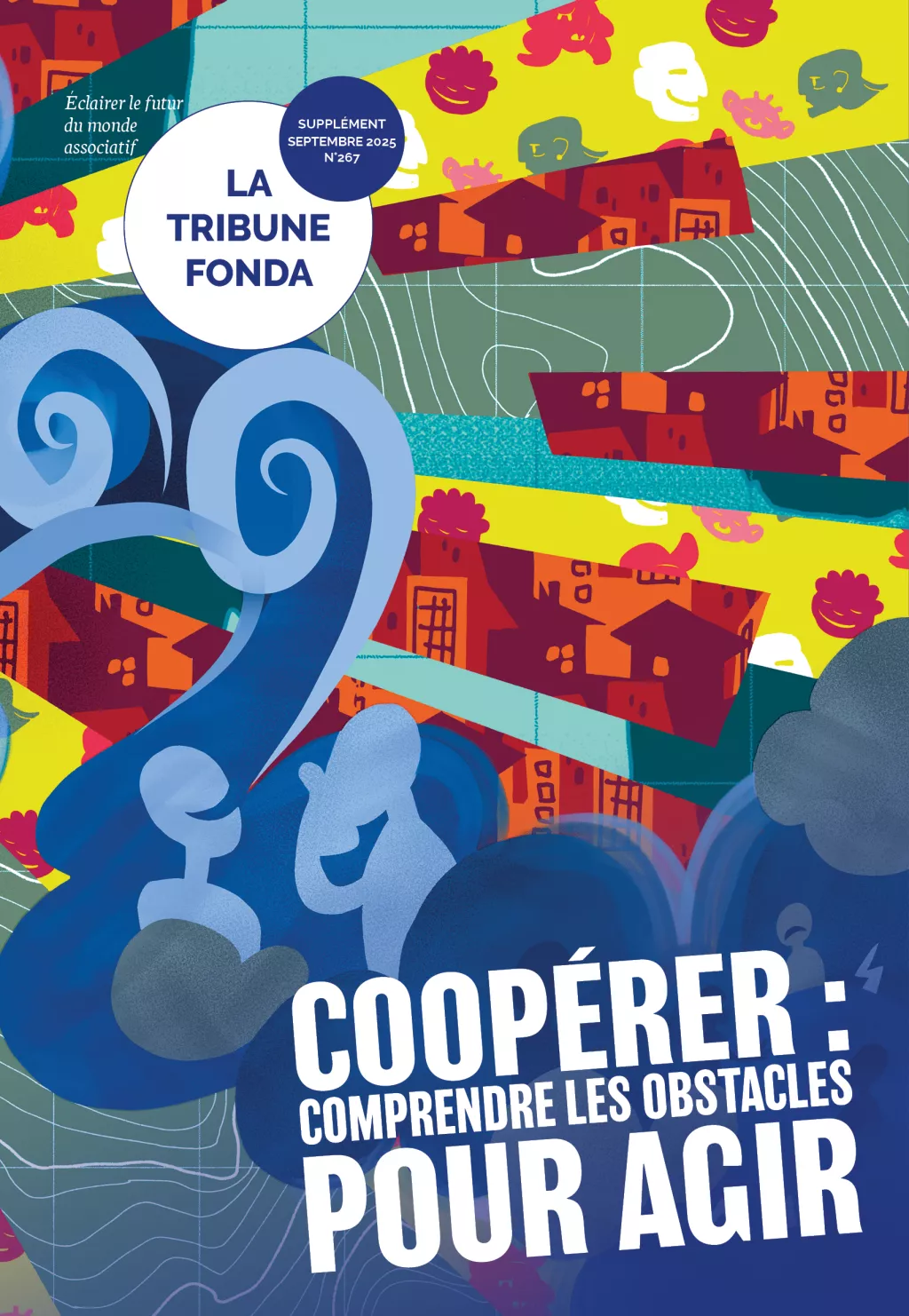Le secteur de la solidarité internationale est profondément marqué, dans ses pratiques, par le recours à la gestion axée sur les résultats, dont le cadre logique est l’instrument le plus emblématique. Concrètement, dès la conception du projet ou de l’action, il s’agit de déterminer l’ensemble des ressources nécessaires à la réalisation d’activités, censées permettre d’atteindre des objectifs à court ou moyen terme.
Mais l’expérience des organisations de solidarité internationale s’est rapidement heurtée aux limites de ce modèle. C’est la raison pour laquelle le F3E a développé, depuis 2014, les « approches orientées changement » (AOC). Celles-ci constituent un ensemble d’outils et de méthodes1 pour planifier, suivre et évaluer des actions dont le but est d’accompagner des processus de changement.
Au-delà de la méthodologie, elles invitent les actrices et acteurs impliqués à s’interroger sur leur vision d’un futur commun et sur leurs positions respectives.
Expérimentées depuis plus de dix ans au travers de quatre programmes par le F3E et ses membres, ces approches visent à dépasser les limites du cadre d’intervention traditionnel par une approche résolument coopérative.
Il s’agit à la fois de faire commun, c’est-à-dire de créer les conditions favorables à la mise en œuvre d’une dynamique collective, mais aussi d’apprécier les changements auxquels cette dynamique contribue, en faisant du suivi-évaluation différemment.
Partager une lecture commune de la situation
Les approches orientées changement (AOC) mettent l’accent sur l’analyse du contexte, et notamment des jeux d’acteurs, en se concentrant sur l’analyse des situations et dynamiques relationnelles.
Lorsque l’on évoque les « acteurs et actrices », on parle potentiellement à la fois d’individus, de groupes, de communautés et d’organisations. Les AOC proposent un vaste ensemble d’outils et de méthodes permettant d’identifier, cartographier, positionner les acteurs et actrices par rapport au projet ou à l’action entreprise, et de mieux penser leurs liens avec celui-ci, ou entre-elles et eux.
Les AOC laissent une large place à l’analyse territorialisée et permettent également de mieux penser les rapports de force et les antagonismes entre acteurs et actrices, notamment sur les relations de pouvoir et les dynamiques de genre.
Au-delà de la nécessité de mieux comprendre le contexte dans lequel se déploie l’action, cet exercice d’analyse collective a également pour objectif de contribuer à créer une compréhension commune, de mieux expliciter les positionnements des uns, des unes et des autres et à permettre de mesurer les différences de perceptions entre partenaires.
Se projeter ensemble
Les AOC se caractérisent également par la définition collective d’une vision de changement.
Une vision de changement est une représentation claire et partagée de l’avenir souhaité par un groupe d’acteurs et d’actrices concernés à l’échelle d’un territoire, d’une organisation, d’un projet ou d’une initiative collective.
Elle dépeint un tableau inspirant de ce à quoi le groupe souhaiterait aboutir, à un horizon de cinq ou dix ans, voire davantage.
Cette démarche permet de mobiliser les acteurs et les actrices, renforçant leur capacité à agir dans la construction d’un avenir souhaitable. Il ne s’agit pas de répondre à un problème ou à un besoin, comme le fait souvent le cadre logique.
La vision permet de sortir des contraintes du court terme.
Elle crée une compréhension partagée des objectifs et motive les équipes et les partenaires. Elle permet aussi d’impliquer, par exemple, les communautés concernées par les projets.
Là encore, l’objectif n’est pas seulement de se doter d’une vision partagée, mais de redonner du sens, créer du commun, de contribuer à ce que se développe une dynamique collective, sans pour autant effacer les différences de positionnement entres partenaires.
Apprécier le changement autrement : Sortir du tout quantitatif
Le cadre logique prévoit de mesurer l’atteinte des objectifs par des indicateurs objectivement vérifiables. Ceux-ci sont bien souvent envisagés sous un angle purement quantitatif : on dénombre.
Or, cette perspective ne suffit pas, dans bien des cas, à attester des changements à l’œuvre. De nombreux projets et programmes ont pour but de susciter des changements difficilement réductibles à l’atteinte d’un objectif fixé à l’avance.
On peut ici penser par exemple à l’ensemble des actions visant à susciter des changements de comportement, de mentalité ou de façon de travailler en collectif. Chaque acteur ou actrice évolue de manière singulière et progressive, selon des petites étapes parfois difficiles à discerner. Suivre les changements d’un acteur ou d’une actrice revient à se questionner sur ces « petits pas ».
Chaque acteur ou actrice d’un programme porte une connaissance expérientielle ou située, liée à son expérience, à sa propre perception de ce qui change et à sa propre appréciation des changements.
Il importe donc de croiser les points de vue sur une situation. Le suivi-évaluation orienté changement est résolument qualitatif et laisse une large place à l’analyse collective des changements, au travers d’ateliers par exemple. Bien entendu le fait de faire le récit, collectivement, de ce qui change, n’interdit pas de se pencher sur d’autres sources de données disponibles afin de corroborer ou invalider les changements observés.
Changer de perspective sur les effets et impacts
Le suivi-évaluation orienté changement ne se distingue pas seulement d’un suivi-évaluation plus classique par l’usage d’outils et méthodes spécifiques, mais également par une façon différente d’envisager la causalité.
La causalité c’est le rapport entre une cause et un effet : si l’on pousse un domino, il fait chuter le suivant, et ainsi de suite. Le cadre logique, comme la gestion axée sur les résultats qui le sous-tend, s’inscrit dans une vision de la causalité très linéaire : une action donnée va engendrer un résultat donné.
Les approches orientées changement, elles, proposent un autre rapport à la causalité : une action s’inscrit dans un contexte, un ensemble de jeux d’acteurs et d’actrices, un territoire, une complexité singulière. Dès lors l’action considérée ne peut pas avoir un résultat ou un effet en tant que tel, mais en conjonction avec les autres facteurs.
Le suivi-évaluation orienté changement vise à capter cette complexité, à mieux documenter la façon dont les actions contribuent aux changements plutôt que la façon dont elles les engendrent. Les approches orientées changement ne remplacent pas le cadre logique ou la gestion axée sur les résultats qui demeurent des outils utiles pour écrire des projets, et encore largement promus par les bailleurs de fonds2. Elles les complètent, en pallient certaines limites, en laissant davantage de place à la constitution de dynamiques collectives et en proposant une façon différente de documenter les changements auxquels contribue l’action menée.
Il est essentiel de donner à voir tous les atouts d’une telle démarche, notamment dans un cadre budgétaire contraint3. Car si la mise en œuvre des approches orientées changement a un coût immédiat, elles permettent également de pérenniser l’intervention et de mieux comprendre les changements réellement à l’œuvre sur le long terme.
- 1
On peut citer parmi les diverses sources d’inspiration des AOC la récolte des effets, la cartographie des incidences, le changement le plus significatif ou encore la théorie du changement. Les AOC ont également beaucoup en commun avec les méthodes de « Faire ensemble » proposées par la Fonda.
- 2
Et ceux-ci évoluent aussi dans leur rapport au cadre logique, voir à ce sujet l’échange organisé le 23 janvier 2024 par le F3E « Redevabilité et AOC un mariage impossible ? Parole aux bailleurs ! ».
- 3
Retrouvez 45 fiches pratiques sur les approches orientées changement dans l’ouvrage Les approches orientées changement publié par le F3E en avril 2025, ainsi que l’ouvrage Le changement à notre portée, paru dans la collection « Les essentiels du F3E » en novembre 2022.