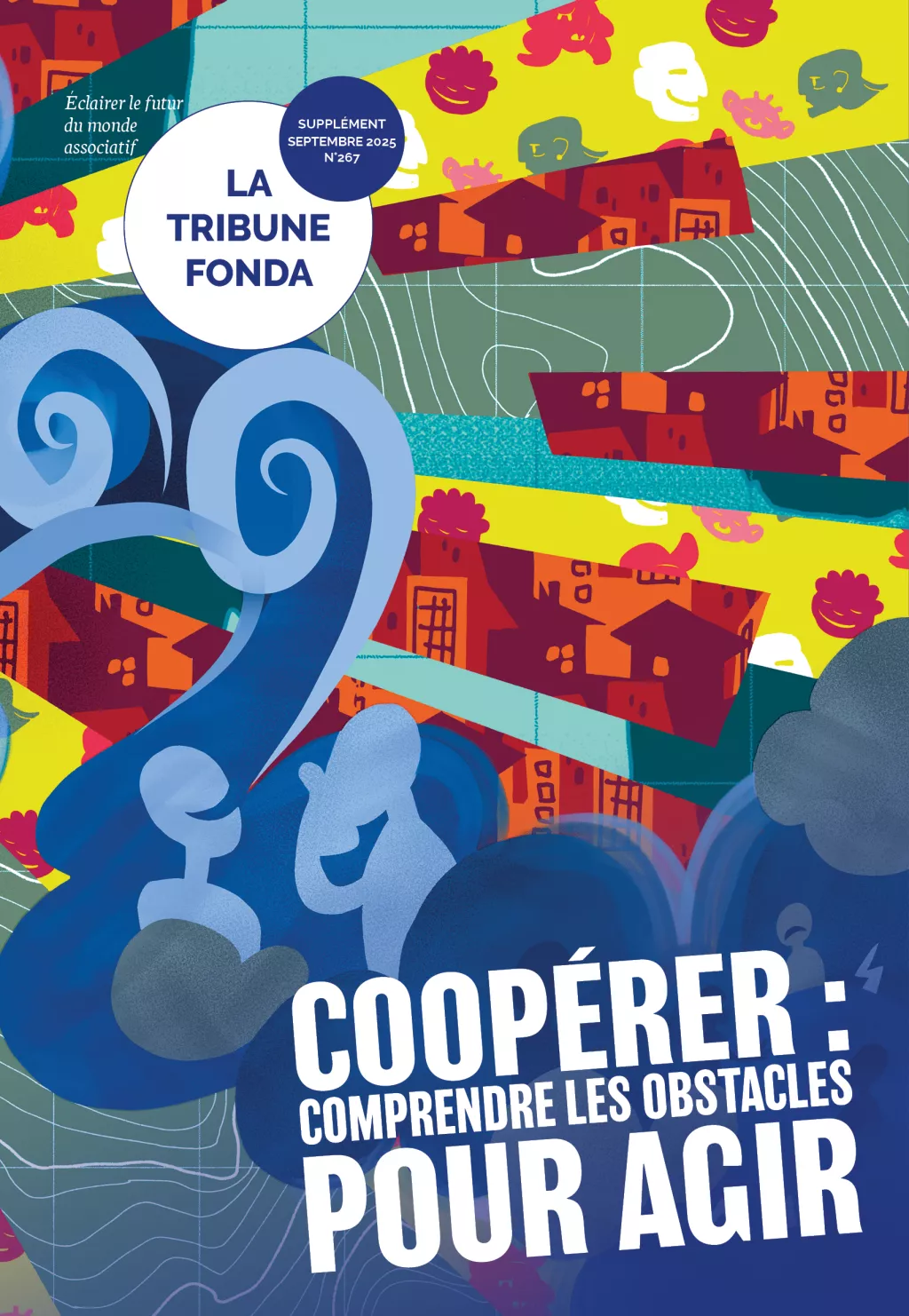Accompagner à coopérer
Accompagner à coopérer, c’est aider les acteurs d’un territoire à construire un cadre commun de dialogue, de travail et d’apprentissage mutuel.
Cela suppose de reconnaître la diversité des parties prenantes (élus, techniciens, bénévoles, habitants, partenaires privés, etc.), leurs contraintes spécifiques, mais aussi leurs complémentarités.
C’est également faire en sorte que les premiers concernés, notamment les jeunes, les publics précaires, les habitants des quartiers populaires, aient toute leur place dans ces démarches.
Pour mieux explorer ce rôle d’animation des coopérations, le Réseau national des Maisons des associations (RNMA) et la Fonda ont lancé depuis 2022 une expérimentation concrète dans deux territoires.
Coopérer d’est en ouest
À Mulhouse, la communauté d’action accompagnée par le Carré des associations de la ville, une maison des associations municipale, s’est constituée autour de l’engagement de la jeunesse.
Sept structures partenaires ont mené une consultation auprès de 108 jeunes pour mieux comprendre leurs envies, leurs freins et leurs visions. Ce diagnostic partagé a permis d’élaborer collectivement une feuille de route, visant à structurer un parcours d’engagement et soutenir leur insertion sociale et professionnelle. L’enjeu est autant d’accompagner les jeunes que d’aider les acteurs à travailler ensemble à partir du point de vue des jeunes.
À Morlaix, le travail porté par un collectif de trois structures d’appui1 s’est concentré sur la transition écologique et alimentaire. Là aussi, la coopération a réuni une pluralité d’acteurs pour réfléchir ensemble à la façon de relier les initiatives existantes, d’impliquer les citoyens dans les décisions qui les concernent et de construire une vision partagée de la transition à l’échelle locale. Cela a donné lieu à des déclinaisons concrètes telles qu’un projet de sécurité sociale de l’alimentation.
Dans les deux cas, les maisons des associations ont joué un rôle central : animation, facilitation, mise en récit, structuration du cadre commun.
Elles ont permis que les différents mondes se rencontrent et qu’un véritable processus de coopération se mette en place.
Ce rôle de médiateur entre les mondes est désormais pleinement intégré dans la conception collective du métier d'Accompagnateur de la vie associative locale (AVA). Être AVA, c’est à la fois accompagner individuellement, animer collectivement et connecter les dynamiques associatives aux stratégies territoriales.
Pour prolonger ces dynamiques, la communauté « Rendez-vous en terres communes » réunit depuis janvier 2025 des structures souhaitant développer ou renforcer leur fonction de soutien à la coopération territoriale. Elle propose un site ressource2 avec outils, des rencontres régulières entre pairs et un futur cycle de formation pour les professionnels et professionnelles de l’accompagnement.
Coopérer pour accompagner
Accompagner des associations, c’est naviguer entre plusieurs enjeux : structuration interne, lien au territoire, reconnaissance institutionnelle, sécurisation économique, mise en réseau, transition numérique ou écologique, etc. Cela implique de créer les conditions de la reconnaissance du secteur associatif par les institutions, de faire le lien avec les dispositifs de politique publique, de relayer ses préoccupations dans les espaces de décision.
Ces enjeux mobilisent des compétences, ressources et réseaux répartis au sein d’un écosystème local composite : maisons des associations, collectivités, têtes de réseaux, dispositifs publics, centres de ressources, fondations, universités. Pour répondre aux besoins des associations, ces acteurs doivent se penser comme un collectif d’accompagnement, capable de proposer une réponse coordonnée, lisible et ajustée. C’est tout un changement de posture : passer de l’offre à la stratégie partagée, de la juxtaposition à l’interdépendance.
Ce mouvement, de plus en plus visible dans les territoires, fait émerger de nouvelles pratiques de coopération entre structures d’appui.
La politique publique nationale Guid’asso, co-construite avec les têtes de réseau associatives, témoigne de la prise en compte de ce mouvement. En favorisant la mise en réseau d’acteurs, son déploiement sur les territoires a permis de clarifier les offres, d’établir des référentiels communs et de formaliser des circuits d’orientation.
Au-delà des outils, Guid’asso agit comme un levier de structuration partenariale. Là où la coopération est réelle, elle permet d’organiser collectivement les réponses à apporter aux associations, en tenant compte des enjeux d’inclusion, d’équité d’accès aux ressources et d’ancrage territorial.
La coopération entre structures d’appui permet aussi d’influencer la manière dont les politiques publiques se construisent localement. Dans de nombreuses communes, les Conseils locaux de la vie associative (CLVA) sont des espaces où acteurs associatifs et collectivités dialoguent sur les priorités, les moyens, les critères d’éligibilité, mais aussi sur les visions de l’engagement à porter collectivement.
Ces espaces permettent la coconstruction des orientations locales, la reconnaissance des spécificités associatives et la consolidation des conditions de l’engagement.
Plutôt que la méfiance du Contrat d’engagement républicain (CER), certains territoires ont ainsi choisi de tisser la confiance au travers de la Charte d’engagements réciproques (CER), qui vient formaliser les valeurs partagées et les responsabilités mutuelles entre collectivités et tissu associatif.
Ces démarches participent d’un mouvement plus large : faire en sorte que les décisions ne soient pas uniquement prises pour les associations, mais aussi avec elles, dans une logique de démocratie locale active.
- 1
Le Résam, l’ULAMIR-CPIE et le pôle ESS du Pays de Morlaix.
- 2
Disponible en ligne à l’adresse communautes-action.rnma.fr