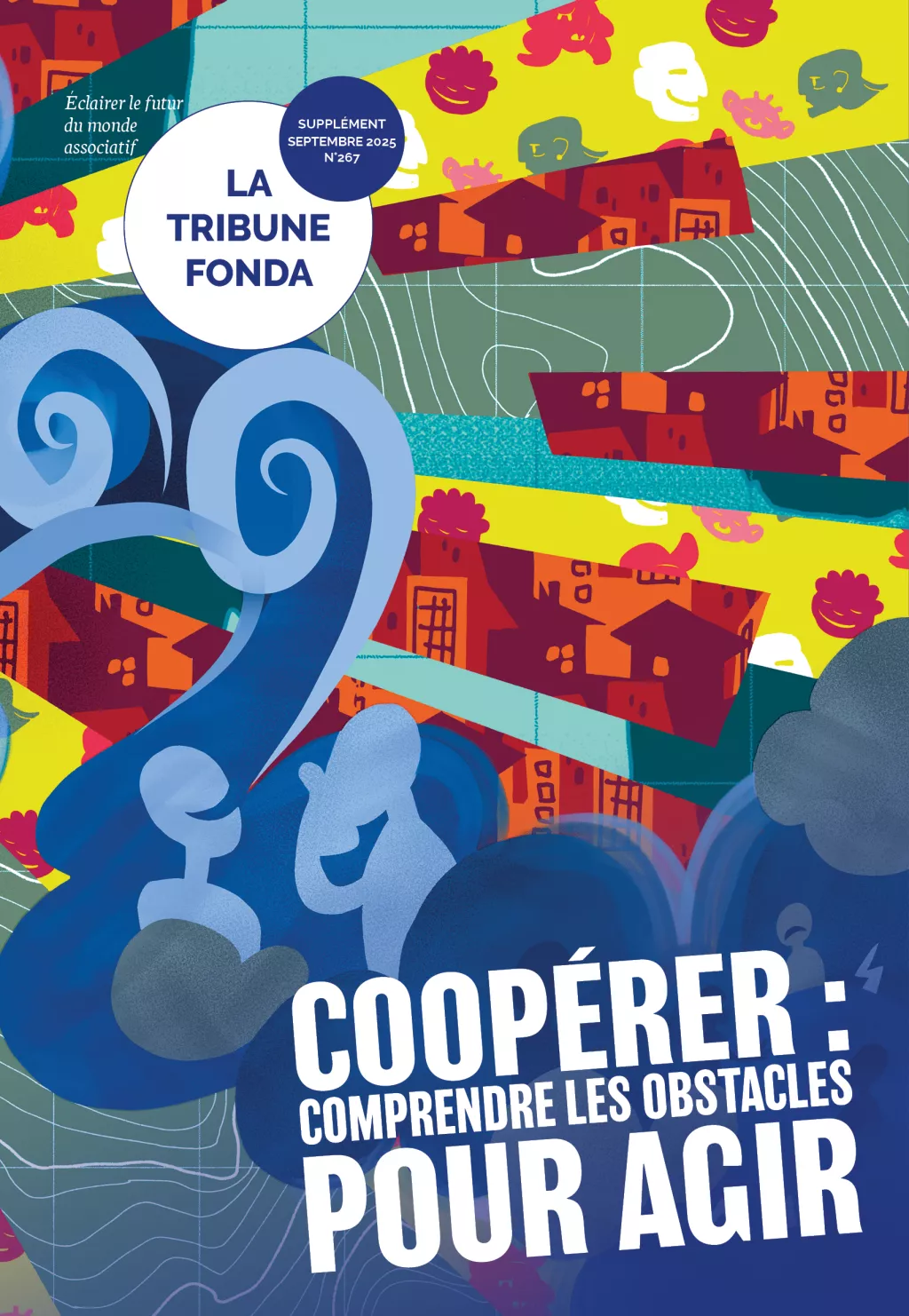Une coopération pour sortir de l’impasse
Convaincue qu’une politique d’intégration par l’accès à l’emploi de l’ensemble des personnes migrantes constitue un vecteur de cohésion sociale, la Fédération de l’entraide protestante (FEP) a initié une expérimentation facilitant l’accès légal au travail de personnes dites « en situation irrégulière ».
Le dispositif vise à rompre le cercle néfaste dans lequel sont maintenues les personnes sans papier, dont certaines ne sont ni régularisables ni expulsables, privées de tout revenu ou contraintes à exercer illégalement un emploi.
Pour transformer cette impasse en cercle vertueux, la FEP développe une approche basée sur un partenariat multiacteurs, ancrée sur les territoires.
Pour ce faire, des consensus locaux au niveau de l’agglomération ou du département sont établis avec l’ensemble des parties prenantes du champ de l’emploi et de l’insertion socioprofessionnelle.
Les consensus locaux sont structurés autour de l’intérêt de chaque acteur à résoudre une problématique commune : des structures employeuses confrontées à une pénurie de main-d’œuvre, des personnes sans papier exprimant un besoin d’insertion dans la société à travers l’accès légal au travail et des acteurs du monde du travail et de l’insertion souhaitant lutter contre le travail irrégulier.
Chaque organisation est rencontrée individuellement pour identifier l’intérêt qu’elle peut en retirer, les contraintes et limites en termes de mobilisation ou encore les besoins d’adaptation du dispositif pour chaque territoire. Par la suite, dans le cadre de la participation à une conférence de consensus, la détermination des obstacles à lever est endossée collectivement ainsi que les modalités d’un plaidoyer commun à l’égard des autorités locales.
Vers des coopérations ancrées et transformatrices
Ces coalitions interacteurs, mises en œuvre sur plus de cinq territoires, ont rassemblé des associations d’aide aux personnes migrantes ou au public en situation de précarité, des représentants du milieu économique, des partenaires sociaux comme les syndicats d’employés et les organisations patronales ou encore des personnes premières concernées.
La logique d’interaction a progres- sivement évolué pour les territoires ayant obtenu un cadre de discussion constructif avec les autorités, en espace de coopération où chaque acteur développe une forme d’engagement réciproque. Les intérêts propres ne sont pas oblitérés, mais ils se structurent autour d’un objectif commun de transformation durable.