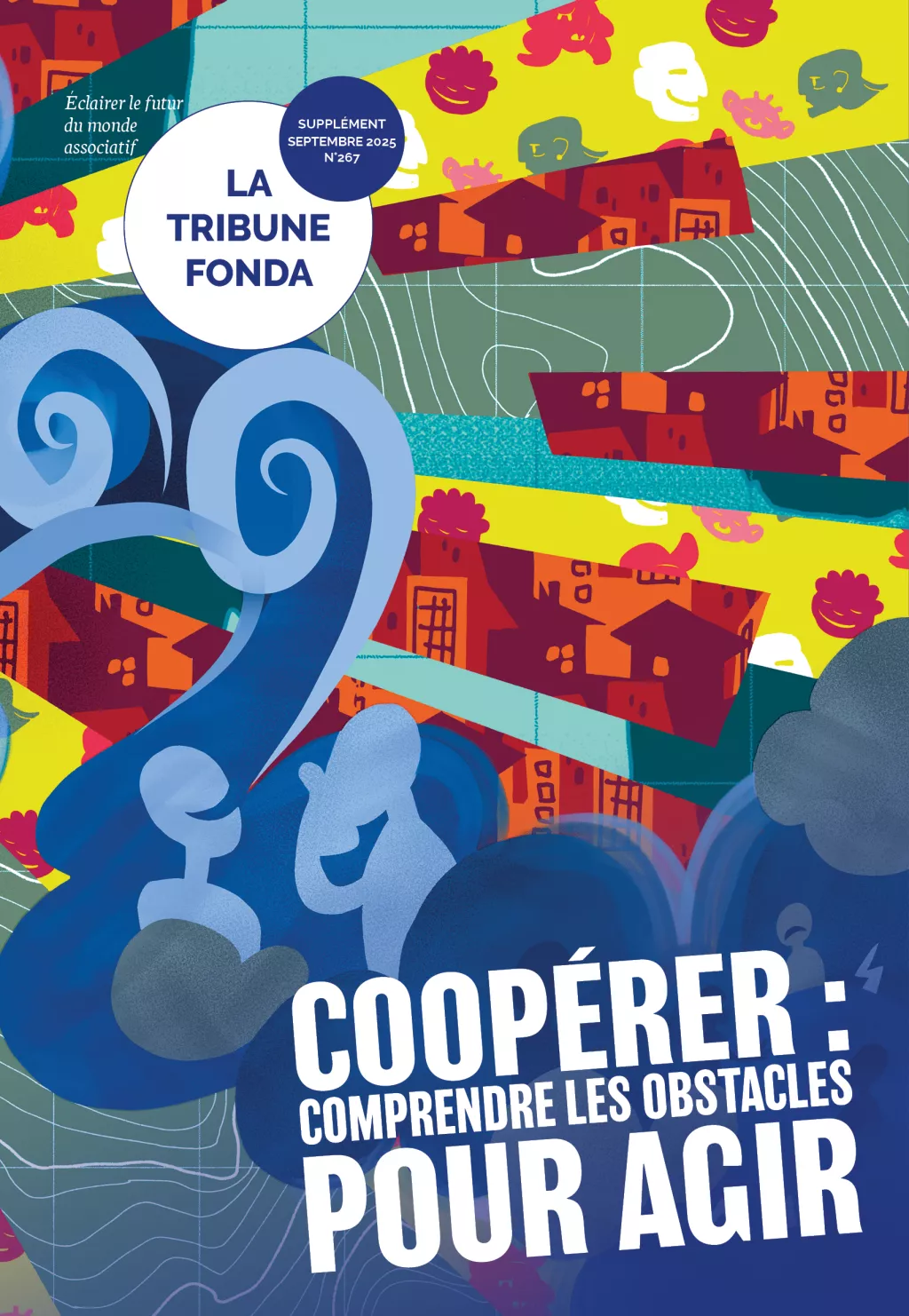À l’heure des grandes transitions écologiques, démocratiques et sociales, la coopération apparaît comme une nécessité impérieuse. Pourtant, une difficulté demeure : on appelle aujourd’hui à coopérer alors que nos sociétés valorisent principalement la concurrence et la compétition, au point que personne ne sait plus ce que coopérer veut dire, et que chacun croit coopérer en participant à un projet collaboratif.
Trop souvent, la coopération est réduite à des procédures et des outils, alors qu’elle relève avant tout d’un art du faire ensemble — un art exigeant, ancré dans le réel, dans le geste.
Comme pour tout artisan, ce n’est pas l’outil qui fait la qualité de l’œuvre, mais le geste de celui ou celle qui l’utilise. Apprendre à coopérer, c’est adopter un comportement durable et inconditionnel, un ensemble de gestes ajustés, attentifs, conscients, que chacun peut développer, transmettre et enrichir tout au long de sa vie.
Un concept issu de l’expérience vécue
C’est cette conviction et cette exigence qui ont guidé le protocole d’action-recherche de l’Observatoire de l’implicite : sept itinérances pédestres, en immersion profonde dans la réalité de terrain d’une centaine de collectifs qui ont permis, par une mise en dialogue entre les acteurs à partir de leurs gestes quotidiens de la coopération, de conceptualiser leurs pratiques vécues.
Loin d’un modèle théorique, la « maturité coopérative » n’est pas une prescription, mais un cadre d’intel- ligibilité pour mieux comprendre ce qui rend une coopération vivante, durable et féconde.
Nous avons rencontré des collectifs variés : citoyens, économiques, associatifs, institutionnels ou de simples collectifs de voisins… Partout, les mêmes tensions, les mêmes élans, les mêmes risques de fragmentation. Mais aussi les mêmes ressources invisibles, les mêmes gestes discrets, qui patiemment, tissent des dynamiques coopératives pérennes.
La maturité coopérative désigne la capacité d’une personne, d’un collectif, ou d’un territoire, à entretenir des aptitudes coopératives durables et inconditionnelles. Elle ne se décrète pas. Elle requiert un changement fondamental : passer d’une logique d’objectifs à attein- dre à une logique d’œuvre commune à construire, ensemble. « On collabore pour faire, on coopère pour apprendre. »1
Elle repose sur un travail d’attention au vivant, une disposition à l’altérité, une capacité à agir ensemble sans que les enjeux de pouvoir, d’ego, d’accélération, ou de résultat viennent fragiliser la dynamique commune.
Elle engage à faire de la coopération un espace de transformation pour soi, pour les autres et pour le territoire dans lequel on s’inscrit. Cette maturité ne s’atteint pas une fois pour toutes. Elle se cultive, s’évalue, se consolide, comme un sol vivant que l’on enrichit au fil des saisons.
Une grammaire pour déclencher les mécanismes du processus coopératif
La maturité coopérative repose sur trois piliers : des fondamentaux humanistes, des principes d’action dialogiques et des temps qui nourrissent le processus coopératif. Ensemble, ils constituent une grammaire pour déclencher les mécanismes au cœur du processus coopératif.
Le premier pilier repose sur cinq fondamentaux, comme le fait de reconnaître que la coopération se joue entre des personnes singulières, et non entre des fonctions ou des organisations. Cela suppose de reconnaître l’autre dans sa singularité et ses subjectivités, avec ses émotions, ses valeurs, ses contradictions.
Coopérer, c’est établir un rapport sensible, humain, irréductible à des logiques d’intérêt ou de performance.
C’est aussi reconnaître la légitimité de chacun à participer, à contribuer au sens, à co-construire l’œuvre commune.
Le deuxième pilier est constitué des principes d’action dialogiques. Inspirés de la pensée dialogique d’Edgar Morin2, ils nous invitent à maintenir vivantes des tensions fécondes : entre ordre et désordre, entre question et réponse, mais aussi entre pensée et action.
Ces principes ne sont pas des règles figées, mais des repères pour agir dans la complexité, sans céder à la tentation de la simplification. Ils permettent de tenir ensemble les logiques à l’œuvre, de reconnaître que la coopération n’élimine pas les conflits, mais apprend à les habiter — l’art de vivre dans le désaccord dont parle Richard Sennett3.
Ces principes nous invitent à ne pas fuir l’ambiguïté, mais à la traverser avec lucidité. C’est par cette dynamique dialogique que le collectif apprend, grandit, s’humanise.
Le troisième pilier est celui des neuf temps du processus coopératif. Ces temps — mise en disponibilité, entretien du lien, fixation du cadre, introspection et partage… — balisent le chemin de tout collectif qui souhaite faire œuvre commune. Ils ne constituent pas une méthode à suivre de manière linéaire, mais un ensemble de moments à reconnaître, à habiter, à ritualiser parfois.
Connaître ces temps, c’est apprendre à lire les signaux faibles de la dynamique d’un groupe, à ajuster ses gestes, à écouter les tensions. C’est devenir plus lucide sur les mécanismes de l’agir ensemble.
Une ressource pour les territoires
Le « corpus maturité coopérative » est une ressource pour les territoires qui souhaitent développer leur maturité coopérative territoriale, accessible à tous4.
Le protocole de l’Observatoire de l’implicite par exemple permet de révéler les dynamiques coopératives existantes, souvent invisibles parce qu’informelles, éparses, dispersées. Il aide les acteurs à identifier les gestes fertiles, à comprendre les points d’appui et les fragilités, à développer leur propre maturité, sans imposer de modèle extérieur. Il ne s’agit pas de prescrire, mais d’éclairer, d’accompagner, de renforcer ce qui est déjà là.
Les territoires qui investissent pour faire de la maturité coopérative une compétence territoriale en voient les effets : montée en qualité des relations, amélioration de la capacité à traverser les conflits, renforcement de l’estime réciproque entre acteurs, développement de la confiance, partage du leadership et de l’expertise, coopération ouverte, épanouissement des individus.
La coopération nous rend pédagogues les uns pour les autres, c’est la raison pour laquelle ces territoires sont plus résistants et voient l’émergence de plus d’initiatives, pérennes et inspirantes.
Appliquée aux dynamiques territoriales, la maturité coopérative devient ainsi une véritable ressource stratégique pour affronter les crises, soutenir les transitions et inventer ensemble des réponses ancrées et durables.
Vers un apprentissage collectif du geste coopératif
La maturité coopérative ne vise pas l’efficacité immédiate, mais la fécondité. Elle invite à prendre le temps nécessaire, à affiner ses comportements, à reconnaître que c’est la qualité du lien qui fonde une coopération véritable.
Comme pour un artisan, c’est dans la répétition, la transmission, l’expérimentation que ce geste se construit. La finalité n’est pas d’atteindre une perfection, mais de rendre chaque personne plus consciente et plus compétente dans sa manière de se développer et de contribuer au collectif.
Elle ouvre un chemin exigeant, mais profondément vivant, pour que les territoires deviennent non pas seulement des espaces de coordination, mais des milieux de vie où la coopération est vécue comme une source d’accomplissement et d’émancipation pour chacune et chacun, et de transformation pour toutes et tous.
- 1
Éloi Laurent, L’Impasse collaborative, Les liens qui libèrent, 2021.
- 2
Lire à ce sujet Edgar Morin, Introduction à la pensée complexe, ESF Éditeur, 1990.
- 3
Richard Sennett, Ensemble. Pour une éthique de la coopération, Albin Michel, 2014.
- 4
Le corpus méthodologique de l’Institut des Territoires Coopératifs (InsTerCoop) est publié sous licence CC BY-SA 4.0