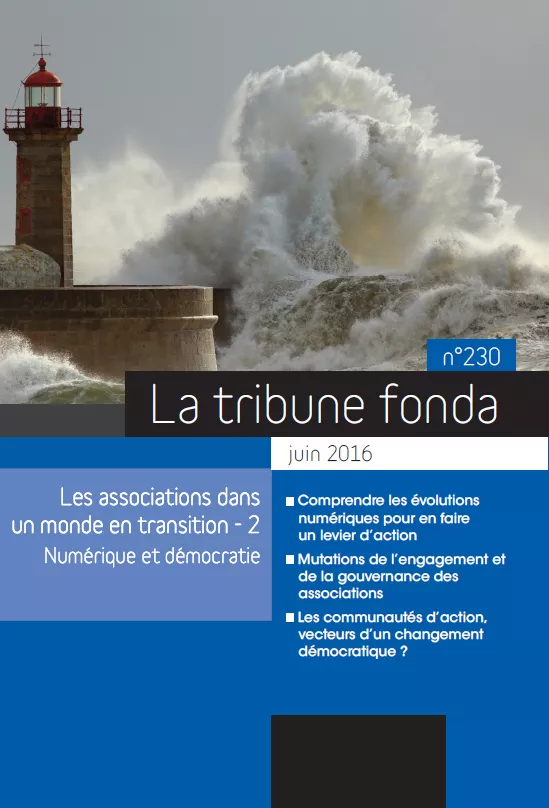Une démocratie en crise ?
À la fin du siècle, l’événement majeur qu’a constitué la chute du mur de Berlin en 1989 a souvent été considéré comme le triomphe de la démocratie. Aujourd’hui, alors même que la vitalité de la revendication démocratique demeure très vigoureuse dans les pays où elle est solidement installée, le constat s’impose de citoyens en proie à un malaise profond. Il est probable que les conséquences actuelles des événements extérieurs telles les interventions militaires occidentales en Afghanistan, Irak ou Libye, pour mettre à bas des régimes dictatoriaux et promouvoir la démocratie, ont contribué à instaurer un doute profond au sein de nos populations qui ont pu le manifester par un refus croissant des urnes.
Mais ce malaise, qu’il se traduise par l’abstention électorale, la perte de confiance dans les institutions, voire la méfiance des citoyens vis-à-vis de la classe politique, ou encore par la montée des extrêmes et l’impuissance politique de l’État…, n’aurait-il pas des causes plus profondes ? Il ne saurait en effet se réduire à ces phénomènes préoccupants que l’on observe depuis le début du XXIe siècle, qui ne sont vraisemblablement que la partie visible de l’iceberg.
Pour Marcel Gauchet : « … le fait que la démocratie n’a plus d’ennemis déclarés ne l’empêche pas d’être travaillée par une adversité intime, qui s’ignore pour telle, mais qui n’en est pas moins tout aussi redoutable dans ces effets. » Pour lui c’est le « sentiment de dépossession et d’impuissance… un divorce entre la liberté et le pouvoir » qui est au cœur du malaise .
De la liberté au collectif
En effet, si par démocratie nous entendons qu’elle est cette organisation politique et sociale qui assure deux choses complémentaires et inséparables, la première, les libertés privées des personnes, leurs droits et leurs garanties ; la seconde, la capacité collective à agir pour le bien commun, c’est l’équilibre au sein de cette dualité que la démocratie n’arrive pas à assurer aujourd’hui.
Il est vrai que, pendant des décennies, pour intervenir dans l’espace institutionnel, la politique avait installé la primauté de l’organisation collective sur l’individu, bien que celui-ci – en tant qu’électeur – restait à la base de la démocratie. Aujourd’hui, c’est l’adhésion à ces organisations collectives de nature politique qui est fortement récusée, notamment par les jeunes ; et on observe simultanément que la liberté confortée par des valeurs individualistes portées par une économie de marché n’a jamais été autant revendiquée, y compris pendant la période dramatique que traverse la société française depuis les événements tragiques du 13 novembre 2015.
Dans la mesure où cette liberté n’a pas rompu ses chaînes avec l’individualisme, la revendication de liberté et d’autonomie de l’individu telle que nous la percevons aujourd’hui, constitue un véritable frein à la construction d’un projet collectif.
Car, la démocratie suppose que la liberté, non seulement ne s’oppose pas au « collectif », mais qu’elle conduise à la volonté d’agir pour le bien commun, qu’elle irrigue l’action collective.
Deux phénomènes opposés s’observent aujourd’hui.
– Nous constatons d’abord, de la part de nos contemporains, une perception négative des institutions politiques, ainsi qu’une profonde mutation de l’individu autonome, qui se détourne des corps intermédiaires - syndicats, partis politiques - pour se réfugier dans sa vie privée et son immédiate proximité. C’est le triomphe d’un individualisme épicurien , conséquence d’un affaiblissement des croyances, qui efface les idéologies au profit d’un vide massivement comblé par des jouissances matérielles et individuelles . C’est ce qui explique que l’on soit le plus souvent témoins d’une définition tronquée de la démocratie qui ne désigne plus que la garantie des libertés privées.
Si à cela se superpose l’image que se font beaucoup de citoyens d’un corps politique qui se détache de plus en plus de la société par un phénomène d’entre soi, d’un État dont on ne perçoit pas qu’il donne sens et efficacité à l’action et à la décision publique, qui n’est plus perçu comme protecteur, on comprend que ce détournement de la chose publique n’est pas le produit d’une liberté qui façonnerait notre destin collectif .
– Pour autant, on ne peut pas généraliser l’apathie politique, ni la désaffection totale des citoyens. Certes, on observe simultanément, au cours des trente dernières années, la figure prépondérante du consommateur qui ne se définit pas par un lien avec autrui, et le foisonnement d’initiatives collectives autour de projets qui font sens pour la société. Ce qui fait dire à Pierre Rosanvallon que nous assisterions moins à un déclin qu’à une mutation de la société qui s’organise surtout autour de ce qu’il nomme un principe de défiance.
Or, cette défiance, principalement celle des institutions et des pouvoirs, produit ce qu’on observe aujourd’hui, le populisme dévalorisant la sphère politique : c’est le « tous pourris ». Mais elle revêt aussi une dimension démocratique en tant que manifestation des exigences des citoyens vis-à-vis de ces pouvoirs.
Parce que la démocratie ne se résume ni à la Constitution ni même aux élections, qu’elle est aussi un mode de vivre ensemble, une manière particulière d’organiser un monde commun, l’associationnisme qui regroupe une multitude de formes d’implication des citoyens est l’une des composantes du possible renouveau démocratique souhaité. C’est ce que Rosanvallon appelle la démocratie-société.
Le défi associatif
La liste est infinie des mobilisations de concitoyens qui définissent de nouveaux espaces que les instances du politique délaissent, faute de savoir les appréhender, mais où se joue pourtant notre avenir : préservation de l’environnement, développement durable, engagements solidaires, réduction des inégalités, droits de l’homme… Ce qui se traduit, lorsqu’on sonde l’opinion des Français sur l’estime dans laquelle ils tiennent différentes institutions publiques ou privées, par un niveau exceptionnel d’adhésion populaire aux associations, alors que s’effondre l’image de toutes les institutions de représentation politiques ou syndicales.
Certes, à elles seules, ces initiatives collectives n’ont pas la capacité de renouveler la démocratie, mais leur participation n’a rien de marginal. On a coutume de dire que les associations sont l’école de la démocratie. Waldeck-Rousseau lui-même n’affirmait-il pas : « L’homme ne peut rien faire en bien ou en mal qu’en s’associant. »
Cependant, ne nous voilons pas la face, si nombre d’associations ont été – ou sont – des réservoirs d’idées pour les contre-pouvoirs nécessaires à toute démocratie vivante, beaucoup d’entre elles, notamment celles qui accompagnent l’action de l’État en délivrant des prestations et qui se laissent instrumentaliser souffrent aussi de désaffection de la part du public, de perte de confiance, moins pour ce qu’elles font que pour ce qu’elles sont. Elles se heurtent aussi au déclin de l’institution , car le lien associatif est fragile.
La référence à un statut ne saurait suffire car il existe aussi un militantisme associatif de l’entre soi. C’est seulement si ce lien est préservé, et qu’il fait l’objet d’un souci constant de la part des associés que l’association comme institution peut être considérée comme un laboratoire pour élaborer des règles d’action collectives favorisant le vivre ensemble. Alors, l’association contribue au renouvellement de la démocratie parce que la figure institutionnelle qu’elle instaure est elle-même démocratique, c’est-à-dire attentive et respectueuse des individus autonomes, et qu’elle promeut par son projet politique une éthique associative de la mise en commun.
Ce qui suppose que le pouvoir de décision s’appréhende d’abord par la façon dont s’élabore la décision et non pas seulement par le contenu de celle-ci. C’est pourquoi, si la démocratie associative prétend jouer un rôle dans le nécessaire renouveau démocratique, sa gouvernance ne saurait se réduire à un vote rituel en assemblée générale.
Il appartient à chaque type d’association d’inventer les modalités de renouvellement du pacte qui lie ses membres, c’est-à-dire le contrat d’association explicité dans le projet associatif en veillant à son appropriation, c’est aussi la condition de sa réactivité collective. C’est parce que l’association aura créé les conditions d’une émancipation des associés participant à l’élaboration des décisions, qu’elle contribuera à la croissance de la demande de citoyenneté dans le champ politique.
Et les nouvelles formes d’organisation collectives…
On aurait tort de limiter l’associationnisme aux organisations traditionnelles, car cela reviendrait à ignorer le foisonnement des adhésions conditionnelles, provisoires ou transitoires qui aboutissent à des formes d’organisations nouvelles, qui ne sont plus des formes stables, des structures bien établies. Ce sont des réseaux ouverts que les individus investissent au gré de leur disponibilité et opportunités, où les engagements individuels se développent aussi bien dans les relations face-à-face au niveau local que sur Internet au plan international.
La flexibilité de ces organisations permet des mobilisations de grande ampleur, elles peuvent être rapides et efficaces. Mais leur force comme leur faiblesse résident dans leur exigence d’authenticité, car elles peuvent se dissoudre ou se morceler rapidement.
L’associatif traditionnel sera-t-il suffisamment attentif à ce phénomène qui prend une grande ampleur, non pour s’y opposer, mais pour y repérer des ressources de citoyenneté qui lui font défaut, pour renouveler ses formes d’organisation et ses modes de fonctionnement ? La contribution associative au défi démocratique ne suppose-t-elle pas un regard lucide et ouvert sur un environnement bouleversé par les nouvelles formes de relations, d’échanges et de communications qui ont la faveur de nos contemporains ?