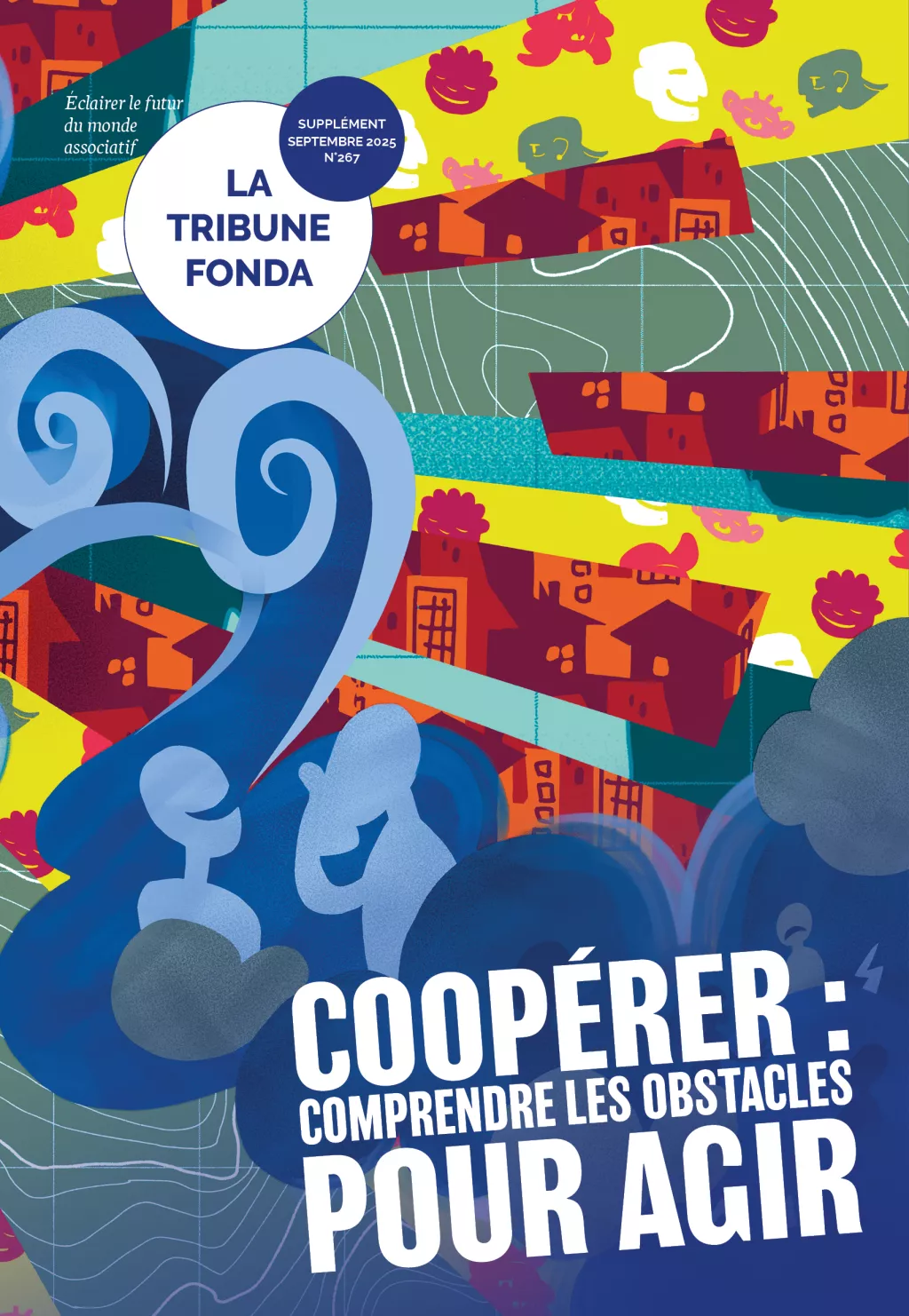Propos recueillis par Bastien Engelbach.
Vos structures, l’ANCT et la CCMSA, agissent respectivement pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les territoires ruraux. Au-delà de leurs différences, ces territoires ont en commun d’être perçus comme délaissés, isolés ou vulnérables. Comment définiriez-vous ces territoires dans leur diversité ?
Christine Duval : Les quartiers prioritaires (QPV) désignent des zones urbaines délimitées géographiquement et correspondent à des concentrations urbaines de pauvreté, identifiées sur la base de critères de revenu et de population.
Pour répondre aux problématiques que rencontrent leurs habitants, les contrats de ville constituent le cadre à travers lequel les partenaires institutionnels et issus de la société civile s’engagent et coopèrent, en mobilisant prioritairement leurs politiques publiques et dispositifs d’intervention.
Si les quartiers prioritaires sont majoritairement des quartiers d’habitat social, ils recouvrent en réalité une grande diversité de territoires et peuvent être implantés tant en périphérie de grandes villes que de villes moyennes, voire correspondre à des centres anciens d’habitat privé.
Myriam Bouzeriba : Les zones rurales sont définies par l’INSEE, qui a révisé leur définition en 2020 sur la base d’un critère de densité. Malgré cette définition, on peut constater des réalités très différentes d’un territoire rural à un autre. Certains sont proches d’un pôle urbain, d’autres sont isolés ; certains ont trouvé un dynamisme économique, par exemple lié au tourisme, alors que d’autres sont en déprise économique.
Toutefois, on peut constater quelques traits communs : des difficultés dans l’accès aux services, une population vieillissante, des problèmes de mobilité. De façon inégale entre les territoires, on y observe l’arrivée de nouvelles populations, notamment des familles qui n’ont pas les moyens de vivre dans des territoires urbains en tension.
Quelles sont les difficultés récurrentes ?
Myriam Bouzeriba : Les territoires ruraux sont marqués par plusieurs facteurs de vulnérabilité : un difficile accès aux services de la vie courante, un vieillissement de la population et des ressources financières moins importantes dans le rural isolé.
Christine Duval : Les populations des QPV sont fragiles et cumulent les difficultés. Elles ont plus difficilement accès aux droits, par manque d’accès physique aux services, mais aussi par manque d’informations. D’où l’importance des démarches d’aller vers.
Les associations, comme les centres sociaux, y occupent à ce titre un rôle central.
Et à l’inverse quels sont les atouts des quartiers prioritaires de la politique de la ville et des territoires ruraux ?
Christine Duval : Les contraintes qui pèsent sur les QPV font qu’à rebours on y observe une forte créativité et le développement d’une économie de la débrouille, une solidarité locale forte et des micro-innovations perpétuelles : jardins partagés, mobilisation bénévole pour le soutien scolaire, organisation de temps conviviaux.
Myriam Bouzeriba : De la même façon, dans les territoires ruraux, les habitants ont envie de prendre en main les choses, de créer par eux-mêmes des solutions.
Dans un contexte de manque, il y a une énergie pour faire par soi-même.
J’ai par exemple accompagné en 2008 une expérimentation de création d’une micro-crèche portée par des parents en recherche de solutions d’accueil pour leurs enfants.
Quelles dynamiques de coopération viennent répondre à ces enjeux ? Comment se construisent-elles ?
Myriam Bouzeriba : Ces dynamiques peuvent émerger d’acteurs locaux, qui vont faire appel à des partenaires institutionnels pour les soutenir. Mais elles émergent également dans le cadre de programmes dédiés. Les MSA portent ainsi les chartes familles et aînés, ou encore le programme Grandir en milieu rural (GMR). Il s’agit de développer des espaces de coopération sur les sujets que traite la MSA, comme le vieillissement, la santé, les familles, et les publics fragilisés, au service du développement social rural. Ce travail se fait en complémentarité avec d’autres acteurs – notamment avec la CAF et ses Conventions territoriales globales (CTG) – autour des projets sociaux de territoire. Il s’adapte aux besoins des territoires, en combinant des apports financiers et des apports de méthode.
Christine Duval : Je ferais un double constat. Le premier est que si les coopérations dans la société civile fonctionnent, il est plus rare de voir des coopérations entre institutions et société civile. Le second est que pour impulser des coopérations de ce type, il n’est pas suffisant de proposer un cadre de concertation tout en laissant la société civile s’en emparer sans accompagnement.
Pour impulser des coopérations, il faut s’appuyer sur les délégués du préfet ou les chefs de service politique de la ville.
En s’appuyant sur ces acteurs, on peut chercher les solidarités existantes et faire équipe ensemble pour le territoire. C’est de ce constat que naît la démarche Quartier à impact collectif, à partir de l’intuition de mettre en dynamique la société civile en y associant le délégué du préfet et la collectivité, dont les rôles sont renouvelés pour en faire des animateurs de dynamiques de territoire, des facilitateurs.
Quelles ressources peut-on mobiliser pour lever les freins à la coopération ?
Christine Duval : Il faut rompre avec certaines habitudes et redéfinir le rôle des professionnels. Cesser de penser de façon globale, par masse, et de vouloir partir du haut pour aller vers le bas. Il faut déployer le pouvoir d’agir des habitants, en prenant appui sur les espaces qui existent déjà comme les comités locaux de la politique de la ville ou les conseils citoyens. Et en y remettant du dialogue avec les acteurs institutionnels !
Myriam Bouzeriba : L’une des principales difficultés est le manque de culture de la coopération. Pour développer la coopération, il faut apprendre à se connaître. Le développement de l’interconnaissance, savoir qui est l’autre, son fonctionnement, ses contraintes, son public, est l’un des principaux leviers de la coopération.
Un autre frein est celui de la complexité des dispositifs, qui exigent une certaine technicité pour être articulés. Bien souvent, chacun vient avec son dispositif ou son appel à projets et pour les faire vivre, il faut décortiquer les sources de financement, vulgariser les fonctionnements. Des professionnels vont pouvoir jouer ce rôle, qui connaissent les ressources et dispositifs, savent quand et comment les mobiliser pour les appliquer à un programme d’action porté collectivement, par exemple un projet social de territoire.
Comment la coopération vient-elle transformer la culture de vos organisations ?
Myriam Bouzeriba : On observe une évolution des modèles d’organisation des caisses pour s’inscrire dans les coopérations territoriales : la mise en place d’un comité territorial pour faire vivre la transversalité, la création de pôles de développement territorial dédiés à la coopération territoriale…
Au niveau national, nous développons le travail commun avec des partenaires tels que la CNAF, la CNAV, et portons des programmes qui donnent des capacités de manœuvre aux territoires, en faisant travailler ensemble associations et institutions et en développant la participation.
Une prochaine étape serait de venir simplifier les dispositifs et programmes, pour consacrer moins de temps à la médiation dans leur appropriation.
Christine Duval : Dans les territoires ruraux ou les QPV, il y a des problématiques qui se répondent. Il n’y a pas de délégué du préfet en ruralité, mais des chargés de programme rattachés à la préfecture, Petites villes de demain par exemple. On observe ainsi l’émergence de postes d’animateur de territoire au niveau de l’État, qui ont à travailler l’application de dispositifs et le lien avec les acteurs, en conjuguant horizontalité et verticalité.
On observe ainsi au niveau de l’État des postures davantage dans la transversalité et on y parle davantage d’animation de réseau.
Pour aller plus loin, nous devons travailler à nous relier davantage entre personnes qui portent ces approches dans tous les ministères, pour faire somme et encourager une reconnaissance institutionnelle.