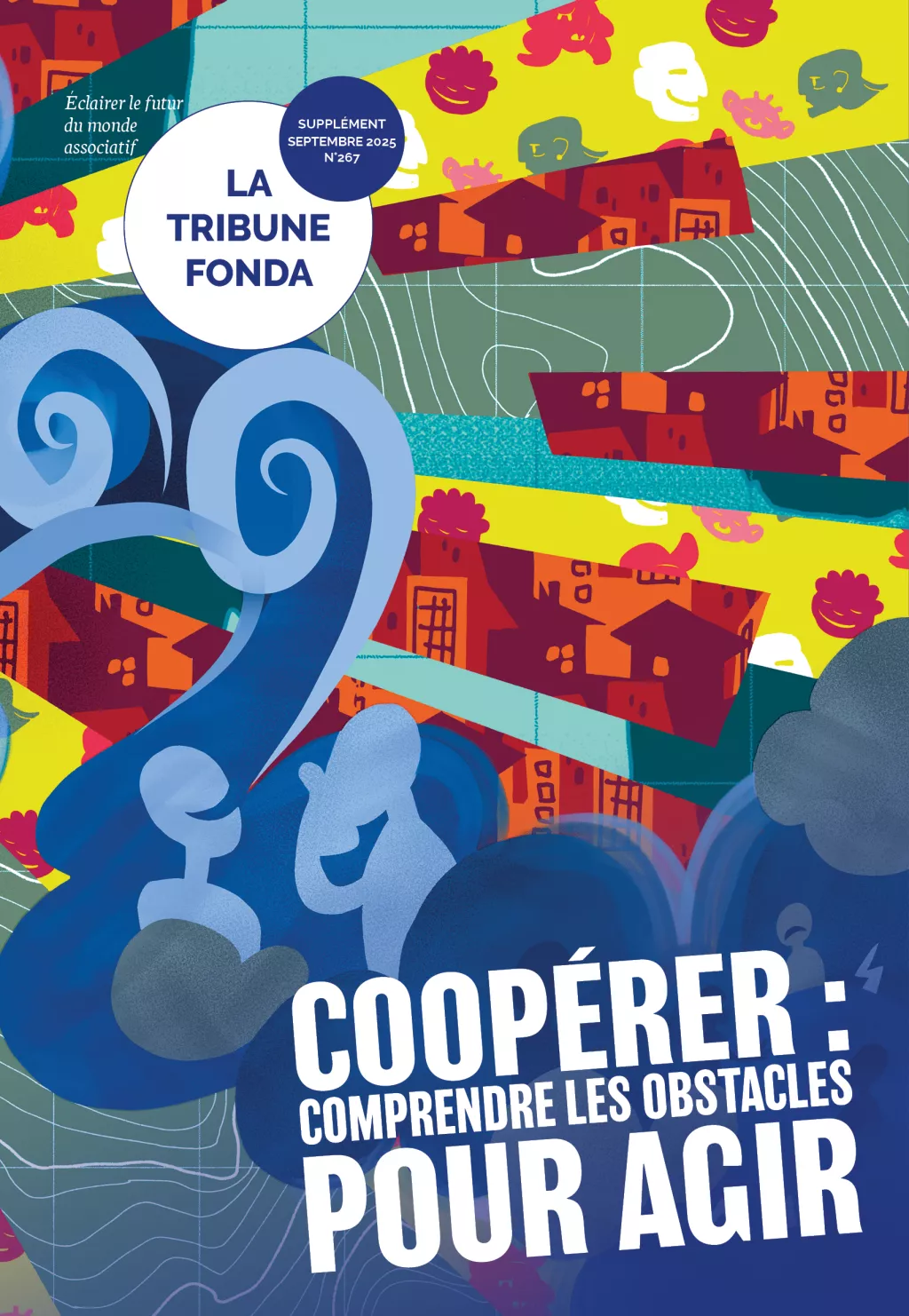Une coopération pour sortir de l’impasse
On entend souvent dire que « coopérer, c’est systémique ! ». Pourtant, bien que l’approche systémique et la coopération s’enrichissent mutuellement et se complètent, elles restent deux pratiques distinctes.
Le 2 juillet, la Fonda, la Fondation de France et le Réseau national des Maisons des associations (RNMA) nous ont confié un exercice d’équilibriste : faire dialoguer approche systémique et approches de la coopération, en temps réel, en lien avec les riches interventions des participants de la journée. Nous développons ici une réflexion née de cette journée.
Pour commencer, rappelons qu’adopter une approche systémique, c’est enrichir sa compréhension des situations où l’on agit, des problèmes qu’on essaie de résoudre.
Il s’agit donc remettre de la complexité au centre de l’action pour essayer de trouver une plus juste place au service de l’intérêt général : ajuster sa stratégie, ses actions, son discours, sa posture.
Pour un acteur de l’intérêt général, cela veut dire se décentrer de ses propres objectifs d’impact pour mieux appréhender ce qui se passe autour de lui. L’acteur de l’intérêt général peut commencer par identifier quelles sont ses diverses influences, bonnes ou moins bonnes sur ce qui l’entoure. Sur le problème qu’il essaie de résoudre, mais aussi les divers acteurs en présence, les croyances existantes, etc.
À cette aune, on peut noter une certaine ambivalence dans la coopération : coopérer permet de penser des actions enrichies par différents regards de l’écosystème. Elle aide à se décentrer, surtout si la coopération rassemble des acteurs variés. Elle permet souvent de dialoguer et de faire de la place au temps long.
Mais les limites individuelles des acteurs de l’intérêt général, que nous avons développées dans nos travaux sur l’approche systémique1 peuvent largement se retrouver à l’échelle de la coopération. Car au-delà du collectif constitué des acteurs qui coopèrent, il y a des écosystèmes, « plus grands » : territoire, secteur d’activité, constellation d’acteurs concernés par le problème sociétal, etc.
Deux pièges semblent guetter les pratiques de coopération : réduire la complexité et se focaliser sur sa solution.
Piège 1 : Réduire la complexité
Est-ce que la coopération nous amène à complexifier notre pensée, approfondir notre compréhension partagée de la situation — en faisant place à la nuance, aux paradoxes, aux désaccords ? Ou est-ce qu’elle nous pousse à les ignorer, à réduire nos constats à ce qui est communément admis ou dicible ?
Soyons clairvoyants : on a plein de bonnes raisons, humaines ou politiques, de rapports de pouvoir ou de courtoisie, de gommer nos différences et lisser notre vision, lorsqu’on coopère !
Une coopération, qui pour sa propre réussite, fait fi de la complexité, se retrouve dans un logiciel simplificateur qui va faire des dégâts !
Pour éviter ce piège, mieux vaut doter le processus coopératif et ses acteurs d’une dose d’approche systémique et de pensée complexe.
Piège 2 : se focaliser sur sa solution
De la même manière, en coopérant, va-t-on entrer dans une logique solutionniste, qui exige de co-créer une « solution qui marche », qui soit mesurable et efficace, mais qui accapare notre attention au point de nous faire oublier le reste, de freiner des changements plus profonds, de faire des dégâts malgré nous ?2
Prenons un exemple : pendant des années, lors de famines, on envoyait de la nourriture dans les zones sinistrées. À raison : cela sauve des vies ! C’était un excellent exemple de coopération, impliquant des institutions comme le Programme alimentaire mondial, des Organisations non gouvernementales (ONG), des États, parfois l’armée ou même les chefs de villages locaux.
Pour autant, on s’est aperçu qu’envoyer des denrées pour sauver des vies provoquait la faillite des agriculteurs locaux qui n’avaient plus de marché pour leurs produits. Ce qui rend plus probable la prochaine famine3 !
Ainsi une brillante coopération peut aussi faire des dégâts.
Bref : la coopération n’éradique pas les risques de simplifier un problème, d’être focalisé sur un objectif, une « solution », avec tous les effets de bord que cela comporte. Peut-être même que, comme la coopération est un défi en soi, qui demande de l’énergie et de l’attention, elle accroît le risque d’oublier tout ce qu’il y a autour d’elle !
Des interrogations à piocher dans la rosace systémique
Si cela mériterait d’être affiné et adapté, nous avons l’intuition qu’une partie des questionnements que nous proposons aux acteurs de l’intérêt général dans le cadre de l’approche systémique peut être utile aux processus coopératifs. Par exemple, en piochant dans la Rosace systémique quelques questions structurantes en matière de résilience et d’effets de bord.
Dans quelle mesure notre coopération renforce ou affaiblit nos écosystèmes, en termes de…
- représentativité des parties prenantes ?
- diversité de pratiques et d’opinions ?
- amélioration de la compréhension de l’existant ?
- encapacitation de l’ensemble ?
- partage, accessibilité et diversité des savoir et de leurs modes de production ?
Quels effets de bord provoquons-nous ?
- Est-ce que malgré nous, nous travaillons contre les acteurs qui ne font pas partie du processus coopératif ?
- Est-ce que notre coopération gêne ou déresponsabilise des acteurs clés ?
- Est-ce qu’elle renforce des croyances non souhaitables ?
- Est-ce qu’en coopérant, nous uniformisons une réponse au problème ? Si oui, qu’est-ce que nous y gagnons et qu’est-ce que nous y perdons (en efficacité, en coûts, en résilience par une diversité de réponses) ?
- Est-ce que notre coopération a tendance à simplifier le constat et les propositions pour rassembler ? Ou arrive-t-elle à faire vivre les nuances, contradictions et désaccords ?
Nous croyons beaucoup au rôle clé qu’occupent les facilitateurs de coopération4, qui peuvent avoir un double rôle : être au service de la coopération, tout en assurant le lien avec le reste du monde !
Gardons en tête qu’une coopération réussie atteint certes ses objectifs propres, mais renforce aussi les écosystèmes dans lesquels elle est située.
- 1
Voir l’Anti-guide de l’approche systémique, « Partie 0 », disponible en ligne.
- 2
Voir notamment l’Anti-guide de l’approche systémique, « Partie 4 », sur les effets de bord, ainsi que le webinaire de l’Exploration systémique « Qu’est-ce que l’approche systémique transforme dans la mission de mon association ? ».
- 3
Pour la suite de l’histoire, se référer à l’Anti-guide de l’approche systémique, « Partie 1 - Section Trouver la parade ».
- 4
Sur ce sujet, les travaux sur l’approche systémique sont complémentaires de la méthodologie du Faire Ensemble de la Fonda, comme du corpus de l’Institut des Territoires Coopératifs.