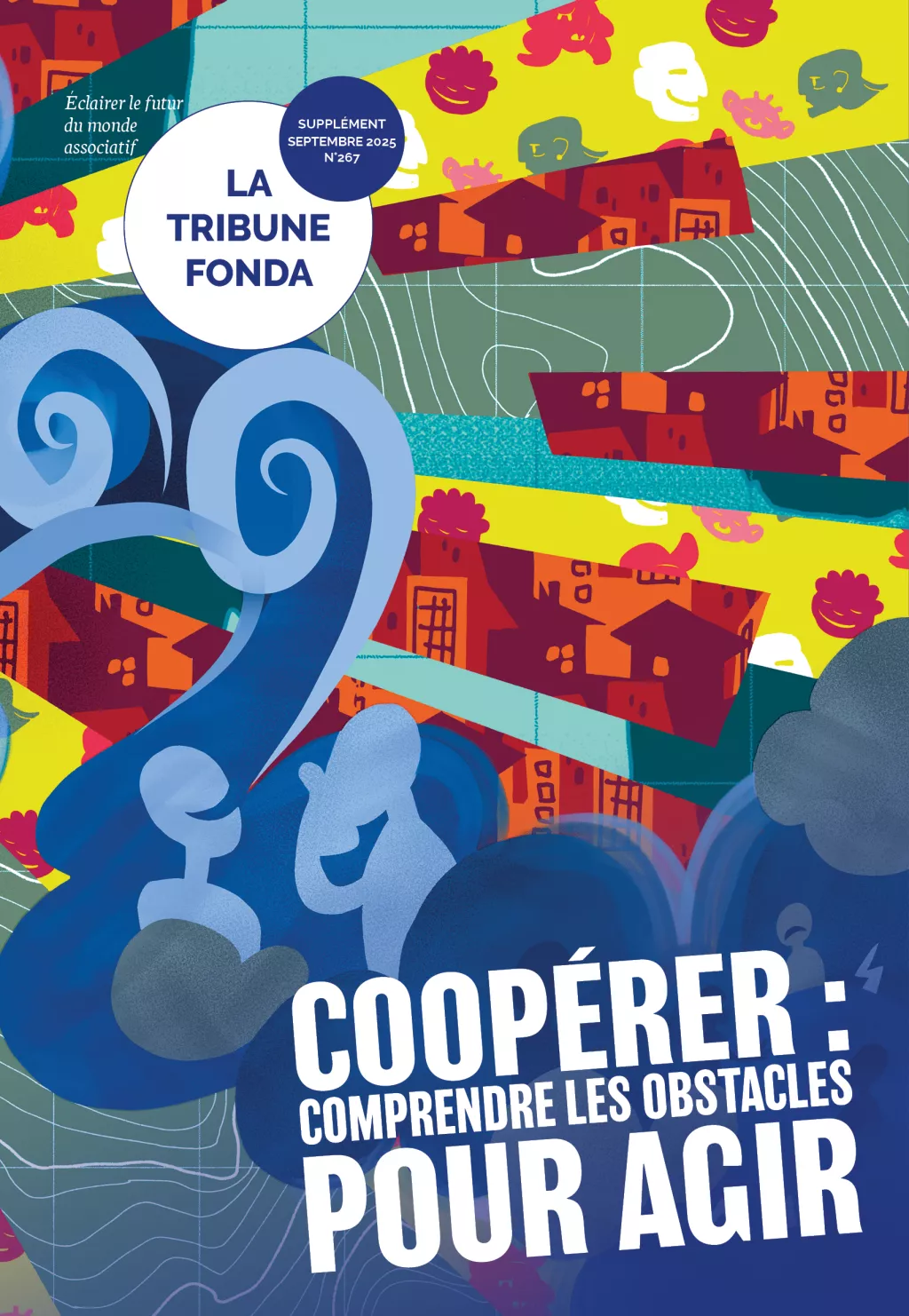Les coopérations territoriales permettent de créer et développer un projet commun sur un territoire, de favoriser des solutions aux besoins locaux portées par des acteurs aux apports complémentaires, d’inscrire la gestion des ressources locales dans une logique de commun, de développer des mutualisations, de permettre le changement d’échelle des initiatives et de renforcer la solidarité et la cohésion entre acteurs du territoire.
Coopérer, c’est construire un cadre d’action partagé, ouvert et évolutif, entre des acteurs aux logiques, temporalités, ressources et cultures différentes, dans une logique d’apprentissage mutuel.
Cela suppose de la confiance, de la transparence, un partage réel du pouvoir, mais aussi des méthodes, des outils et du temps. La coopération s’apprend, s’anime et se cultive.
Une étude-action pour éclairer les enjeux de financement
Le Labo de l’ESS mène depuis 2022 avec le fonds de dotation Que Vol’terre l’étude-action « Accompagner et financer les coopérations territoriales au service de la transition écologique juste ». Elle vise à nourrir la compréhension des besoins de ces dynamiques collectives et identifier des clés de réussite et outils afin de mieux les accompagner et les financer.
Une première étape d’analyse a donné lieu au rapport Vers une société de la coopération, paru en 2024. Sur cette base, cinq groupes de travail, appelés « chantiers coopératifs », ont été initiés. Celui animé par le Pôle d’innovation sociale 107, avait pour objet d’identifier les leviers aux enjeux de financement des coopérations territoriales dans leur diversité.
Quatre principaux enseignements ressortent de ce travail : une pluralité de modèles de coopération territoriale existent, dont certains marchands. Néanmoins ces coopérations sont expérimentales et manquent de visibilité sur l’offre actuelle de financement.
Il y a une pluralité de modèles de coopération territoriale, avec des besoins et ressources spécifiques :
- les coopérations territoriales « modélisées », adaptant à leur contexte territorial un modèle éprouvé (pôles territoriaux de coopération économique, tiers lieux, territoires zéro chômeur de longue durée, etc.), ont accès à des outils mutualisés d’accompagnement et de financement par les réseaux ;
- les coopérations territoriales non modélisées ont généralement besoin d’accompagnement et de financement par un tiers pour construire leur projet ;
- les coopérations territoriales systémiques, ayant pour ambition de transformer le territoire en travaillant sur l’ensemble des enjeux liés aux besoins identifiés collectivement, nécessitent un soutien de long terme pour financer l’animation de la coopération.
Ces formes de coopération ont des modèles socio-économiques et juridiques pouvant être marchands, non marchands ou hybrides. Une partie d’entre elles sont fortement dépendantes des financements publics et privés et peinent à financer les fonctions d’animation et de développement, pourtant essentielles à leur bon fonctionnement.
Toutes les coopérations territoriales sont des démarches expérimentales, non linéaires et sur des temporalités longues et incertaines, fondées sur une culture commune. L’étape de l’émergence est particulièrement fondamentale, car c’est à ce moment que se construisent les bases de la coopération. En conséquence, elles ont besoin d’un appui « sur mesure », prenant en compte le caractère collectif du projet et la spécificité de l’écosystème d’acteurs engagés dans la démarche.
L’offre actuelle de financement souffre d’un manque d’accessibilité, d’adaptation aux besoins des coopérations et de pérennité. Il existe un angle mort dans les politiques de financement : les débuts de la coopération. Les financements n’arrivent que lorsque les projets collectifs sont déjà formalisés, mûrs, structurés. Or, la coopération est un processus vivant, fragile, qui a besoin d’espace pour expérimenter, tester, ajuster, sans devoir immédiatement rentrer dans les cases.
Des outils inadaptés et un changement de posture nécessaire
Les appels à projets, tels qu’ils sont conçus, ne sont pas adaptés aux coopérations territoriales. Même lorsqu’ils s’ouvrent aux consortiums, ils imposent souvent un chef de file. Cela déséquilibre la dynamique collective, en donnant une place dominante à un acteur.
Parfois, le financement est plafonné, limitant la diversité et la richesse des contributions. Créer une structure juridique commune est parfois envisagé comme solution pour accéder aux financements. Mais cette formalisation précoce freine l’innovation, mobilise des ressources précieuses et détourne les collectifs de leur cœur de mission : l’action.
Face à ces freins, certains financeurs montrent la voie en adoptant une « philanthropie de la confiance ». Ils choisissent de financer l’émergence et la structuration des projets collectifs, sans exiger de garanties de résultats immédiats, mais en pariant sur une vision partagée.
C’est le cas par exemple de la Fondation de France, engagée aux côtés du Labo logement pour les jeunes précarisés. Adapter leur soutien aux besoins des coopérations territoriales requiert un changement de posture : les financeurs doivent devenir parties prenantes de la coopération.
Le rôle clef d’un tiers facilitateur
Un tiers peut faciliter la confiance, en assurant un espace neutre capable de porter les premières expérimentations. C’est précisément ce que propose le Pôle d’innovation sociale 107 : former, outiller et accompagner les équipes et les structures à coopérer.
Trop souvent, les collectifs peinent faute de compétences en ingénierie de coopération. Des lieux comme le 107 jouent un rôle crucial en transmettant ces savoir-faire, en créant des espaces pour apprendre à coopérer par la pratique.
En tant que réceptacle administratif et financier, il permet à des collectifs informels d’accéder à des financements, sans devoir créer une structure juridique. Cette capacité a notamment permis à des initiatives comme la Ruche Éphémère de voir le jour, avec le soutien de l’ADEME.
Pour un financement plus souple et collectif
Du fait de la complexité du montage du projet collectif et de l’incertitude quant aux résultats, le financement doit permettre l’accès à des capitaux patients à intérêts modérés, respectueux des temporalités longues, dédiés principalement à des projets d’investissement et, en partie, aux coûts de l’ingénierie de coopération.
Une démarche collective de recherche de financement permet de mobiliser des réseaux variés, de présenter un même projet sous différents angles, en valorisant l’expertise propre à chaque membre du collectif.
L’initiative Urivalyon en est un bon exemple : selon les interlocuteurs, les porteurs ont mis en avant tour à tour l’expertise agricole avec la Chambre d’Agriculture et l’OCAPI ou l’expertise bâtiment auprès d’architectes et de l’ALEC, pour répondre à des enjeux multiples.
Malgré ces avancées, le financement de la coopération reste un exercice d’équilibriste. Il demande une ingénierie de montage complexe, du temps et une expertise encore rare. Nous appelons les financeurs à faire preuve de plus de souplesse, de confiance et de simplicité pour reconnaître que l’innovation sociale s’épanouit dans les espaces ouverts où l’on peut tester, se tromper et recommencer.