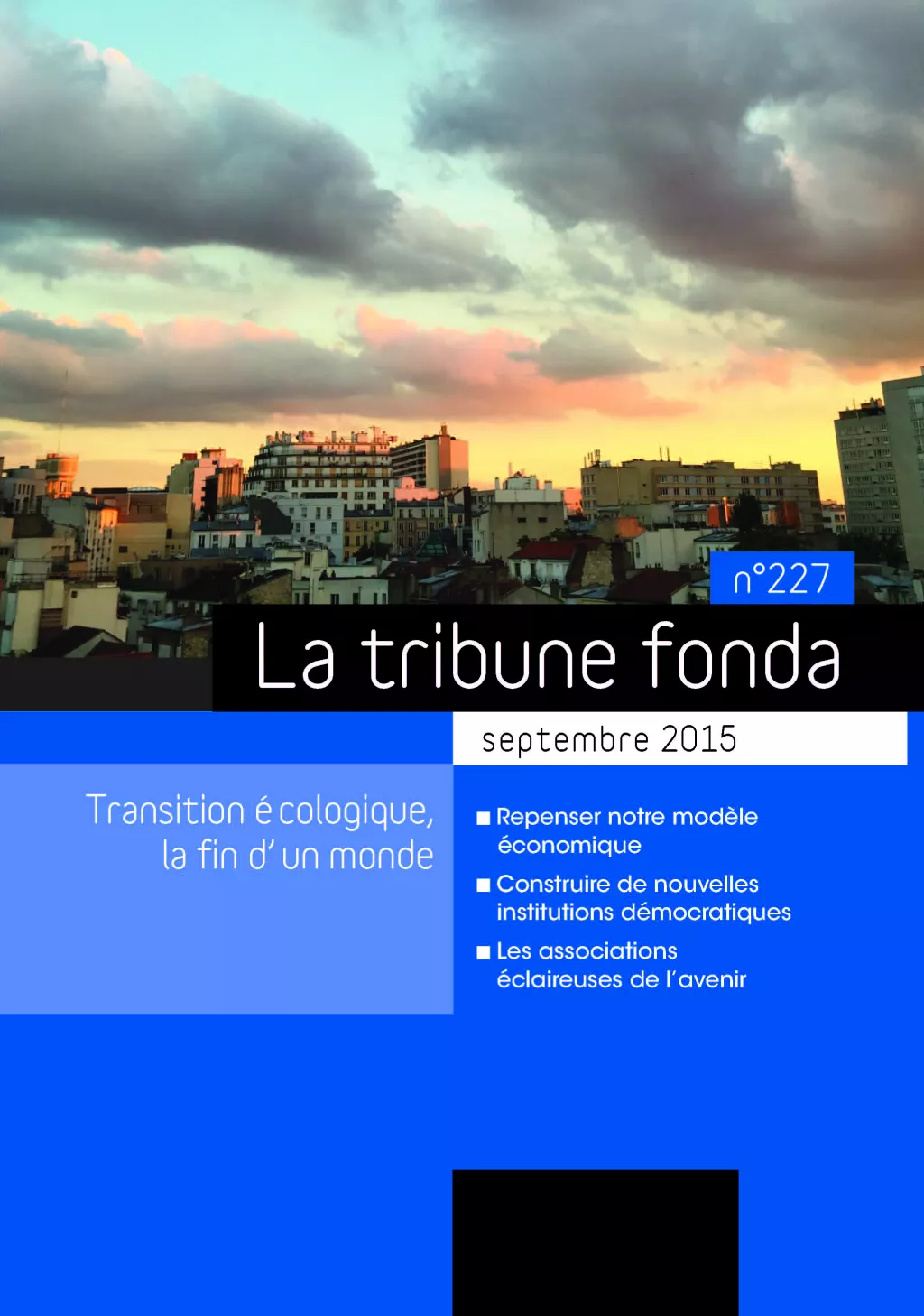La rédaction : Selon vous, quels sont les facteurs d’évolution de l’environnement, quel est l’élément qui concernera le plus les citoyens ?
Dominique Bourg : Nous entrons dans une nouvelle ère, celle de l’Anthropocène, et ce depuis les années cinquante. L’Anthropocène signifie que la Terre sous nos pieds et le Ciel au-dessus de nos têtes commencent à changer et changeront plus encore à l’avenir. Ce phénomène est dû à l’impact massif des activités humaines, qui déclenche des conséquences à très long terme. Les trois principaux changements sont les suivants.
En premier lieu, l’écoumène, c’est-à-dire la partie habitable par les hommes en permanence sur Terre, va se rétrécir au long cours. La première cause est la montée du niveau des mers. Le Giec prévoit 60 cm au maximum, mais les incertitudes sont très fortes en ce qui concerne le devenir des grandes masses glaciaires du Grœnland et de l’Antarctique. Une élévation de plus d’un mètre n’est pas inenvisageable. Cette évolution est irréversible, pour des millénaires.
En second lieu, la désertification progresse. La côte Ouest des États-Unis connaît des sécheresses chroniques, tout particulièrement la Californie, et les modèles prévoient qu’elle va redevenir ce qu’elle était il y a quelques milliers d’années, c’est-à-dire un désert.
En troisième lieu, l’augmentation des températures va rendre certaines régions inhabitables. Si nous atteignions 3° d’augmentation des températures à la fin du siècle, ce qui, malheureusement, n’est pas impossible, cela signifierait une augmentation de 5° pour au moins 5 000 ans à partir du XXIIe siècle.
Au-delà du rétrécissement, l’écoumène va s’appauvrir : nous aurons de moins en moins d’énergies fossiles, parce que la quantité d’énergie nécessaire pour les extraire ne cesse de croître. Il y a trente ans encore, en Arabie saoudite, il suffisait d’investir un baril pour en retirer cent. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Avec les huiles de schiste, on investit un baril pour en retirer trois.
Des deux restants il faut encore déduire l’énergie nécessaire au transport de ces barils, à leur transformation et au maintien des infrastructures. Ce n’est pas très rentable. On a le même problème avec les métaux. Certains métaux semi-précieux dont on se sert pour des usages de haute technologie sont sous tension. Le degré de concentration des minerais ne cesse de se réduire, et leur extraction exige de plus en plus d’énergie. Même le sable manque, parce que le sable du désert n’est pas utilisable, il n’est pas identique à celui des rivières et des fonds marins. On commence à être sous tension en matière d’eau douce dans certaines régions.
En ce qui concerne les ressources biotiques, le constat est effrayant : entre 1970 et 2010, la moitié des mammifères, des oiseaux, des amphibiens et des poissons ont disparu. Les mers sont envahies par les méduses, dans le monde entier, et c’est irréversible. Il y a trente ans, des quantités de moustiques s’écrasaient sur votre pare-brise en voiture, aujourd’hui, très peu. On se dirige vers un monde plus pauvre, plus petit et plus hostile. Par ailleurs, la population continue de croître, nous serons entre 9 et 10 milliards au milieu du siècle. Pour la fin du siècle, nous avons des scénarios à 12 milliards.
La rédaction : Vous avez participé à certaines commissions du Grenelle de l’environnement, que pensez-vous de l’état actuel du débat public en France ?
D.B. : Le Grenelle de l’environnement avait été bien préparé, mais les suites n’ont pas été à la hauteur. Le Parlement a réduit beaucoup de dispositions, ainsi que le président de la République de l’époque. Il n’est resté aucune mesure structurante. L’actuelle ministre de l’Environnement, qui a évoqué une taxe carbone, a contribué à détruire les apports du Grenelle de l’environnement il y a trois ans. C’est décourageant. Il y avait pourtant des mesures intéressantes.
La rédaction : Pourquoi les préoccupations écologiques ont-elles tant de mal à se diffuser ?
D.B. : Les associations sont actives, mais les partis n’ont d’écologiste que le nom, tout du moins sur le plan national. En France les Verts, mais ce n’est le cas ni en Suisse ni en Belgique, ne s’intéressent guère à l’environnement, mais plutôt aux droits des minorités, pour lesquels ils se battent. En matière d’environnement, ils ne sont pas très compétents. Tel n’est pas en revanche le cas pour les élus locaux qui peuvent faire un vrai travail. Quelques personnalités dans tous les partis connaissent les dossiers et s’y intéressent, mais ils ne sont pas entendus.
Il y a apparemment une partie des Français qui semble être devenue allergique à l’écologie, qui ne veut plus en entendre parler. J’ai vu dernièrement un sondage là-dessus. Par ailleurs, il y aurait en France grosso modo 10 % de climato-sceptiques ; aux États-Unis, c’est quasiment un habitant sur deux. Selon certaines études, suivant le type de relation avec le marché, l’opinion change. Ceux qui pensent que le marché résout tous les problèmes rejettent l’idée d’un changement climatique.
Le fait que la plupart des problèmes écologiques ne sont pas visibles explique pour une part notre inaction. On ne s’inquiète que des difficultés évidentes, accessibles à nos sens. Les diagnostics scientifiques, abstraits, ne nous ébranlent pas. Et quand les problèmes deviennent visibles, c’est trop tard. Trop peu de personnes se sentent concernées. Personne ne voit qu’il y a 400 ppm de dioxyde de carbone aujourd’hui dans l’air ambiant.
Les quelques cyclones hyper-violents qui se produisent de temps à autre dans des contrées lointaines ne nous émeuvent guère. Ce qui fait bouger, c’est d’être confronté à une menace immédiate, qu’on n’a pas à interpréter. Or, les effets dommageables sur l’environnement sont sensibles à distance, c’est abstrait. Les chaînes causales sont complexes et toujours collectives, donc ça n’interpelle pas le sens des responsabilités de chacun.
Le grand drame de l’environnement, c’est qu’il se situe à côté des mécanismes qui nous font réagir. Pour l’heure, notre bien-être n’est pas frontalement affecté.
La rédaction : Le discours sur l’environnement a peut-être été trop agressif ?
D.B. : Non, quand on voit l’état de la planète, le discours n’a jamais été trop agressif. Mais je ne jette pas la pierre. Les raisons sont objectives, les mécanismes que l’évolution a forgés ne nous ont jamais préparés à réagir aux dégradations que l’on suscite. Nous sommes des chasseurs cueilleurs, nous réagissons aux dangers immédiats. Le temps démocratique, celui des mandats électoraux, n’a rien à voir avec le temps environnemental, qui est très long. Les dégradations écologiques ne se donnent à voir souvent qu’après un long délai et sont souvent irréversibles.
Cela ne veut pas dire que les démocraties sont totalement incapables de traiter le problème, mais il faudrait les transformer. Le système démocratique, tel qu’il existe aujourd’hui, repose sur la manière dont chacun de nous interprète son bien-être, sur les effets supposés puis vécus des politiques publiques sur notre bien-être. Autrement dit, la démocratie repose sur ce qu’on ressent.
Or, nous venons de le dire, nous ne ressentons pas encore, par exemple, ou peu, les effets du changement climatique. Les mécanismes représentatifs de la démocratie telle qu’elle existe aujourd’hui, sont incapables de traiter les questions environnementales. Cela ne veut pas dire qu’il faut balayer la démocratie, certainement pas. Mais il faudrait la transformer.
À quoi s’ajoute qu’indépendamment des questions écologiques, nos démocraties dysfonctionnement : les Français ont voté contre le traité constitutionnel européen, et il a été imposé par le Parlement. Est-on encore en démocratie en France ? Le président de la République s’est fait élire sur un programme, il en applique un autre. La démocratie est malade.
J’appelle de mes vœux une troisième Chambre non représentative, parce que les représentants traitent des intérêts des uns contre ceux des autres, et à court terme. Nous avons défendu cette idée avec d’autres, notamment Bastien François, dans Pour une VIe République écologique. Cette troisième Chambre ne serait pas un Conseil économique, social et environnemental amélioré. Le Cése ne peut pas jouer ce rôle dans sa composition actuelle, il est constitué autour des métiers et des corporations. C’est un complément à la représentation classique. Au Cése s’opposent aussi des intérêts catégoriels de court terme. Je n’attends rien du Cése, il n’est pas fait pour ça. Ou il faudrait en changer la composition.
Nous avons proposé pour la composition de la troisième Chambre des listes d’aptitude établies par les grandes Ong environnementales, qui seraient avalisées par le Parlement. On tirerait au sort un individu sur trois pour éviter les phénomènes de lobbying. On aurait un ou deux tiers de personnalités qualifiées, qui auraient montré dans leur vie publique un engagement réel pour le long terme, et on parachèverait la composition avec des citoyens « ordinaires », pour éviter une « expertocratie ». Cette Chambre aurait une fonction de veto suspensif, elle ne pourrait pas empêcher le vote d’une loi, mais contraindrait à son réexamen. In fine, elle ne pourrait pas s’y opposer. Les problèmes étant croissants, ce système finirait par jouer un rôle efficace.
La rédaction : Quel pourrait être le rôle des associations environnementales ?
D.B. : Elles ont un rôle très important. On proposait aussi qu’en Commission des lois – parce que le lobbying auprès des parlementaires est effrayant – les grandes ONG environnementales puissent avoir un droit d’audition, qu’au moins les parlementaires les entendent. Ces derniers ne connaissent rien à ces sujets. Les associations diffusent de l’information, elles interpellent les citoyens, c’est un travail fondamental, au long cours, qui n’a pas un impact immédiat. Mais c’est un travail de sensibilisation très important. Certaines ONG sont aussi dans l’action directe, dans la surveillance des écosystèmes ou de la biodiversité par exemple, etc. Tout ça est fondamental, mais n’a pas d’influence sur la décision publique.
La rédaction : Quel peut être le déroulement et l’impact de la Cop 21 ?
D.B. : Je n’en attends pas monts et merveilles. Le processus, tel qu’il est engagé, à savoir des pays enregistrant un engagement volontaire, ne garantit absolument pas qu’on se maintienne en dessous de la barre des 2°. Ce serait un miracle. De toute façon, on a abandonné l’idée d’un accord contraignant.
J’attends plutôt un effet indirect, que les gouvernants ne soient plus les valets des banques, qu’ils réimposent un peu de régulation : une forme de taxation internationale pour abonder le fonds de 100 milliards destinés aux pays en voie de développement et aux pays les moins avancés. C’est fondamental : avec les dettes publiques, les anciens pays industriels n’ont plus les moyens de financer ce fonds. Le financer de façon innovante est un impératif de justice et donnerait un signal à toute la finance internationale. Il faut qu’il y ait mobilisation des citoyens, qu’on les entende, pour que les négociateurs se sentent sous une vive pression, notamment pour la grande manifestation mondiale du 29 novembre.
La rédaction : Que peuvent apporter l’ensemble du mouvement associatif, le milieu de l’économie sociale et solidaire, y compris les associations qui n’ont pas une vocation environnementale ?
D.B. : L’économie sociale et solidaire n’est pas sous la pression de l’exigence d’une rentabilité folle. En Suisse, l’Ess est aussi environnementale. On met toujours en avant le respect de l’environnement. On ne peut pas séparer le respect d’autrui, la lutte contre les inégalités et le respect de l’environnement, c’est en partie la même chose.
Le modèle Handy, réalisé par trois chercheurs de la Nasa, est vraiment intéressant. Il part d’un modèle très simple, proies-prédateurs, complexifié. Handy montre que les sociétés qui s’adonnent à une razzia sur les ressources, finissent toutes par disparaître. Le moteur du pillage des ressources se trouve dans les inégalités en général. Une société moins destructrice pour l’environnement est nécessairement une société où les inégalités sont resserrées. Si vous êtes respectueux des autres, vous êtes aussi, souvent, respectueux du milieu.
La rédaction : Que pensez-vous d’une institution comme le Comité national d’éthique, qui réfléchit sur des questions de long terme ?
D.B. : Cela ne porte pas sur les mêmes questions. On avait pensé à l’occasion de la 6e République à un Collège du futur où de jeunes chercheurs surveilleraient en permanence l’évolution des connaissances sur tous les sujets de long terme, dont les sujets environnementaux, mais non exclusivement. Cette institution aurait aussi une fonction réflexive. Elle fournirait des éléments d’appréciation sur nos choix technologiques, nous obligerait à remettre au centre du village le type de société que nous voulons. Alors qu’aujourd’hui nous suivons aveuglément le marché et un prétendu progrès. Elle ne serait donc pas sans rapport avec le Comité national d’éthique.
La rédaction : Quelle est l’issue possible ?
D.B. : Pour l’heure, ce sont plutôt les nuages noirs qui s’accumulent. Il est difficile d’imaginer que nous échapperons à certaines épreuves. Je ne suis pas pessimiste sur le long terme, mais à court et moyen termes. Les épreuves et autres désastres attendus nous contraindront peut-être à trouver une forme de sagesse, à faire la synthèse entre certains acquis modernes et l’apprentissage de nouveaux réflexes. Pour l’heure, ajoutées à l’actuel délitement du monde, les difficultés écologiques dessinent un avenir effrayant. La plupart des gens ne veulent pas le voir.