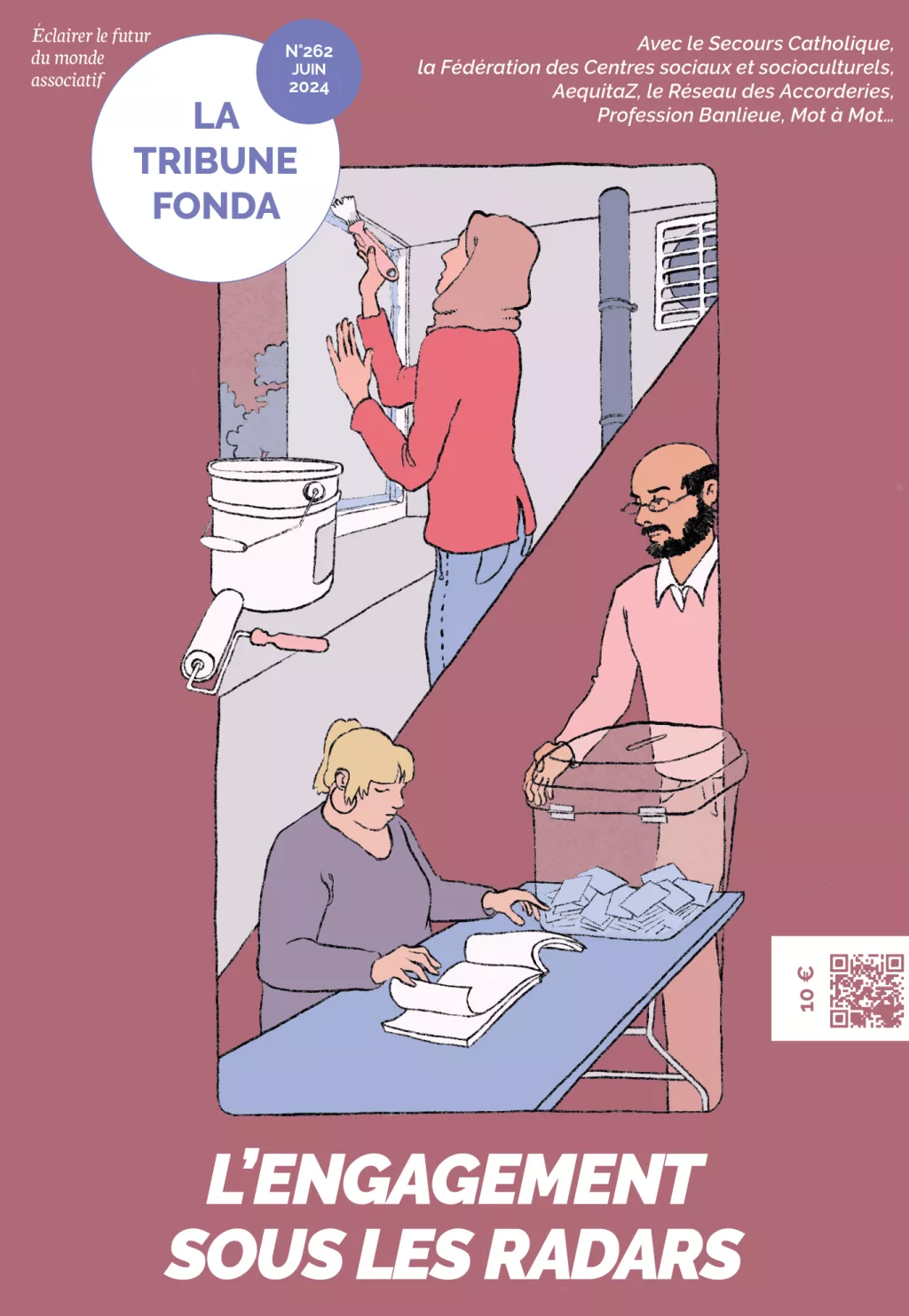Propos recueillis par Anna Maheu.
Comment vous êtes-vous engagées au sein des Accorderies ?
Pascale Caron : J’ai fait partie des fondateurs du concept Accorderies au Québec, où j’ai été présidente de l’une des premières Accorderies de 2002 à 2010. Quand le concept est passé outre- Atlantique en 2011, j’ai accompagné les deux premières Accorderies françaises à Paris et à Chambéry1. Vingt ans plus tard, je suis toujours investie dans le Réseau, notamment sa gouvernance, et dans l’Accorderie du pays Diois.
Audrey Leyrat : Je suis salariée de l’Accorderie de Limoges depuis 2016. J’avais postulé parce que je recherchais un emploi, mais également par adhésion à la philosophie des Accorderies.
Zoé Renaut-Revoyre : De mon côté, j’avais vu passer le premier poste de salarié d’Accorderie qui ouvrait sur Paris en 2011. Comme Audrey, j’adhérais totalement à la philosophie, mais le travail d’animatrice ne me correspondait pas. Trois ans plus tard, quand le Réseau des Accorderies recherchait une déléguée générale, j’ai postulé sans hésitation.
Depuis 2011, comment les Accorderies se sont-elles développées ?
Zoé Renaut-Revoyre : Aujourd’hui, une trentaine d’Accorderies sont actives, mais bien plus ont été créées en 13 ans ! Nous étions à 37 Accorderies en 20202, mais nous sommes 33 en ce début d’année.
Pascale Caron : Fermer une Accorderie est toujours un crève- coeur, mais c’est parfois nécessaire, notamment quand elle a été mal montée.
Comment peut-on mal monter une Accorderie ?
Pascale Caron : Par le haut ! Dans les années 2010, le concept a séduit. Certains élus locaux ont voulu lancer des Accorderies sur leurs territoires, sans que cela ne vienne des habitants. Ces derniers ne s’en sont pas emparés et à la première difficulté, l’Accorderie a pris l’eau. D’autres Accorderies ont fermé pour des raisons financières, la crise liée au COVID-19 a été un coup dur.
Zoé Renaut-Revoyre : La pandémie n’a fait qu’accentuer des difficultés rencontrées au préalable par certaines Accorderies, mais plus généralement par les associations d’action sociale : une crise de l’engagement dans la responsabilité associative et une usure liée à la tension financière. Les associations de lutte contre la pauvreté subissent des effets ciseaux entre des besoins croissants, et des moyens réduits. Dans les pires des cas, ces effets ciseaux peuvent entraîner la fermeture d’Accorderies déjà fragilisées. Ce sont des projets d’habitants, par définition légers et flexibles, mais aussi précaires.
Que qualifiez-vous de crise de l’engagement dans la responsabilité associative ?
Pascale Caron : Les personnes qui s’impliquent dans les Accorderies ne s’imaginent pas en responsabilité associative. Souvent en situation de précarité et isolées3, elles ont du mal à se dire qu’elles vont proposer des services, sans parler de s’impliquer dans la gouvernance. Nous avons donc parfois des conseils d’administration (CA) qui peinent à recruter, comme cela a pu être le cas dans le pays Diois en 2017.
Audrey Leyrat : Porter une association, c’est tout de même une sacrée responsabilité ! La gestion associative demande des compétences budgétaires, stratégiques, ou encore de négociation partenariale.
Pascale Caron : Pourtant, comme le disait Zoé, les Accorderies sont des associations particulièrement légères, avec des petits budgets. Le premier frein au bénévolat de gouvernance est surtout psychologique. Les Accordeurs hésitent à rentrer dans le cercle employeur s’ils ne connaissent pas le droit du travail sur le bout des doigts. Pourtant il est possible, et courant, de monter en compétences au cours de son mandat ! Nous avons de magnifiques parcours à l’intérieur de l’Accorderie du pays Diois. Certains Accordeurs sont rentrés juste pour un service, puis petit à petit, ils ont rejoint un cercle4et finalement ont passé le pas de rejoindre le Cercle décisionnaire.
Comment encourager cette prise de responsabilité ?
Pascale Caron : Dès le départ, nous avons identifié deux conditions essentielles pour la réussite d’une Accorderie : un local et une personne salariée.
Le local est le lieu où vit le lien social, c’est là où les gens se rencontrent et apprennent à se connaître. La personne salariée est quant à elle le coeur de l’association, elle facilite les échanges, anime le lieu et au final permet à chacun de s’impliquer selon ses besoins et ses envies.
C’est un métier compliqué : il faut aider les gens à faire, mais ne pas faire pour eux. Une véritable ligne de crête !
Audrey Leyrat : Tout à fait, je vois ma posture comme celle d’une facilitatrice. C’est un métier difficile à décrire, mais je le résumerais en quatre mots : faire émerger leur engagement. Concrètement, je passe du temps à écouter les envies et les besoins des personnes. Puis, je les mets en lien et nous construisons ensemble un cadre collectif.
Zoé Renaut-Revoyre : La facilitation d’une ou un salarié d’Accorderie est précieuse à plusieurs étapes. Un habitant va venir avec une envie. La première étape consiste à l’accueillir, à lui permettre de s’exprimer.
Comme le dit Audrey, cela demande d’écouter vraiment chaque habitant pour bien comprendre sa demande et voir comment elle s’inscrit, ou non, dans un contexte et dans un possible élan collectif, propice à la coopération. À ce stade, l’animateur est un véritable chef d’orchestre qui met en musique dif- férents instruments pour passer à l’action.
Mais la facilitation a aussi lieu dans un second temps. La ou le salarié sait quelles sont les tâches à effectuer pour que l’Accorderie fonctionne. Il y a donc tout un travail de pédagogie pour faire comprendre aux membres que la structure elle-même a besoin d’engagement pour exister.
Un mandat associatif est un engagement vis-à-vis du collectif. Ce passage de l’engagement individuel à l’engagement collectif est délicat et nécessite d’être mis en mots, conscientisé. Il y a donc toujours des va-et-vient et c’est rarement un parcours aussi linéaire que « je prends la responsabilité de mon besoin, je prends la responsabilité de participer à la solution à ce besoin, et je prends un mandat associatif pour pérenniser cette solution ».
Pascale Caron : Pour compléter sur ce passage de l’individuel au collectif, la participation des Accordeurs peut prendre de nombreuses formes, pas seulement dans la gouvernance.
Certains Accordeurs rendent de menus services pour entretenir le local, d’autres assurent les permanences d’accueil, rentrent les transactions ou animent des ateliers. Il est important de proposer plusieurs marches d’engagement, que les personnes peuvent monter et descendre.
Audrey Leyrat : Nous offrons des conditions pour un épanouissement personnel, qui pose les bases d’une citoyenneté. Plusieurs personnes qui ont passé le pas de porte de l’Accorderie étaient dans une situation de grande fragilité et de fait très discrètes. En participant au Comité des Accordeurs, en proposant des ateliers, en rendant des services, elles retrouvent petit à petit leur estime d’elles-mêmes.
Zoé Renaut-Revoyre : Être Accordeur, ce n’est pas qu’un engagement associatif, mais aussi un engagement dans la société humaine. Les salariés des Accorderies effectuent un travail tout en finesse pour permettre à des personnes qui se reconnaissent rarement dans le terme « engagés » de se voir autrement.
Pascale Caron : Par ailleurs, les parcours d’engagement sont rarement linéaires, à l’image de nos parcours de vie ! Une Accordeuse a rejoint le cercle finance de l’Accorderie du pays Diois il y a peu. L’intégration s’est bien passée, elle réussissait à nous consacrer du temps malgré deux enfants en bas âge. Un mois plus tard, elle a trouvé un boulot à une heure de transport de chez elle. Elle a donc arrêté temporairement et nous respectons tout à fait ce choix. Ce genre de montagnes russes est intrinsèque à l’engagement bénévole.
Audrey Leyrat : Oui, certaines personnes qui ont rejoint l’Accorderie alors qu’elles étaient sans emploi vont la quitter parce qu’elles ont retrouvé du travail, qu’elles se sont insérées à nouveau dans la société. En tant que salariée, ce départ est quelque chose de positif, je dirais même de très beau.
Pascale Caron : C’est difficile à mesurer, mais nous voyons bien au niveau local que nous avons beaucoup d’anciens Accordeurs qui sont partis et se sont engagés dans d’autres structures. Tant mieux : ils ont compris la puissance de leur engagement citoyen.
Quelles difficultés rencontrent les salariés des Accorderies ?
Audrey Leyrat : Les salariés, ou plutôt l’unique salarié de l’Accorderie, jonglent avec plusieurs activités. Nous assurons la coordination des activités, le soutien à l’émergence des projets Accordeurs, l’animation de réunion, la gestion administrative, etc. Tout ceci avec un temps de travail restreint. Il est donc important qu’une dynamique de participation et d’implication des Accordeurs contribue au fonctionnement de l’Accorderie.
Les parcours d’engagement sont rarement linéaires, comme le sont nos parcours de vie !
Zoé Renaut-Revoyre : Et que cette implication soit organisée ! Sinon la ou le salarié se retrouve au coeur d’un maelström de demandes d’Accordeurs sans priorisation ni respect de son temps de travail. D’où l’importance de l’organisation de la gouvernance autour de son poste, mais aussi du soutien national sur ce sujet. L’ensemble des salariés des Accorderies partage par exemple des temps d’échange de pratiques et de formations dédiées à l’impulsion du Réseau.
Pascale, comment l’Accorderie du pays Diois a-t-elle choisi de passer à une gouvernance partagée il y a quelques années ?
Pascale Caron : La gouvernance partagée nous semblait justement une piste intéressante pour mobiliser autrement les Accordeurs, avec un cadre défini.
Avec la gouvernance partagée, nous avons mis en place des mandats plus courts, d’un an. Cela n’empêche pas les bénévoles de rester plus longtemps, certains sont d’ailleurs là depuis presque six ans.
Certains de nos anciens regrettent le temps où ils signaient pour 5-6 ans sans faire d’histoire. Ils peuvent bien regretter : les formes d’engagement ont changé et on ne reviendra pas en arrière. Mobiliser plus de personnes sur des mandats plus courts et plus légers, c’est une piste de réflexion.
Qu’avez-vous mis en place pour lever les autres freins au bénévolat de gouvernance ?
Pascale Caron : Au moins une fois par an, nous organisons une journée de remobilisation. Avec tous ceux qui font partie de la gouvernance et tous ceux qui sont dans les groupes de travail, nous préparons un buffet ambulatoire dans nos locaux. Nous invitons tous les Accordeurs, les personnes passent d’un cercle à l’autre et découvrent les travaux respectifs.
Cela permet de les « accrocher », de les faire rentrer en douceur dans un cercle. Nous utilisons aussi le tirage au sort : tous les mois, nous téléphonons à des Accordeurs au hasard pour leur proposer d’assister au Cercle décisionnaire. Une fois qu’ils ont participé, ils reviennent plus facilement.
Comme pour les autres Accorderies, c’est une tâche sans fin, qu’il faut toujours recommencer. Notre salariée, Doreen, a pour tâche de veiller au bon fonctionnement des cercles. Cela passe par des actions aussi simples que passer un coup de fil à un Accordeur qui ne vient plus depuis quelques mois aux réunions du cercle.
Et comment cela se passe-t-il dans l’Accorderie de Limoges Audrey ?
Audrey Leyrat : Pour le coup, notre gouvernance est plus traditionnelle, bien que nous nous inscrivions dans l’esprit de la gouvernance partagée. Nous avons une présidente, un bureau classique, mais aussi un comité des Accordeurs et plusieurs commissions.
Les Accordeurs viennent y proposer de nouveaux projets qui leur tiennent à coeur, comme l’organisation d’un événement. Ces projets sont ensuite débattus en conseil d’administration, conseil qui est par ailleurs composé d’Accordeurs.
Nous observons d’ailleurs un va-et-vient entre le conseil d’administration et le comité des Accordeurs. Le conseil d’administration se distingue néanmoins par la vision stratégique et budgétaire qui est importante pour faire vivre une Accorderie. Nous n’avons pas adopté certains outils de la gouvernance partagée, comme l’élection sans candidat ou les cercles, mais nous partageons le principe de base d’une gouvernance ouverte.
Pourquoi avez-vous fait le choix de ne garder que l’esprit de la gouvernance partagée, et non la forme ?
Audrey Leyrat : Nous avons rencontré une réticence au sein de l’Accorderie. La gouvernance partagée y est perçue comme une responsabilité diluée : il n’y aurait plus un président, mais dix.
Zoé Renaut-Revoyre : Pour les Accorderies qui sont passées en gouvernance partagée, la question de la responsabilité directe n’est pas évidente. Pourtant gouvernance partagée ne veut pas dire responsabilité diluée, mais responsabilité partagée. Après, c’est une réalité : la gouvernance partagée, ce n’est pas tous les jours facile. Néanmoins nous avons appris de nos expérimentations, et nous avons été formés aux méthodes de la sociocratie5.
Pascale Caron : La question de la formation est fondamentale. Dans le pays Diois, nous avons la chance d’avoir un Accordeur qui est formateur en sociocratie.
Zoé Renaut-Revoyre : Au-delà de savoir-faire, la gouvernance partagée c’est aussi beaucoup de savoir-être. Et certains ne souhaitent pas ou ne peuvent pas changer de posture et de mode de fonctionnement, ce qui est tout à fait compréhensible ! Le passage à la gouvernance partagée n’est possible qu’avec une volonté collective, comme cela a été le cas dans le pays Diois ou à Surgères.
Chaque Accorderie décide du type de gouvernance qu’elle veut prendre, parfois en prenant seulement certains éléments de gouvernance partagée, parfois en y allant à fond. Nous déconseillons même aux Accorderies qui souhaiteraient sauter le pas, mais sans avoir de consensus à ce sujet, de le faire. Le risque serait de mettre l’Accorderie en difficulté et d’épuiser la ou le salarié.
Audrey Leyrat : Aucune gouvernance n’est idéale. À Limoges, ne pas avoir adopté un schéma de gouvernance partagée ne nous empêche pas d’être très vigilants pour éviter les écueils du schéma classique CA-bureau. Notre conseil d’administration répond au Conseil des Accordeurs, et non l’inverse, ainsi nous partons toujours des envies des Accordeurs.
Pascale Caron : La vraie limite est celle posée par Audrey : est-ce que ce sont bien les Accordeurs qui font vivre l’Accorderie ? Il faut toujours adapter le modèle de gouvernance aux Accordeurs qui la composent : il n’y a effectivement pas de modèle idéal unique, mais un modèle adapté à l’Accorderie d’un territoire donné à un moment donné.
- 1Lire à ce sujet Hannah Olivetti (La Fonda), « Les Accorderies, des échanges de services par et pour les habitants », Tribune Fonda n° 251, septembre 2021, [en ligne].
- 2Réseau des Accorderies, Les Accorderies à la loupe – Évaluation participative, 2019-2020, [en ligne].
- 3Selon la dernière étude d’impact réalisée par le Réseau des Accorderies, 54 % des Accordeurs sont isolés, 33 % des familles d’Accordeurs disposent d’un revenu inférieur à 10 000 € et 24 % des Accordeurs sont sans emploi.
- 4Dans l’Accorderie du pays Diois, qui utilise la méthode de la sociocratie, la gouvernance est organisée en « cercles », similaires aux commissions d’autres structures.
- 5Luc Hansen (La Fonda), « La sociocratie en pratique, l’exemple du réseau des Accorderies », Université du Faire ensemble, septembre 2022, [en ligne].