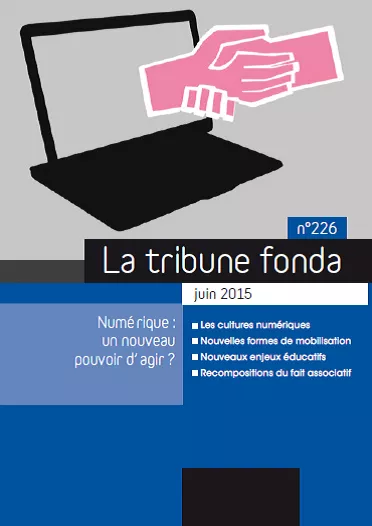C’est à partir du concept de « biens communs » que Philippe Aigrain a abordé la question du partage dans la culture numérique.
Que partage-t-on dans l’espace numérique, quel statut donner à ce partage ? En quoi les formes de partage de l’espace numérique sont-elles différentes de celles d’autres domaines ? Telles sont les pistes proposées par Philippe Aigrain pour saisir en quoi le partage numérique, activité non marchande, inter- agit avec l’économie marchande.
Si dans la plupart de ses acceptions, le partage est étymologiquement une division et une répartition, dans son acception numérique, le partage est une multiplication par copie, échange ou transmission. S’y ajoute une polysémie entre le partage comme « avoir en commun un état abstrait » (partager une opinion) et le partage autorisé par la mise en commun d’entités concrètes (partager des fichiers). Le partage par multiplication s’effectue de personne à personne, de pair à pair. Pour Philippe Aigrain, il est rendu possible par sa mise sous un statut de bien commun, de fait ou de droit. Définis ainsi, les communs numériques attribuent des droits d’usage à une communauté universelle (le genre humain) plutôt que particulière comme pour la plupart des communs physiques. En se référant à la définition de Benjamin Coria, « un commun, ou un bien commun, suppose l’existence d’une ressource », on voit que cette ressource extérieure aux êtres humains peut être physique (eau d’une rivière, bois d’une forêt) ou informationnelle (logiciel, contenus), la grande différence entre les communs informationnels (ou communs d’information et de connaissance, ou communs numériques) et les communs physiques résidant dans le degré de séparabilité entre la ressource et les pratiques.
Si l’accès aux communs physiques et leur usage doivent être restreints pour éviter leur épuisement ou détérioration, comme l’ont montré Elinor Ostrom ou Garrett Hardin en 1968 dans La Tragédie des communs, les communs numériques se rapprocheraient, selon certains économistes, des biens publics (biens publics parfaits) puisque leur usage par une personne n’empêche pas leur usage par une autre, d’où l’appellation de biens non rivaux. Cet aspect anti-rival des biens numériques fait obstacle à une restriction des usages et est à l’origine d’effets de réseaux qui favorisent la conquête massive des usages par le plus grand nombre (via les moteurs de recherche, réseaux sociaux ou logiciels) mais rendent souvent difficile l’émancipation et la reprise de souveraineté des individus et des groupes.
Une topographie des biens informationnels et de leur statut est rendue compliquée par l’histoire du droit d’auteur et autres droits exclusifs. On est passé d’une vision philosophique des biens communs numériques, celle de Benjamin Franklin qui, en déclarant « celui qui allume sa chandelle à la mienne ne me prend pas de lumière », confirme le caractère non rival des biens communs numériques, à une vision de biens communs aux droits exclusifs, sans qu’ait été organisée pour autant la coexistence entre les communs partagés et ceux assortis de droits (biens rendus propriétaires, biens exclusifs par les droits de propriété littéraire, artistique, industrielle). Prolongeant les travaux de James Boyle Philippe Aigrain a, dans un article intitulé « Droits intellectuels positifs et échanges d’information » (2000), clarifié la situation en inventoriant les communs informationnels selon quatre composantes : les biens inappropriables (les idées), les biens objet de droits exclusifs expirés (le domaine public traditionnel ou structurel), les biens objet de droits exclusifs placés volontairement sous statut de commun (les licences de logiciels libres ou de contenus) et les droits d’usage objet de droits exclusifs mais considérés comme des exceptions, ou limitations, aux droits exclusifs (droit de citation, de parodie, dépôt légal).
Aucune de ces composantes n’a de statut positif dans le droit la décrivant comme un commun, les licences du partage volontaire elles-mêmes étant en réalité des contrats sur la base de droits exclusifs.
Alors, que signifie un statut de commun ? Si beaucoup pensent que les communs sont une forme de propriété, commune ou collective, Philippe Aigrain, tout en admettant la domination de la notion de propriété, s’appuie sur les attributs de la propriété issus du droit romain, l’usus (droit d’user d’un bien), le fructus, (droit d’en tirer profit et d’obtenir un profit dérivé) et l’abusus (droit d’interdire à d’autres d’en user), pour montrer qu’un commun agence usus, fructus et abusus différemment que dans le cas de la propriété. Pour les biens communs numériques, et plus largement les communs intangibles, l’usus est en général attribué à une communauté universelle (le genre humain), le fructus à tous (cf. la licence Creative Commons) sauf exceptions (aux auteurs et cessionnaires pour les œuvres culturelles) et l’abusus à personne, prouvant ainsi que les communs ne sont pas une forme de propriété. Même si l’usage n’est pas libre de toute règle, il est interdit d’interdire d’user des communs numériques en raison d’un droit de propriété.
Si le numérique a ouvert la voie aux pratiques non marchandes, c’est parce que des activités autrefois réalisées dans un contexte professionnel sont maintenant à la portée de tout individu muni de matériels, y compris dans les industries culturelles (cf. la distribution et l’échange à grande échelle des œuvres numériques). Dans une société dominée par l’économique, les pratiques non marchandes apparaissent comme une sorte d’aberration, ou un échec du marché qui n’a pas su les intégrer à ses pratiques. L’étude des relations entre partage non marchand et économie marchande qu’il a conduite dans le domaine culturel, montre la tentation de certains d’exclure du partage les activités non autorisées au titre des droits exclusifs, au motif que ceux-ci seraient constitutifs d’une propriété sur les biens et qu’on ne peut donc pas partager ce que l’on ne possède pas. Or, pour lui, cette appréciation se révèle infondée, d’autant plus si on s’appuie sur ce que disait en 1791 Isaac-René-Guy Chapelier au sujet des droits du public : « Quand un auteur a livré son ouvrage au public, quand cet ouvrage est dans les mains de tout le monde, que tous les hommes instruits le connaissent, qu’ils se sont emparés des beautés qu’il contient, qu’ils ont confié à leur mémoire les traits les plus heureux, il semble que dès ce moment, l’écrivain a associé le public à sa propriété ou plutôt la lui a transmise toute entière. » Dans toute œuvre, une part ne vient pas de son propriétaire ou producteur mais préexiste comme quelque chose appartenant au patrimoine commun et légitimant une exigence de partage. Que l’on convienne ou non qu’on ne peut pas partager ce que l’on ne possède pas, un point est sûr : à l’ère numérique, on partage beaucoup, principalement hors marché, sans transactions monétaires ni quêtes de profit de la part des praticiens, y compris dans le cadre des activités créatives.
Mais, l’impact des activités marchandes sur les communs du partage non marchand est-il aussi fort ? Philippe Aigrain rappelle que le partage non marchand est un espace d’accès à la culture et au savoir mais surtout de développement humain, qui nécessite du temps et des ressources. Il existe deux façons par lesquelles l’économie peut entrer en relation avec les communs du partage : celle de l’économie du partage où les acteurs économiques gèrent les modalités du partage, en deviennent les intermédiateurs, en capturent les externalités économiques positives, mais où les praticiens du partage sont privés d’une capacité à en orienter les buts, les modalités et les outils, ce qui rend le modèle destructeur du potentiel de développement humain ; celle de la mutualisation des ressources, des pratiques non marchandes, qui se décline en divers sous-modèles mais suppose du temps, de l’investissement (dans des projets, machines, matériels), des processus d’apprentissage souvent coûteux, ce qui rend le modèle, malgré des difficultés de mise en place ou des risques d’appropriation par des intérêts particuliers, plus favorable au développement humain.
Pour conclure, Philippe Aigrain a resitué la place de l’humanisme dans le partage et les biens communs. Selon lui, la mise en commun des outils, des productions intellectuelles et créatives est la condition même de l’humanisme numérique puisque c’est elle qui détermine qui aura la capacité d’influer sur le devenir du monde numérique. Encore, faut-il avoir la volonté de s’interroger sur la nature de ce devenir (au niveau des outils, des échanges sociaux, des façons de partage) dans un contexte d’abandon du devenir de nos outils de pensée et de socialité à des acteurs qui ne nous laissent pas participer au débat sur les orientations. En permettant l’externalisation de processus mentaux, de pans entiers d’activité de l’esprit, le numérique induit une mutation anthropologique et sociale (l’humain de l’âge numérique ne sera plus de même nature que ses prédécesseurs bien qu’ayant le même substrat biologique) qui oblige à revisiter les formes d’arts de vivre, de penser, d’interagir avec les autres dans le cadre d’un nouvel humanisme qui devra non pas tant décréter ce que doivent être les êtres humains, mais créer les pratiques et les environnements qui leur permettent de chercher ce qu’ils veulent être pour se développer individuellement et collectivement.