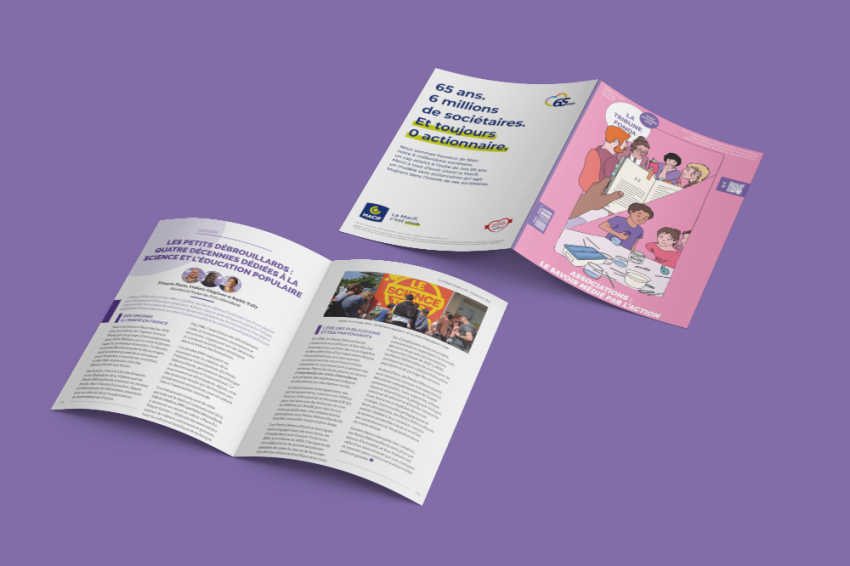À quoi bon savoir, si plus personne n’y croit ? Nous vivons une époque où la notion de vérité est de plus en plus malmenée. Désormais, le fact-checking1, le debunking2 et l’éducation à l’esprit critique sont entrés dans notre quotidien.
C’est le signe que nous faisons face à une crise de l’expertise : les savoirs établis sont contestés, les autorités de référence fragilisées, et l’abondance d’informations rend plus difficile la distinction entre ce qui est vrai, plausible ou inventé.
Pourtant, pendant des siècles, la production de connaissances a reposé sur des institutions sélectives et hiérarchiques.
Universités, académies, grandes écoles garantissaient l’autorité du savoir en contrôlant ses conditions de production et de transmission. Elles assuraient à la fois la conservation, la validation et l’innovation. Ce système a façonné nos démocraties modernes, en donnant aux citoyens des repères communs, en produisant des outils de compréhension collective.
Mais ce monde s’efface. La circulation des informations n’a jamais été aussi massive, instantanée et horizontale. Dans ce nouvel écosystème, la figure du médiateur — chercheur, journaliste, vulgarisateur — perd de son autorité. Les controverses prolifèrent, les certitudes s’effritent, et l’expertise semble souvent une opinion parmi d’autres.
C’est dans ce contexte que les associations jouent un rôle décisif. Dès l’origine, elles ont été pensées comme des lieux de mise en commun de connaissances. Leur transmission et leur partage sont constitutifs du projet associatif selon la loi de 1901.
Les associations sont d’abord des espaces de transmission. Comme le rappelle Emmanuel Porte dans ce dossier, l’éducation populaire propose depuis des décennies une transmission critique des savoirs, qui vise l’émancipation3.
Les associations produisent elles- mêmes des savoirs.
La recherche-action, présentée dans l’entretien croisé entre Paul Bucau, Stéphanie Bost et Floriant Covelli4 et l’article consacré à la Cabane de la recherche5, propose ces connaissances ancrées dans le réel, utiles à l’action comme à la réflexion.
Enfin, les associations sont des espaces d’émancipation par la connaissance. Par le collectif, chacun peut apprendre, transmettre, développer ses capacités. Wikipédia illustre ce potentiel : l’encyclopédie en ligne bénévole a permis à des milliers de contributeurs de devenir producteurs de savoirs, et pas seulement consommateurs. Mais l’article de Robert Fernandez6 rappelle aussi les tensions de ce modèle : comment accueillir de nouveaux participants, comment maintenir un dialogue équilibré entre anciens et nouveaux membres ?
Dans les associations, les savoirs sont mis à l’épreuve du terrain, les expériences nourrissent la réflexion.
Ce cycle vivant distingue l’association d’autres institutions. Les associations inventent une éthique de la connaissance ouverte, collective, orientée vers l’émancipation. Ce faisant, elles rappellent la promesse formulée par Christian Saout : « Savoir, c’est pouvoir »7. Mais ce pouvoir ne se conçoit que s’il est partagé.
La bataille du savoir est devenue une bataille politique. Elle oppose ceux qui instrumentalisent l’imaginaire et l’obscurantisme pour manipuler et diviser, à ceux qui cherchent à construire du commun. Dans cette bataille, les associations sont en première ligne. Parce qu’elles refusent de séparer expertise et expérience. Parce qu’elles inventent, au milieu du vacarme des opinions, des pratiques concrètes de délibération et de coopération.
Faire connaissance : l’expression dit bien ce qui est en jeu. C’est à la fois un acte intellectuel (apprendre, transmettre, débattre) et un acte politique (tisser du lien social, se reconnaître comme citoyens égaux). Dans un monde saturé d’informations, ce n’est pas un luxe. C’est une nécessité démocratique.
- 1
Terme anglophone traduisible par « vérification des faits », le fact-checking désigne un ensemble de pratiques et d’outils développés par les journalistes pour vérifier une information.
- 2
Dérivé du verbe anglophone debunk, soit démentir ou réfuter, le debunking est une pratique consistant à réfuter ou démystifier un concept ou une théorie.
- 3
Emmanuel Porte, « L’éducation populaire, “faire ensemble” pour s’émanciper », Tribune Fonda n°267, septembre 2025.
- 4
Stéphanie Bost, Paul Bucau et Floriant Covelli, « Les associations sont des lieux de production de connaissances ! », Tribune Fonda n°267, septembre 2025.
- 5
Lire l’article « La cabane de la recherche, une recherche de proximité avec et pour la société », dans ce numéro.
- 6
Robert Fernandez, « Les limites du bénévolat et les gardiens de l’ordre encarta », Tribune Fonda n°267, septembre 2025.
- 7
L’alors président de l’association Aides de lutte contre le sida (Aides), présentait ainsi le projet de l’association : « Savoir, c’est pouvoir. C’est ça qu’on veut : […] avoir de la connaissance pour pouvoir mener sa vie de malade, sa vie de patient, du mieux qu’on l’entend. » Dans Abécédaire de la démocratie sanitaire, un documentaire réalisé par Juan Gelas pour le Collectif interassociatif sur la santé (CISS) en 2015.