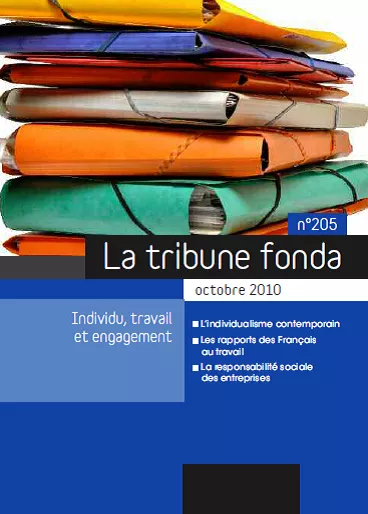Paradoxalement, c’est le contexte de mondialisation et les défis sont apparus de manière forte au niveau de la planète, qui ont fait que les entreprises se sont fait rattraper par des questions dont elles ont pu penser pendant très longtemps qu’elles ne relevaient pas de leur responsabilité, mais de celle des états et des sociétés. Finalement, on peut se demander si la crise ne va pas « booster » ce concept de Rse (responsabilité sociétale de l’entreprise) et favoriser l’implication des entreprises.
La mondialisation a été pour les entreprises multinationales une formidable occasion de croissance et de développement. En même temps apparaissent les grands sujets du réchauffement climatique, avec les enjeux d’économie d’énergie et de diversification des sources d’énergie et plus généralement l’idée de développement durable. Celle-ci a été définie par Mme Brundtland en 1987 dans son rapport à l’Onu, comme « un développement qui satisfait les besoins des générations actuelles, y compris des plus démunis, sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs ». Il y a là une prise en compte du lointain et du moyen terme qui tranche avec le « cour-termisme » et l’urgence dans lequel fonctionnent l’économie et surtout la finance.
La mondialisation favorise la prise de conscience de la nécessité du développement durable
Johannesburg a été le déclic qui a permis la sensibilisation de l’opinion : la question des écarts de développement, de la pauvreté, les problèmes d’accès aux biens essentiels apparaissent comme une injustice criante qui mobilise les acteurs. Progressivement, ceci est analysé comme un frein au développement équilibré de la planète, ce qui finit par avoir des répercussions même sur les pays développés. Donc, comme une menace potentielle.
Avec le développement durable est également prise en compte la vulnérabilité des systèmes administratifs et politiques parce que source de détournements des fruits de la croissance avec la corruption, ou source d’atteintes aux droits de l’homme. Les Ong portent ces questions au point de les amener à la porte et parfois même à l’intérieur de l’entreprise.
Telle est la réalité de la mondialisation, l’imergence de défis liés au développement durable et, en même temps, le rôle croissant des parties prenantes associatives, Ong et organisations professionnelles internationales, qui relaient ces grandes causes. En l’absence d’un gouvernement mondial, dont on espère que certains éléments apparaîtront avec le G20, mais qui ne peut constituer un interlocuteur en face de ces revendications, l’entreprise au niveau international, avec ses marques, sa puissance, avec le niveau de chiffre d’affaire et de profit qui est le sien apparaît comme centrale quant aux conditions pour préparer l’avenir, répartir les richesses, prendre en compte ou ignorer ces grands défis internationaux.
Les entreprises de plus en plus concernées
Les entreprises au niveau international s’emploient à valoriser leur marque. Plus visibles, elles sont aussi plus exposées, donc, davantage sollicitées, attendues, controversées. Aucune entreprise multinationale ne peut ignorer ces interpellations et ne pas y répondre.
On peut rappeler toute une série d’événements !
En 2002, Kofi Annan ouvre à Johannesburg le sommet mondial sur le développement durable en interpellant les entreprises. C’est le sommet qui a vu la présence du plus grand nombre d’entreprises. Là, se met en mouvement un discours, une rhétorique mais cela modifie aussi leur manière d’agir. Il les invite à participer, à côté des états, à la résolution des problèmes évoqués pendant ce sommet.
En 2002 toujours, en France, la loi sur les nouvelles régulations économiques oblige les entreprises à publier les fameux rapports de développement durable. C’est un premier acte témoignant du fait que l’entreprise doit rendre des comptes sur ce qu’elle fait ou non. Cette loi, au moment où sont créés les dispositifs d’épargne salariale, de fonds de pension ou d’épargne-retraite, demande également aux gestionnaires de cette épargne (sur pression syndicale) d’intégrer dans leurs choix de placements des critères de nature sociale, environnementale et sociétale. Il y a là aussi, un embryon de prise de conscience, un levier qui permet de franchir une étape supplémentaire du point de vue législatif et réglementaire.
Le Global Compact, encore à l’initiative de Kofi Annan, contient dix engagements auxquels les entreprises sont appelées à adhérer de manière volontaire sans beaucoup de contraintes puisque la seule obligation est de rendre compte régulièrement sur un, deux ou trois de ces engagements. Ces engagements touchent au respect des droits de l’homme, à la conformité avec les conventions de l’Oit, à la valorisation des ressources humaines, à la protection de l’environnement et des personnes. Cela touche aussi à la capacité des entreprises à faire bénéficier les bassins d’emplois des résultats de leur activité. Cela concerne la relation avec les clients et les fournisseurs, ainsi que la manière dont l’entreprise s’engage sur des causes d’intérêt général. Cela touche, enfin, à la question de la corruption. Si les entreprises les mettaient réellement en place, ces engagements changeraient profondément les choses.
Aujourd’hui, se discute une norme Iso 26 000 qui devrait être prête en 2010 et veut poser le cadre de référence de la responsabilité sociale et environnementale de toutes les organisations (partis politiques, associations, syndicats, etc.) et pas seulement des entreprises. C’est un peu confus, car ce n’est quand même pas tout à fait les mêmes engagements que l’on peut attendre d’organisations aux fonctions si différentes. Mais cette norme est un signe : on s’interroge de plus en plus sur ce que serait un comportement responsable.
Les principes de l’investissement responsable ont été initiés au niveau de l’Onu par les grands investisseurs internationaux. Historiquement, aux États-Unis, il y a une manière éthique d’investir, partant du principe que l’épargnant a les moyens de mettre en cohérence ses idées, ses préférences collectives, sociales, religieuses, morales, philosophiques, avec ses choix d’investissement. Ces investisseurs militants excluent certaines sociétés au motif de ce qu’elles produisent : entreprises liées au tabac, aux jeux de hasard, à la pornographie, au nucléaire.
Un autre type d’investissement est arrivé plus tardivement, notamment en France : l’investissement solidaire. Il rassemble des individus ou des collectivités qui acceptent qu’une partie du rendement soit réaffectée à des projets, à des initiatives à caractère social ou solidaire. Ces investissements rassemblent au niveau international 13 000 milliards de dollars. Ces gens prennent conscience que les questions sociales, environnementales et de gouvernance auront un impact sur la rentabilité durable et sur la sécurité du placement. C’est une révolution par rapport à la pratique habituelle qui ne s’intéresse qu’aux rendements à court terme. Ces mêmes signataires sont dans l’économie et dans la finance réelle.
Enfin, la création des agences de notation comme Vigéo est le complément de ces processus. On attend d’elles qu’elles renseignent les investisseurs et gestionnaires d’actifs qui veulent pratiquer un investissement responsable et avoir de l’information sur la manière dont les entreprises intègrent des facteurs environnementaux et sociétaux de performance.
Le rôle des agences de notation
Les informations nécessaires pour faire ce travail, doivent être complètes, fiables. L’absence, en soit, d’informations est déjà une information. Avec le développement des agences, les entreprises se sont progressivement organisées pour avoir des systèmes de reporting sur les questions environnementales, sociales et sociétales à l’instar de ce qu’elles font au plan financier.
Face à tout cela, que fait l’entreprise ? Il y a d’une part, celles qui disent : « Bon voilà des contraintes supplémentaires ; ce n’est pas pour cela que l’entreprise existe. C’est en train de nous détourner de notre objectif, mais c’est la loi. C’est un coût supplémentaire. » Bref, la posture classique de l’entreprise qui se protège, qui fait ce qu’il faut, mais sans plus. Mais, certaines ont compris qu’il y a un principe de réalité, ou tout simplement une maîtrise des risques. Elles se rendent compte que parfois, une campagne de presse attaque la réputation de l’entreprise qui est plus difficile à reconstruire surtout quand la marque joue un rôle déterminant pour l’attractivité des clients sur le marché des produits et des capitaux. Du coup, ces entreprises ont été plus attentives à repérer les principaux risques pour s’en prémunir (dans les faits ou seulement dans la communication, les deux cas sont possibles).
Les entreprises gagnantes sont celles qui ont la capacité d’intégrer les nouveaux enjeux de la Rse dans leur stratégie de recherche et développement : de nouveaux process de production, là où il y a de nouveaux enjeux écologiques, de nouveaux marchés, de nouveaux créneaux à déployer. On est dans l’authenticité et la stratégie ; on n’est pas dans du colmatage et de la peinture que l’on met un peu sur les murs ou sur les rapports que l’on publie.
Les différentes approches des entreprises
Trois approches sont mises en œuvre par les entreprises.
► L’approche par les valeurs, par les chartes de bonne conduite, les codes éthiques. Qu’une entreprise à un moment donné s’interroge sur les valeurs qu’elle veut promouvoir et qu’elle veut voir portées par ses collaborateurs, c’est bien. Mais il ne faut pas tomber dans la naïveté qui consiste à croire que parce qu’on affiche une valeur, elle va s’incarner dans les comportements et les pratiques.
► D’autres entreprises s’aperçoivent que derrière les valeurs, il faut faire quelque chose. C’est une démarche vers de bonnes pratiques. Chacune demande à ses établissements ou filiales de faire remonter des informations (actions, illustrations) qui montrent qu’elle est en ligne avec ce qu’elle affiche. Les premiers rapports sont nés en indiquant une succession de bonnes actions, de bonnes pratiques. Ce n’est pas inutile. On trouve aussi les actions de mécénat. Actions de mécénat qui font partie de cette responsabilité sociétale mais qui ne saurait la limiter à cela.
► Enfin, il y a une approche plus récente, par le dialogue avec les parties prenantes organisées. L’entreprise va repérer quelles sont les associations, les Ong, institutions internationales (Wwf plus que Greenpeace, Amnesty International) qui sont concernées ou qui peuvent être les plus menaçantes pour prévenir les risques. L’entreprise engage des partenariats, des relations suivies pour pratiquer des actions au niveau social, environnemental ou sociétal. Par exemple, aujourd’hui en France on voit se développer des actions dans les quartiers vulnérables pour faciliter l’entrée dans l’entreprise de jeunes plus loin de l’emploi. Cela est souvent relayé par des associations qui jouent un rôle d’intermédiaire.
Ces trois démarches sont intéressantes mais elles ne permettent pas d’aller sur ce que pourrait être une vraie démarche d’intégration aux objectifs, à la stratégie et aux opérations de l’entreprise, de facteurs sociaux, environnementaux et sociétaux. Là, on rejoint la capacité de l’entreprise à mener une réflexion stratégique, à s’engager pour porter au niveau de la marque et de toute l’entreprise la Rse.
La méthode d’évaluation d’une agence de notation comme Vigeo
Est-ce qu’une agence comme Vigeo est capable de mesurer la tangibilité et le niveau de l’engagement de l’entreprise. Que mesure-t-on ?
Des partis pris doivent être adoptés au départ. Vigeo n’a pas voulu se focaliser uniquement sur ce qui est dans l’air du temps, sur le nombre de controverses que l’entreprise a ou non dans les média, vis-à-vis d’Ong ou d’autres organismes pour en déduire la tangibilité effective de son implication. C’est un indicateur important, mais ce n’est pas la manière dont on mesure la tangibilité de l’intégration des objectifs.
De même, le choix n’a pas été fait de se limiter à des indicateurs de résultats. La grande question aujourd’hui dans tous les cercles qui s’occupent de la responsabilité sociale, c’est : trouvez-moi quelques indicateurs de résultat simples qui vont permettre de savoir si l’entreprise a avancé. Mais sur ces mécanismes, les indicateurs de résultats sont insuffisants. Si nous voulons vraiment savoir si l’entreprise intègre à ses stratégies et à ses opérations ces éléments, il faut avoir une capacité de mesurer quels objectifs elle se donne. Sont-ils pertinents sur les trois plans, social, environnemental et sociétal ? Il n’existe pas encore au niveau international de référentiel comme cela peut exister en France avec le bilan social. Vigéo a fait le choix de se référer à ce que les institutions internationales (Oit, Oms, Onu, etc.) ont énoncé comme normes ; la « soft law ». C’est à partir de cela que nous pouvons dire s’il y a complétude sur les objectifs portés et pertinence sur les pratiques. Ceci est évalué sur une échelle de un à quatre.
Mais tout cela repose sur du déclaratif. Il faut aussi prouver que par rapport à ces objectifs, les moyens ont été mis en œuvre (plans d’action, process, reporting, etc.). C’est le deuxième segment observé, le déploiement des moyens. Enfin, troisième segment est celui de l’efficacité. On note les indicateurs de résultats qui doivent être pertinents par rapport à ce qu’ils mesurent et comparables dans un secteur d’activité donné.
En agrégeant ces trois segments, nous obtenons une mesure de l’engagement de l’entreprise, donc de la maîtrise du risque par le système managérial.
Qu’est-ce qui fait la différence entre les entreprises ? Ou bien l’entreprise est sur la logique de s’en servir comme opportunité, comme créneau de développement et là on peut avancer. Ou bien elle reste dans quelque chose de frileux et de contraint et cela n’a plus du tout le même impact.
Une remarque : c’est très souvent le choix du dirigeant de s’engager, cela dépend de sa capacité dans l’entreprise de dire : « Allez, on n’a plus le choix et on y va ! » ou au contraire « On y va, mais n’en faites pas trop ! ». Évidemment, cela change tout dans la manière dont cela va se passer. Il serait nécessaire que la Rse soit davantage portée par le mouvement syndical.
Les arbitrages nécessaires
Ce sont donc l’entreprise elle-même et le dirigeant qui s’engagent, or celui-ci est contraint par ses investisseurs. Comment cohabitent ces éléments contradictoires ? Le nerf de la guerre, la finance ne risque-t-il pas de prendre le dessus ou les choses peuvent-elles se rééquilibrer ?
C’est là que la crise intervient. Nous devons être capables d’apprendre de cette crise et de faire autrement. Aujourd’hui, tout est orienté vers la logique de l’actionnaire ; les dirigeants étant eux-mêmes aliénés par leur mode de rémunération. Ils n’affrontent pas les assemblées générales sur ces questions, à l’exception d’une ou deux entreprises françaises.
Un second débat se pose aujourd’hui : la conception partenariale de l’entreprise, considérant que l’investisseur-actionnaire est un partenaire, parmi d’autres : ses salariés, ses clients, ses territoires, ses fournisseurs et sous-traitants. La posture de l’entreprise exige que les partenaires deviennent performants ensemble, parce que la chaîne de valeurs qui va se créer entre ces différentes personnes devient du « gagnant-gagnant » pour tout le monde.
Franck Riboud, pdg du groupe Danone, affirme que l’entreprise devait renouveler sa relation aux parties prenantes. Il explique qu’il ne peut grandir si ceux qui font son métier à l’autre bout du monde, des fournisseurs aux distributeurs, ne progressent pas en même temps, en qualité, en capacité à respecter les standards sociaux et environnementaux. C’est une condition pour être créateur de richesses durables. On avance dans cette direction. Il y aura toujours des arbitrages à faire entre l’intérêt des actionnaires et des salariés. Ce qui est important, c’est qu’ils deviennent explicites et que l’on puisse savoir pourquoi et comment ces arbitrages ont été faits.
Finalement, ce qui est en jeu, c’est le partage des profits ou l’injonction de Nicolas Sarkozy sur le partage en trois tiers. Ce n’est pas les trois tiers qui comptent, c’est le principe. Si l’on parle du partage de la valeur ajoutée, c’est pour les salariés en premier lieu, mais comme Franck Riboud le dit : « J’extrais 100 millions d’euros des profits avant la répartition pour pouvoir financer des actions en faveur de mes autres parties prenantes ». Cela a été voté à l’assemblée générale et c’est la preuve que les dirigeants redeviennent offensifs, capables d’affronter leur assemblée générale et d’argumenter sur l’intérêt de l’entreprise.
Synthèse réalisée par Henry Noguès (Fonda). Les éventuelles erreurs d’interprétation n’engagent que lui et non les communicants de la rencontre du 28 avril 2009 à la Maison de l’Europe à Paris.