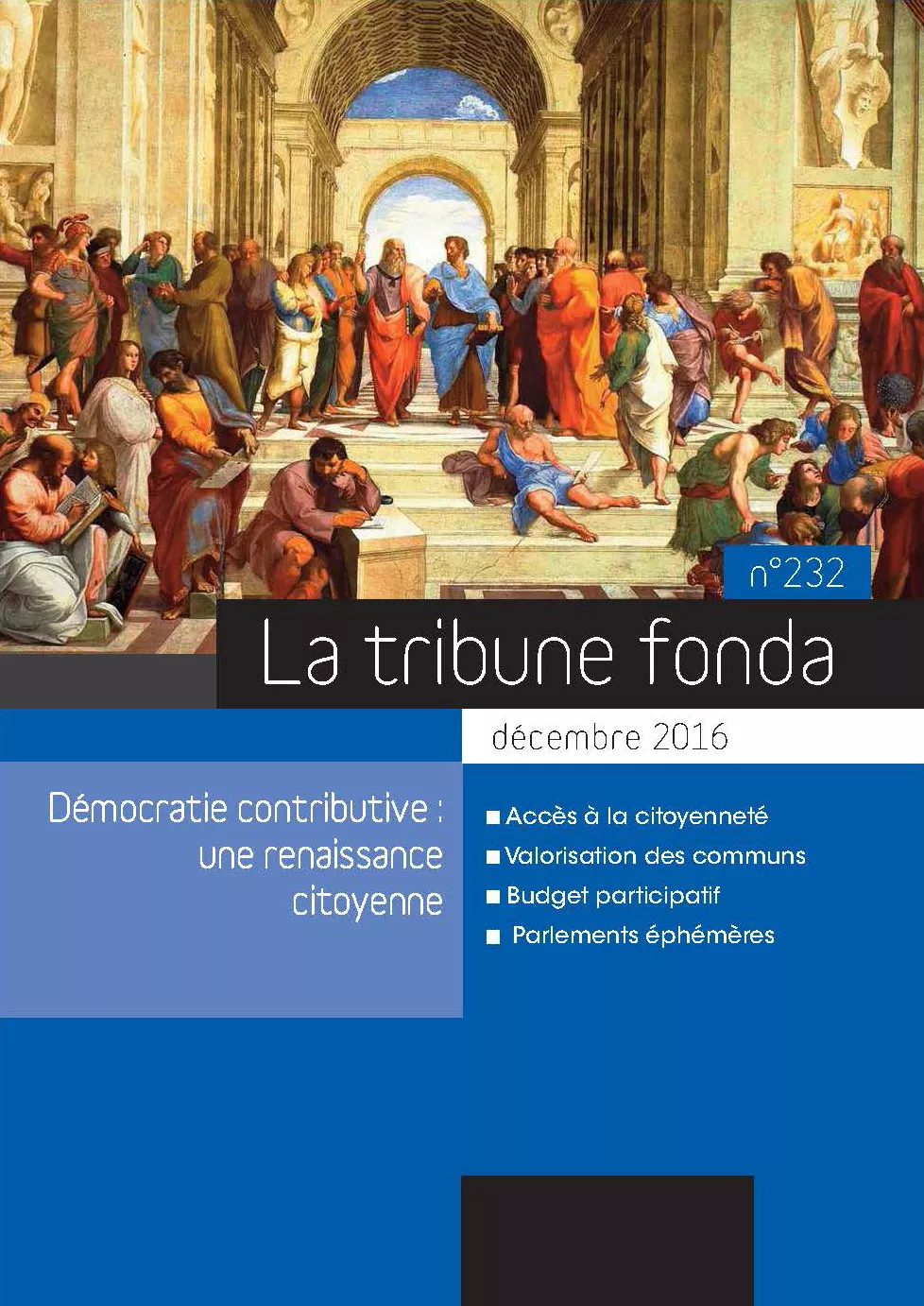Cet article est une contribution de la version numérique enrichie de la Tribune Fonda n°232. Il ne figure pas dans la revue papier.
La vie politique française oscille actuellement entre plusieurs pôles. Le premier, c’est la reproduction d’un système solide dans ses fondations, mais dans lequel les Français se reconnaissent de moins en moins, et dont l’acmé pourrait être la réédition, en mai 2017, du duel présidentiel de 2012. Le deuxième, c’est la tentation populiste, qui n’est pas antagoniste de la première hypothèse, situation qu’illustre la campagne des primaires américaines. Le troisième pourrait être l’émergence d’une offre politique nouvelle née du terrain, telle que Podemos en Espagne, Cinq Stelle en Italie, et qui peine à émerger en France.
Cette période d’instabilité rend l’élection présidentielle de 2017 incertaine, en tout cas révélatrice de l’entrée dans un nouveau cycle. Cependant, l’erreur serait de rester dans une analyse habituelle du système français et de se focaliser sur des échéances électorales. Les blocages actuels du lien entre la société et la politique ont des racines bien plus profondes que le seul manque de renouvellement de la classe politique, ou son caractère oligarchique.
Le fossé grandissant se situe à un autre niveau : c’est celui entre l’immobilisme des élites politique et l’agilité de la société. Ce fossé est d’autant plus important que l’histoire politique française a produit plusieurs freins à l’agilité, comme la faiblesse de la notion de contrat par rapport à la loi, et la primauté de l’égalité a priori sur l’égalité a posteriori, qui bloque beaucoup d’initiatives.
L’émergence de nouvelles formes d’engagement citoyen
Pour autant, on ne peut pas déplorer un désintérêt des citoyens pour la chose publique. La jeunesse française figure même parmi les plus engagées d’Europe. Selon une étude de l’Association Fondation étudiante pour la Ville (AFEV) , 56% des jeunes ont un engagement associatif, plus de la moitié disent que la politique est importante dans leur vie et plus de 8 sur 10 suivent l’actualité. On observe aujourd’hui, chez les jeunes et plus généralement dans la société, une réappropriation du politique par de petits actes quotidiens et par des actions politiques « non conventionnelles ».
Ces cinq dernières années ont vu l’émergence d’une multitude de nouveaux modes d’expression, qu’il s’agisse des pétitions en ligne (Change.org par exemple), des sites comme GOV pour noter les hommes politiques et choisir ses sondages, ou du renouveau d’actions politiques de proximité. L’expression citoyenne en temps réel et l’action citoyenne de terrain constituent de véritables contre-pouvoirs qui commencent à avoir un impact sur la politique. La grâce présidentielle accordée par François Hollande en janvier 2016 à Jacqueline Sauvage suite à une pétition de 400 000 signatures illustre ce phénomène.
Immobilisme des élites VS agilité citoyenne
Ces nouvelles modalités d’expression citoyenne dessinent un modèle plus horizontal que vertical avec lesquels les politiques sont encore mal à l’aise. La réponse de François Hollande dans une émission « Face aux Français », était de ce point de vue révélatrice : face à une mère d’élève, en zone rurale, qui craignait la fermeture du collège de son enfant, il avait proposé d’appeler le recteur. Ce à quoi elle avait répondu qu’elle souhaitait plutôt un soutien pour mettre en place des projets d’enseignement à distance via les outils numériques ! Cruelle illustration du décalage entre l’agilité de la société, sa capacité à inventer des solutions, et la rigidité des acteurs institutionnels qui apportent des réponses de gestionnaires quand on attendrait une vision.
Ces nouveaux modes d’action dessinent également une échelle de subsidiarité et de proximité intéressante qui a du mal à fonctionner en France. Quand le Gouvernement crée un label « La France s’engage » pour favoriser et fédérer les innovations sociales, c’est une excellente idée. Mais la machine administrative française peine à penser les complémentarités et les bonnes articulations de la société civile et de l’action publique.
Outre cette question essentielle de la formation des agents de l’Etat et des profils, il est urgent d’imaginer une gouvernance tenant compte des nouvelles formes d’engagement et des nouveaux usages numériques. Pour combler le fossé entre Etat et citoyens et avancer vers une co-construction des politiques publiques, trois pistes méritent d’être explorées.
Un État stimulateur, organisateur de nouvelles relations sociales
La première, c’est l’évolution vers un État stimulateur, qui encourage la libre initiative des citoyens en leur donnant un cadre et des moyens pour agir. Voter tous les cinq ou six ans ne suffit pas quand on note plusieurs par jour son chauffeur Uber. Il faut intégrer les citoyens à l’élaboration des politiques publiques. L’exemple de la Plateforme « Parlement et Citoyens » est de ce point de vue une réussite pour associer la société civile à la rédaction de propositions de lois. Au niveau local, le développement de budgets participatifs représente une jonction intéressante entre l’expression d’un avis citoyen et sa réalisation concrète.
Pour laisser plus de place à l’action citoyenne, on pourrait aussi imaginer des « Fab lab politiques » permettant d’expérimenter des idées nouvelles. Le travail effectué par l’association « La 27e région » est à ce titre très intéressant car il s’appuie sur l’expérience des usagers pour réinterroger les politiques publiques. A partir de « territoires en résidence », et sur une thématique précise (santé, lycées, transport en zone rurale, etc.), l’objectif est de préciser les attentes de tous les acteurs, en favorisant le dialogue pluridisciplinaire.
Le monde de l’entreprise : une source d’inspiration pour l’Etat ?
Les nouvelles dynamiques organisationnelle à l’œuvre dans le monde de l’entreprise pourraient être une source d’inspiration pour les politiques. Dans un contexte où la digitalisation met l’entreprise en tension, perturbe les hiérarchies traditionnelles et facilite l’horizontalité des process, tout l’enjeu est d’introduire cette disruption au sein de l’organisation sans la casser. Le modèle d’entreprise libérée qui fait des émules aux Etats-Unis et en France ces dernières années est intéressant à plusieurs égards.
Ce modèle inverse le rapport pyramidal en mettant la base au coeur du processus décisionnel. Il remet à plat le fonctionnement de l’entreprise et définit des rôles qui correspondent à des besoins précis. De plus, il permet aux collaborateurs de choisir leur rôle et de l’assumer en complète autonomie, en définissant leurs objectifs, en adaptant leurs moyens et en évaluant eux même leurs résultats. Toute décision dans la structure incombe à un seul rôle et peut être prise très rapidement, par quelqu’un du terrain qui a à la fois la connaissance des problématiques concrètes et la vision de la finalité de son travail.
Ce modèle prône l’autonomie auprès de dirigeants qui ont compris l’importance de développer l’adaptabilité dans un monde économique changeant. En s’inspirant de ce modèle, un système politique qui ferait confiance à la base citoyenne en lui donnent davantage de pouvoir et d’autonomie gagnerait certainement en agilité, en réactivité et en innovation.
Par ailleurs, pour conduire en leur sein les changements liés à la révolution digitale, la plupart des grandes entreprises ont compris l’intérêt de se doter d’une fonction de Chief Transformation Officer (CTO). Le CTO doit allier la vision, la capacité à assembler et mettre en mouvement les bonnes compétences et l’action concrète, pour démontrer que cette transformation produit des effets bénéfiques. La fonction de « Chief Transformation Officers » pourrait être imaginée en politique pour permettre à nos structures publiques de gagner en agilité et faciliter le rapprochement avec la société civile.
Les politiques ont besoin de profils conscients des changements à venir, formés aux pratiques collaboratives et aux nouvelles technologies, capables d’initier des nouveaux modèles de politiques publiques. Ces profils existent bien sûr, mais il y aurait un besoin important de formation – et on ne peut que regretter que l’ENA n’ait pas encore intégré cette dimension dans ses programmes, contrairement à de nombreuses écoles similaires ou aux MPA Outre-Atlantique… Se pose ensuite la question de la place laissée à ces CTO – exactement comme elle se pose au niveau des entreprises. Il faut le soutien de la tête, mais aussi des moyens et une ambition collective. Cela devrait constituer une priorité majeure pour 2017.
Vers une culture de l’expérimentation
La deuxième piste de transformation est le développement d’un État imprégné d’une culture d’expérimentation et de l’évaluation, notamment dans sa décentralisation. Ce qui est daté et inefficace aujourd'hui, en comparaison de nos voisins européens, ce n'est pas seulement le nombre de nos collectivités territoriales, c'est aussi - et surtout - notre conception inaboutie de la décentralisation. L'Etat délègue des politiques, mais ne permet que très partiellement aux collectivités territoriales de mener de véritables actions différenciées, sur les territoires.
Or ce sont ces politiques publiques qui permettraient de réduire les inégalités réelles que connaissent nos concitoyens aussi bien que de susciter de nouvelles dynamiques locales. La possibilité de déroger à l'égalité devant la loi pour des expérimentations a été introduite en 2003 dans la Constitution. Des différences de traitement sont aujourd'hui admises, par exemple en ce qui concerne le RSA en Outre-mer. Mais nous n'osons pas franchir le pas d'une véritable autonomie des politiques publiques régionalisées, au nom d'une vision figée de l'égalité jacobine, qui ne correspond pas aux réalités vécues par nos concitoyens.
Pierre Rosanvallon a raison : c'est quand il n'y a plus de points de contact entre les réalités vécues et les abstractions politiques que la démocratie est en danger. Repartons des situations vécues sur nos territoires pour redéfinir l'action publique, comme d'ailleurs le font beaucoup de nos voisins européens. La subsidiarité est au cœur de la réflexion sur notre République, que nous regardions vers l'Europe ou vers nos régions. Mais elle est également au cœur du questionnement démocratique de nos concitoyens, désireux de davantage de proximité dans l'action et de davantage de responsabilité des élus.
Encore faut-il pour cela que celui qui mène l'action soit clairement identifié. L'Etat ne peut plus être l'initiateur de toutes les politiques publiques, mais il doit en être l'évaluateur, le juge, et, le cas échéant, avoir les moyens de correction pour garantir une égalité réelle entre nos concitoyens. C'est cette réforme de l'action publique sur les territoires qu'il faut mener, en y associant les citoyens.
Rapprocher l’intérêt général et l’action privée
Enfin, la troisième piste est un Etat qui associe, plus largement, finalité économique et finalité sociale, intérêt général et action privée. Il paraît logique que l’acteur le plus proche du problème soit aussi le mieux à même de trouver une solution, à petite échelle. Cette idée est la base théorique du modèle de la Big Society au Royaume-Uni. En s’opposant au « Big state », le projet mis en place par David Cameron en 2010 avait pour ambition de libérer l’esprit d’entreprendre dans la société civile et d’encourager la prise de responsabilité d’acteurs privés – marchands et non marchands.
En France, la loi sur l’Economie Sociale et Solidaire adoptée en 2014 a ouvert le champ des possibles pour allier performance économique et finalité sociale. Ce secteur en plein essor représente aujourd’hui 10% du PIB et 12% des emplois et participe à la transformation de notre société. Le récent lancement des contrats à impact social en France introduit un autre changement majeur visant un rapprochement entre la sphère économique et la sphère sociale.
Ce transfert de compétences à la société civile peut permettre une plus grande efficacité dans la résolution des problèmes sociaux, à condition toutefois qu’il ne soit pas seulement synonyme de désengagement de l’Etat dans un contexte d’austérité, comme c’est le cas au Royaume-Uni.
Inventer un nouveau paradigme sans attendre !
La question la plus urgente aujourd’hui pour les élites politiques est donc bien de donner au fonctionnement démocratique une dimension davantage collaborative. Si nous ne réussissons pas à impulser ce mouvement, nous risquons une double rupture. La première, c’est une rupture totale entre la manière dont les citoyens appréhendent la politique dans l’immédiateté de la réactivité et le temps de la mise en œuvre de l’action politique. Avec le risque de n’être plus que dans l’émotivité sans prise sur le réel. Il faut aussi assumer la complexité, car le refus de la complexité est bien la fin de la démocratie, comme l’écrivait Jacob Burckhardt. Il faut revenir à un temps plus long.
Le socle de l’action reste l’élection, cette cristallisation de la volonté collective autour d’un projet. L’instance du débat politique est une assemblée de représentants, à tous les niveaux. On peut y ajouter une dimension interactive, comme cela s’est d’ailleurs développé à l’Assemblée nationale. Mais il s’agit de compléter, d’éclairer, pas de remplacer. Pendant les années d’un mandat, les responsables politiques ne peuvent plus faire comme si le citoyen n’existait pas, simultanément la déclinaison d’un projet adopté par une majorité d’électeurs ne peut pas sans cesse être remise en question.
Alors, oui, il faut mettre en place des cadres de démocratie délibérative qui peuvent utiliser en partie les nouveaux outils numériques. Mais il faut refuser la démocratie d’interpellation, qui varie au gré de l’émotion et qui n’est jamais qu’une photographie d’intérêts particuliers. Nous n’échapperons pas à une réflexion sur le fait que la démocratie de l’immédiat peut être la plus grande menace contre la démocratie elle-même, rejoignant en cela l’histoire des mouvements populistes.
La deuxième rupture serait celle entre le peuple et la démocratie représentative. Si le peuple n’a plus confiance en ses représentants, s’il estime qu’il n’y a plus de contrat d’action politique à passer avec eux, alors vers qui le citoyen pourrait-il se tourner ? Vers ceux qui sont les réceptacles de leurs avis ? Vers ceux qui prétendent pouvoir apporter des solutions aux difficultés de notre temps ? Le « solutionnisme » des GAFA, ces géants de l’internet qui font de la politique sans le dire, nous en voyons tous les jours des exemples : quand Facebook veut apporter internet partout en Inde et exprime son incompréhension devant la méfiance du Gouvernement, quand Google développe des projets pour toute l’Afrique ou, via son unité Google X, développe des projets qui touchent à l’avenir même du vivant, etc.
La technologie, l’intelligence créative, les milliards : plus que les Etats, ce sont ces grandes sociétés qui pourraient détenir les clefs de l’action sur le monde. D’ores et déjà, la capacité d’influence sur des représentants élus d’un réseau social comme Facebook est colossal. Eux-mêmes le reconnaissent : on ne connaît pas les effets d’un réseau d’un milliard d’individus.
Pourtant, quand on leur demande quelle est leur réflexion sur l’impact politique de telle ou telle décision, la réponse est désarmante : soit ils ne font pas de politique, soit ils n’ont pas réfléchi sous l’angle de l’éthique politique. Si nous ne savons pas penser cette action, ni l’encadrer, alors nous serons les propres dupes de l’espace d’expression et de liberté qu’ils semblent nous offrir. Si nous ne faisons que nous émerveiller sur leur capacité d’action sur le monde, à trouver des solutions, alors nous abdiquons aussi de notre liberté et de notre capacité à peser sur notre propre destinée.
Les menaces sont réelles : si nous ne savons pas intégrer la dimension participative et collaborative à notre démocratie représentative classique, ce n’est pas la classe politique que nous perdrons, c’est la démocratie elle-même. Car qu’est-ce que le contrat social, si ce n’est celui que le peuple passe avec lui-même pour établir son propre gouvernement ? La e-démocratie reste à inventer.
Les auteurs
- Hélène Cazalis est responsable des relations extérieures de Solidarités Nouvelle face au Chômage, une association nationale qui accompagne des personnes en recherche d’emploi.
- Jean Spiri est manager développement stratégique chez One Point, société spécialisée dans le conseil en organisation et la transformation numérique des entreprises.