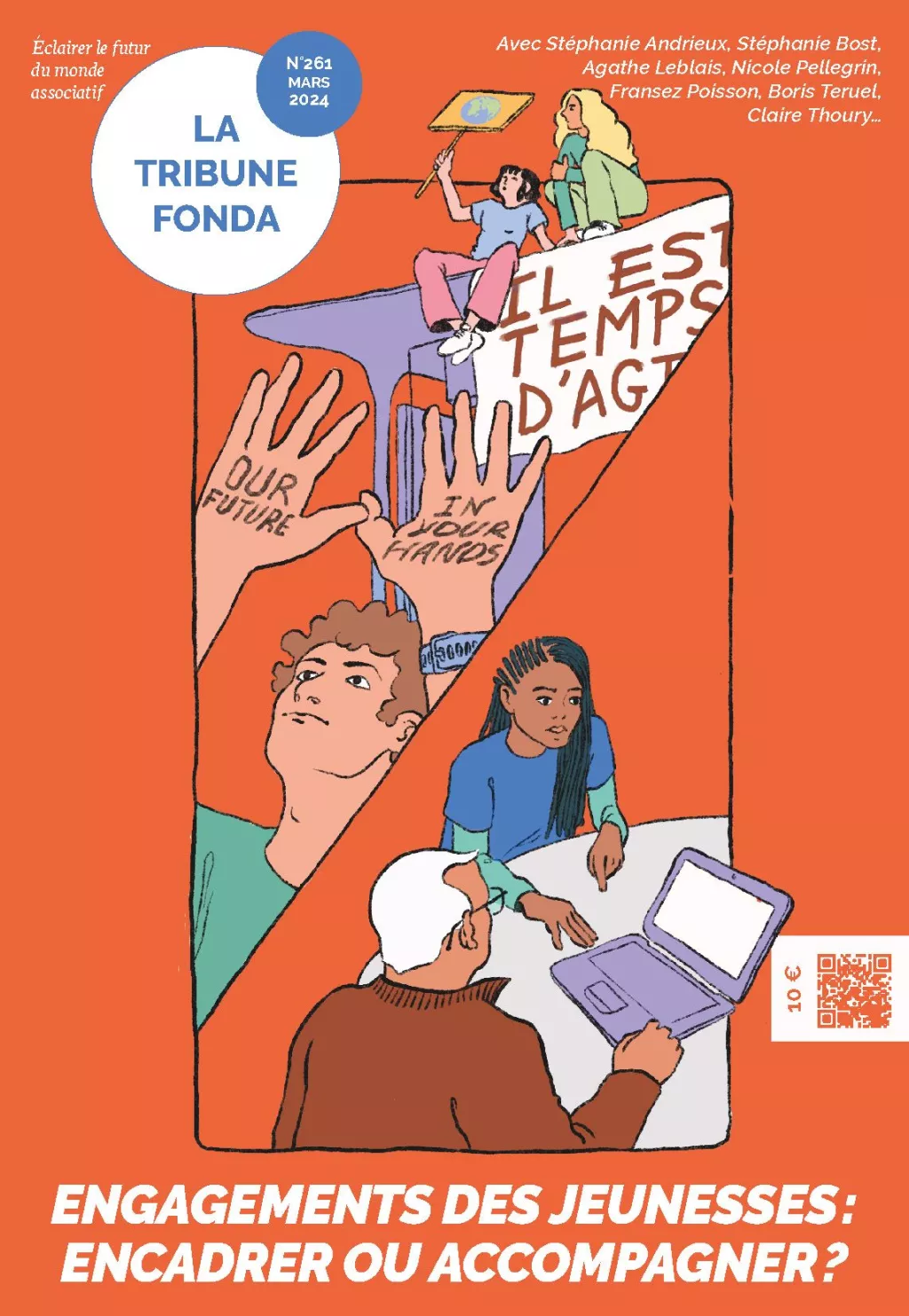Claire Thoury répond aux questions d’Anna Maheu de la Fonda.
Pourquoi avez-vous voulu écrire l’ouvrage S’engager 1 ?
Claire Thoury : Il y a quelques années, j’ai travaillé dans le cadre de ma thèse sur l’engagement des jeunes, notamment des étudiants. J’ai soutenu cette thèse en 2017 et j’ai observé depuis des mutations dans les façons de s’engager des jeunes, notamment en 2019 lors de mobilisations pour le climat.
J’ai eu envie d’éprouver mes intuitions en refaisant des entretiens avec des jeunes engagés. À la suite de ces réflexions, je souhaitais partager mes résultats sous un nouveau format, celui d’un court essai politique.
Vous avez sous-titré votre ouvrage « Comment les jeunes se mobilisent face aux crises » ? Les jeunes s’engageraient donc toujours en réaction ?
Il s’agit plutôt de l’environnement dans lequel ils s’engagent. Le contexte dans lequel les 15-25 ans ont grandi est extrêmement différent de celui des générations précédentes.
C’est une chose de vieillir dans un monde traversé par la montée des populismes en Europe, la crise sanitaire, la guerre en Ukraine et la crise écologique. C’en est une tout autre de grandir dans ce monde-là. Leur engagement est donc structuré par ce contexte de crises multiples qui s’entrecroisent et qui ne s’arrêtent pas.
Certains jeunes que vous avez interrogés voient les institutions comme inefficaces face à ces multiples crises, notamment du fait de leur inscription dans le temps long.
Oui, ils pointent souvent la nécessité d’aller vite. Ils perçoivent les institutions comme trop lentes, ce qui ne veut pas dire que c’est le cas !
Par ailleurs, ils et elles aspirent à changer la société en profondeur2. Néanmoins, on ne peut atteindre un changement radical et systémique sans deux éléments : une compréhension du passé et des débouchés politiques. Pour prendre les sujets à la racine, il faut comprendre pourquoi on en est arrivé là, donc dialoguer entre générations.
Deuxième point : les institutions ont beau être lentes, parfois inopérantes, les jeunes engagés ne pourront pas changer le monde sans débouché politique. Je ne parle pas ici de politique au sens partisan, mais au sens de mise en oeuvre, de diffusion, de construction d’une pensée politique. Dans le même temps, j’essaye de dire aux plus âgés de ne pas balayer d’un revers de main les attentes des jeunes engagés.
Les jeunes engagés ne pourront pas changer le monde sans débouché politique.
D’abord, ce n’est pas parce qu’ils sont jeunes que cela va passer et que leur forme d’engagement va changer. Il ne s’agit pas d’un phénomène d’âge, mais d’un phénomène générationnel. Ensuite leurs réflexions sont très intéressantes. Quand ils nous appellent à articuler les causes, c’est stimulant !
Pourquoi la construction pour les plus jeunes d’une culture politique vous semble-t-elle fondamentale ?
C’est le principal défi pour cette génération, mais aussi pour les précédentes. Nous n’avons plus de culture politique partagée du fait de l’affaiblissement des corps intermédiaires. La désaffection visà- vis de ces structures, qui était déjà étudiée par Jacques Ion dans les années 19903, est payée au prix fort.
La plupart des jeunes, et des moins jeunes, ont aujourd’hui une culture politique fondée sur l’expérience, c’est-à-dire qu’ils ont construit leur pensée en agissant. C’est un mécanisme très puissant, car ancré dans le réel. Néanmoins rien ne me garantit que ma culture politique soit celle de mon voisin ou qu’elle se déploie vers une grille de lecture collective.
Notre plus grand défi est donc d’accompagner l’engagement des jeunes et des moins jeunes. C’est en nous assurant que nous parlons la même langue que nous pourrons ensuite construire des alternatives politiques.
C’est possible pour moi à l’échelle des fédérations, ou plus généralement des réseaux. L’initiative du Pacte du pouvoir de vivre où s’impliquent associations, fondations, syndicats, mutuelles, etc. permet de faire émerger un tel langage commun. Nous souhaitons par ailleurs le transmettre avec l’école du Pacte du pouvoir de vivre4.

Vous reprenez les mots de Jacques Ion qui identifiait, comme possible source de la crise du militantisme, une vision nostalgique de celui-ci, le fameux « bon vieux temps du militant »5. Comment peut-on penser les engagements des jeunes sans y calquer ses propres expériences de jeunesse et/ou d’engagement ?
Honnêtement, c’est très difficile. Le propre de la jeunesse est d’être une catégorie sociale mouvante. Nous avons tous été jeunes un jour, avant de ne plus l’être. Pour cette raison, on ne peut pas s’empêcher de transposer sur les générations plus jeunes des modèles et des schémas qui ont été les nôtres. Mais comme le monde change vite, nos analyses tombent souvent à côté de la plaque.
La seule solution, qui est aussi un sacré défi, est d’être le moins jugeant possible et d’éviter toute forme de condescendance. C’est un exercice difficile, mais ce n’est pas pour autant qu’il ne faut pas essayer.
Les organisations de la société civile ne sont pas les seules à s’intéresser à l’engagement des jeunes, c’est aussi le cas des pouvoirs politiques. Comment l’État peut-il accompagner l’engagement des jeunes ?
Un tel accompagnement n’est possible qu’avec des tiers de confiance que sont les corps intermédiaires. Prenons l’exemple du service civique : c’est une politique publique très puissante parce qu’elle a été coconstruite. Le service civique a été pensé par des acteurs associatifs6.
Partir du quotidien, s’organiser pour trouver des solutions adaptées, en faire une politique publique rendue possible grâce à la société civile, c’est l’exemple d’une coconstruction réussie7.
L’État ne peut pas développer seul de telles politiques publiques, c’est ce qu’on voit notamment avec le Service national universel (SNU). Par ailleurs, coconstruire passe par du débat, du conflit, des aspérités. Ce n’est pas un seul discours, bien-pensant, qui va dans le sens des pouvoirs publics.

Une politique publique de jeunesse réussie serait donc une politique coconstruite avec les corps intermédiaires ?
Au-delà de la coconstruction, la question primordiale est l’objectif de ces politiques publiques de jeunesse. À quoi servent-elles ? Sont-elles utiles par rapport à ces objectifs ?
C’est beaucoup plus simple quand on part de besoins concrets, par exemple des politiques publiques pour lutter contre la dégradation de la santé mentale, le décrochage scolaire ou la sédentarité.
Quels sont les objectifs des politiques publiques de jeunesse ? Sont-elles utiles par rapport à ces objectifs ?
Quand on pense une politique publique plus générale sur « la jeunesse », malheureusement l’objectif sous-tendu est souvent de discipliner une génération.
Quel est le rôle des corps intermédiaires et de l’État pour assurer ce choix de s’engager ?
Pouvoirs publics, acteurs associatifs et autres organisations de la société civile peuvent travailler collectivement à lever les freins à l’engagement. Ils peuvent accompagner, faciliter, encourager l’engagement, mais pas le contraindre. S’engager, c’est s’organiser pour faire quelque chose ensemble. Le choix de s’engager est aussi important que le sujet pour lequel on s’engage.
Je précise que cette tendance à construire un discours bien-pensant autour de l’engagement s’observe non seulement dans certains dispositifs étatiques, mais aussi dans le monde de l’entreprise.
Cela nous montre que l’on a radicalement changé d’époque, mais doit aussi nous interroger, car lisser l’engagement, le porter de façon normative, n’est pas la bonne solution.
Porter l’engagement de façon normative, avec des dispositifs étatiques ou au sein des entreprises, n’est pas la solution.
Il y a quelques années, l’engagement était perçu comme concurrentiel aux études. Il fallait éviter de s’engager pour réussir ses études. Aujourd’hui au contraire, l’engagement est devenu la réponse à tous les problèmes.
Un jeune ne va pas bien ? Il devrait s’engager. Il a besoin de se singulariser ? Il devrait s’engager. Il a du mal à trouver sa voie ? Il devrait s’engager. Nous sommes passés d’un extrême à un autre, alors qu’une autre voie est possible.
Quelle serait cette troisième voie dans l’exemple de l’engagement étudiant ?
En 2017, quand la loi égalité et citoyenneté a été votée8, les établissements d’enseignement supérieur ont dû reconnaître les compétences acquises en dehors des espaces académiques classiques, dans le monde professionnel, mais aussi associatif.
L’approche du texte de loi était alors très différente : il s’agissait de reconnaître les compétences acquises et non l’engagement en tant que tel.
Adopter une approche par compétences limite les lectures trop normatives de l’engagement. Sept ans après ce vote, la mise en application s’est révélée tout autre. Aujourd’hui on reconnaît l’engagement en tant que tel, en distinguant les types d’engagement, certains seraient « bons », d’autres le seraient moins. Ce qui est vraiment dommage, ce texte était une petite révolution.
Comment penser un accompagnement des jeunes émancipateur ?
Tout d’abord pourquoi veut-on les accompagner ? Est-ce qu’ils nous l’ont demandé ? C’est amusant : on nous demande rarement comment accompagner de jeunes retraités ou des quarantenaires.
Ensuite, il n’y a pas de formule magique, mais le partage du pouvoir est fondamental. Ancienne déléguée générale d’Animafac9, je défends bien entendu les organisations de jeunes dirigées par des jeunes. Ces espaces dans lesquels les jeunes ont de véritables responsabilités sont extrêmement puissants.
Avoir 18 ans et être président, trésorier ou secrétaire général, c’est avoir la possibilité de réussir ou d’échouer, en étant protégé par une dynamique collective qui est porteuse.
- 1Claire Thoury, S’engager. Comment les jeunes se mobilisent face aux crises, Les Petits Matins, collection « Mondes en transitions », 2023.
- 2Lire à ce sujet la Tribune Fonda n° 260 « Engagement radical, engagement total ? », décembre 2023, [en ligne].
- 3Jacques Ion, « Interventions sociales, engagements bénévoles et mobilisation des expériences personnelles », dans Jacques Ion et Michel Peroni, Engagement public et exposition de la personne, L’Aube, 1997.
- 4Lancée à la fin de l’année 2023, l’école du Pacte du pouvoir de vivre est une formation de six mois dédiée aux 18-35 et animée par les 65 organisations du collectif.
- 5Jacques Ion, La Fin des Militants ?, Éditions de l’Atelier, 1997.
- 6Lire à ce sujet Marie Trellu-Kane (Unis-cité), « Unis-Cité et le service civique », Tribune Fonda Hors-série « Ce que nous devons aux associations », Septembre 2021.
- 7Lire à ce sujet Léonore Moncond’huy, « L’engagement par le Service civique », Tribune Fonda n° 239 « Les dynamiques de l’engagement », Septembre 2018.
- 8La loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, dite « loi égalité et citoyenneté », a été adoptée à la fin du quinquennat Hollande.Elle est la traduction des mesures adoptées en comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté, à la suite des attentats de janvier 2015.
- 9Tête de réseau nationale fondée en 1996, Animafac fédère les associations étudiantes qui de fait sont dirigées par des personnes en étude donc majoritairement jeunes.