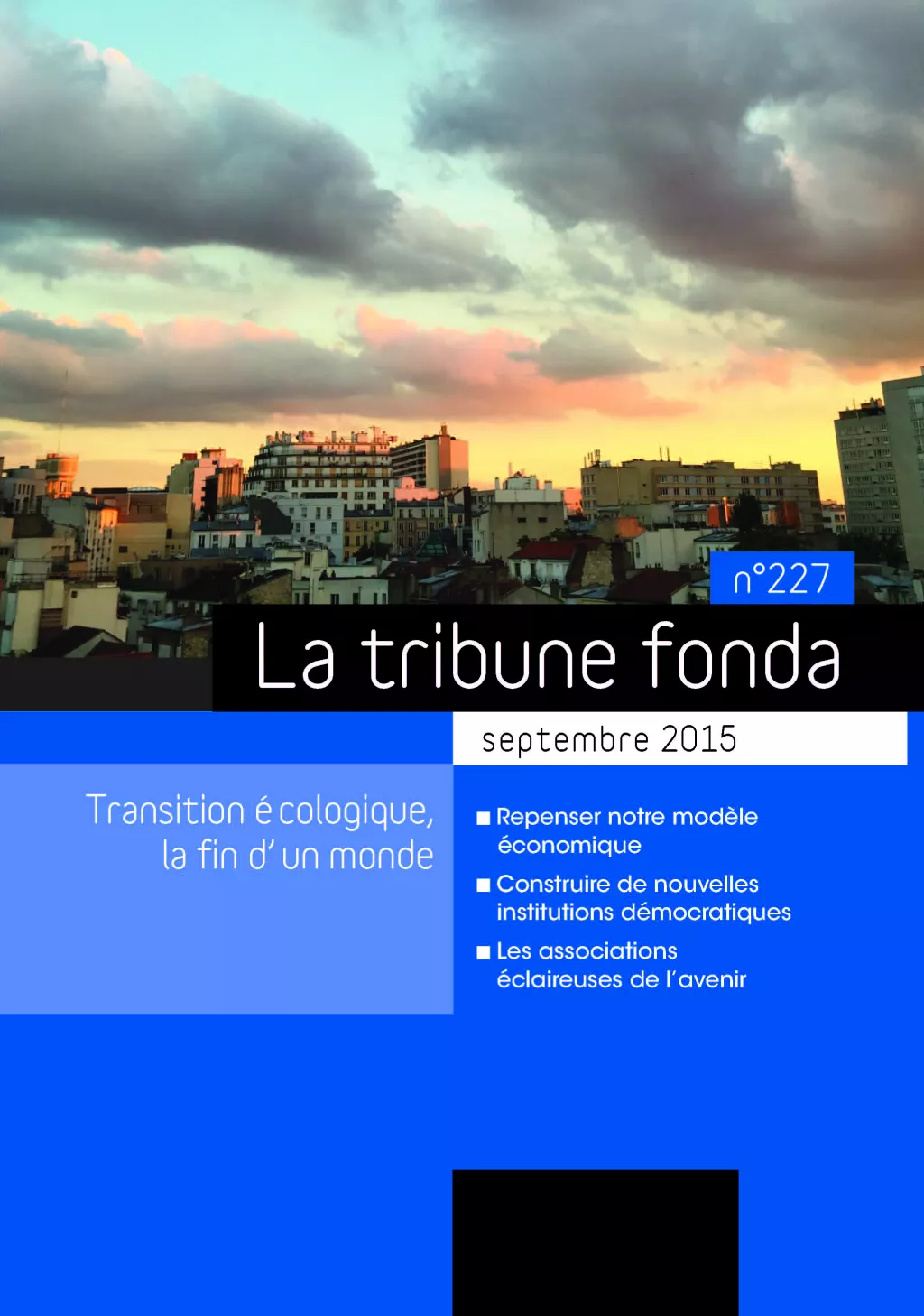La rédaction : Dans vos différents ouvrages, vous parlez de l’effondrement d’un monde. Pouvez-vous nous précisez ce que vous entendez par-là ?
Yannick Roudaut : Pour cela, j’ai envie de vous parler d’une petite île du Pacifique, Nauru, 21 km2, où vivent 4 000 personnes. L’histoire de cette île illustre parfaitement ce qui nous arrive au niveau planétaire. En 1896, un bateau britannique fait escale à Nauru et le capitaine ramasse un caillou, qu’il rapporte en Australie. Après analyses, on se rend compte que c’est du minerai de phosphate, ressource essentielle pour le développement de l’industrie alors. Nauru devient une mine à ciel ouvert, exploitée par les colons pendant un siècle, sous le regard des habitants qui jusqu’ici vivaient de la cueillette et de la pêche.
Tout se passe bien jusqu’aux années 1970, date à laquelle Nauru devient une île indépendante et récupère son phosphate. Il faut savoir que ce phosphate est issu de la décomposition de fientes d’oiseau accumulées pendant des millions d’années. Présent à profusion dans le sol, il est exploité sans limites, et cela rapporte beaucoup d’argent aux habitants de Nauru. Cela rapporte tellement d’argent que les Nauruans n’ont plus besoin de travailler, ni d’aller pêcher, ni d’avoir une activité physique, parce que les revenus par habitant sont de 50 000 dollars par an, ce qui en fait le deuxième pays le plus riche au monde, derrière l’Arabie Saoudite.
En quelques années, entre 1970 et 1990 les Nauruans, qui étaient actifs et proches de leur environnement, deviennent de « gros » consommateurs, oisifs : ils achètent des Porsche, ils mangent du caviar, ils achètent tous les produits de luxe qui existent dans le monde. Certains ont jusqu’à cinq voitures de luxe pour une seule route de cinq km de long ! On construit une piste d’aéroport, on lance une compagnie aérienne, on installe des infrastructures de communication que seuls les pays très riches peuvent s’offrir.
Le gouvernement nauruan, anticipant l’épuisement des ressources naturelles, se lance dans la finance mondiale pour diversifier ses avoirs. Vous connaissez la suite : suite à des placements spéculatifs hasardeux toutes les économies des Nauruans disparaissent. Afin de préserver la paix sociale, l’État subventionne les Nauruans, en empruntant des sommes colossales sur les marchés financiers, pour garantir la qualité de vie qui est devenue celle des Nauruans : l’oisiveté.
En 1997, la mine de phosphate de Nauru est complètement épuisée. La source issue de millions d’années de décomposition est tarie, des dettes considérables sont accumulées, le taux d’obésité atteint 90 % de la population, l’espérance de vie a chuté à 56 ans pour les hommes et à 64 ans pour les femmes. C’est le naufrage de Nauru, qui est devenue aujourd’hui une plaque-tournante de l’argent sale et de l’évasion fiscale en tous genres.
Aujourd’hui, nous vivons peut-être le syndrome de Nauru au niveau mondial. Nous sommes en train d’épuiser les ressources issues de millions d’années de décomposition naturelle : en 250 ans, depuis la première révolution industrielle, nous avons réussi à épuiser 80 % des ressources naturelles de la planète. Il nous en reste 20 %, qu’il va falloir utiliser avec précaution, de manière très réfléchie et raisonnée. Nous sommes désormais 7,5 milliards d’humains, peut-être 10 milliards à moyen terme, et nous allons devoir trouver une nouvelle harmonie entre l’humain et la nature. L’épuisement des ressources ne nous laisse pas le choix, sans parler des conséquences polluantes de leur extraction et de notre mode de consommation !
La rédaction : C’est la fin du monde, ou la fin d’un monde ?
Y.R. : C’est la fin d’un monde. C’est la fin d’une vision occidentale que nous avons mondialisée. Depuis la première révolution industrielle, nous, occidentaux, sommes convaincus qu’il n’existe aucun autre modèle économique possible, hormis celui reposant sur la surconsommation. Ce modèle de croissance, qui a profité à moins de 500 millions d’individus jusqu’aux années 70/80, est aujourd’hui à bout de souffle. Il est irresponsable de penser que 7 à 10 milliards d’individus peuvent consommer comme un citoyen américain. Les récents événements chinois viennent confirmer la fin du mythe de la croissance infinie. Depuis le mois d’août dernier, les bourses tremblent car la croissance chinoise ralentit… comment aurait-il pu en être autrement ? Tôt ou tard, le modèle flanche ; en Occident, en Amérique du Sud (Brésil), en Asie, la machine commence à sérieusement se gripper. C’est le début d’une nouvelle histoire et la fin d’une vision unique du monde et de l’économie.
Le monde fondé sur l’hyperconsommation et le surendettement, c’est terminé, et ce pour cinq raisons. Pour vous les expliquer, je m’appuie sur les travaux d’un chercheur américain, Jared Diamond, professeur à l’Université de Californie à Los Angeles. Il a travaillé pendant quarante ans sur l’effondrement des grandes civilisations. Prenons l’exemple de la civilisation Maya. Les mayas n’ont pas disparu à cause des conquistadores. Ces derniers sont arrivés au XVe siècle alors que cette grande civilisation s’est effondrée au IXe siècle. Ils ont disparu alors qu’ils maîtrisaient les mathématiques, l’architecture, l’astronomie, le commerce, la médecine. Jared Diamond a cherché à comprendre pourquoi cette civilisation s’est effondrée et a identifié cinq facteurs. Quand on fait le parallèle entre le monde maya et notre monde moderne, on réalise que les cinq facteurs sont à nouveau réunis ! Ce n’est pas l’Occident qui s’effondre. C’est le monde occidentalisé, c’est-à-dire l’économie mondiale dans son ensemble…
La rédaction : Pouvez-vous nous rappeler ces cinq facteurs d’effondrement ?
Y.R. : Le premier est le facteur environnemental : toutes les grandes civilisations finissent par infliger des dommages, parfois irréversibles, à leur environnement, à force de polluer et d’exploiter sans frein les ressources naturelles. Homo sapiens est le plus cruel et le plus irraisonnable des êtres vivants, incapable d’assurer la survie de son espèce. C’est un super-prédateur. Il inflige des dégâts considérables à la faune, la flore et épuise les ressources fossiles comme aucune autre espèce !
Notre modèle économique est fondé sur un mythe, celui d’une exploitation sans limite des ressources, que l’on peut transformer, consommer et jeter. Ce mythe est en train de s’effondrer, d’une part parce que nous en avons déjà utilisé 80 %, et d’autre part, parce que, sur le long terme, la demande en minerais, en matières premières, en énergie est en train d’exploser au rythme de la croissance démographique. Comment allons-nous répondre aux besoins de 7,5 milliards d’individus qui veulent accéder aux standards américains ? La terre a des limites physiques : aujourd’hui, nous sommes déjà confrontés à la rareté pour certains minerais. Demain ce sera la pénurie. Si l’humanité consommait comme un américain, en 2030, il faudrait cinq planètes Terre pour répondre à sa demande ! Quand bien même il resterait beaucoup de ressources fossiles, beaucoup de pétrole, le moment est venu où nous sommes contraints d’aller chercher du pétrole en eau profonde. Tout le monde lorgne l’Arctique et ses réserves… il faut forer de plus en plus profond, il faut par exemple des tubes en acier sans soudure, des équipements dont la fabrication demandera à terme plus d’énergie que le pétrole extrait ne peut en produire. Au-delà de la chute conjoncturelle actuelle, le pétrole coûtera très cher à long terme. Surtout si on intègre dans son prix, le coût de la pollution environnementale et sanitaire lié à son extraction et son utilisation. Ces externalités finiront par être prises en compte.
Autre élément qui précipite la chute de notre monde : notre mode de consommation. Il repose sur l’obsolescence programmée. Ce concept a été mis en lumière en 1933, après la grande dépression américaine, par Robert London. À l’époque, son idée était lumineuse : pour sortir les Américains de la misère, pour créer des emplois, il suffit de réduire la durée de vie d’un produit afin d’en augmenter le taux de remplacement. À partir des années 50, cette vision de l’économie s’est généralisée, car elle très rentable. Aujourd’hui, nous vivons dans la société du jetable, dont les composants sont coûteux et rares. Par exemple, un smartphone contient des minerais dont le coût environnemental et social est faramineux ! Et on le jette au bout de quoi, … un an, deux ans ? Le recyclage est encore très insuffisant dans les télécoms.
Deuxième facteur d’effondrement, qui accentue le premier : le changement climatique. Ce n’est pas le premier auquel l’humanité doit faire face. Mais pour la première fois dans l’Histoire, celui que nous connaissons va se dérouler sur un siècle, quand les précédents avaient lieu sur cinq à dix siècles, ce qui laissait à la faune et à la flore le temps de s’adapter. Cette fois-ci, beaucoup d’espèces vivantes vont disparaître, ce qui posera un problème alimentaire. Le dérèglement climatique intervient dans un monde massivement urbain et sédentaire. Les mouvements massifs de populations, de réfugiés climatiques, vont singulièrement perturber les équilibres en place. Les conséquences sociales, économiques, géopolitiques du changement climatique seront catastrophiques et il faut s’y préparer!
Troisième facteur : quand les ressources agricoles ou l’eau deviennent rares, quand les ressources minérales deviennent difficilement accessibles, quand les pénuries alimentaires se multiplient, les alliances militaires d’hier volent en éclats. On assiste déjà à une résurgence des conflits armés. Les Usa ont donné le « la » avec la première invasion de l’Irak, l’Europe a poursuivi au Kosovo et aujourd’hui la France fait la guerre en Afrique, guerre dont l’un des enjeux est l’exploitation des sous-sols.
Quatrième facteur d’effondrement qui découle des trois premiers : les alliances diplomatiques sont en danger. Le statut quo européen actuel n’est plus tenable : soit on évolue vers une Europe fédérale, soit l’Europe éclatera. La question grecque et celles des migrants montrent à quel point l’Europe a du chemin à faire en matière d’unité.
Enfin, le cinquième facteur se trouve dans le creusement des inégalités. Face au danger d’appauvrissement et de conflits, les élites se protègent entre elles. Les travaux de Thomas Piketty le montrent, le fossé entre les ultra-riches et les pauvres n’a cessé de se creuser depuis trente ans. Aujourd’hui, aux États-Unis, nous sommes revenus au niveau de 1917 en termes de répartition des richesses. Cent ans de progrès social ont été gommés en quinze ans. 1 % des plus riches détiennent plus de la moitié du Pib américain. Cela met en péril le modèle économique actuel, car il y a une baisse durable du pouvoir d’achat : on ne consomme plus, on épargne. Faire de l’argent avec de l’argent met en péril l’économie mondiale. Malgré cela, les banques centrales continuent à injecter des liquidités dans les marchés financiers. Ces « quantitative easing » sont aux marchés ce qu’est la seringue à un junky. On maintient artificiellement la bourse à un haut niveau.
Malgré tout cela, malgré l’affaire Lehmann-Brothers, on continue à développer des pratiques absurdes, comme le trading haute fréquence (Thf). Ainsi, trois firmes se partagent la moitié des ordres sur le Cac 40. Des ordinateurs sont programmés pour passer des ordres à haute fréquence, de l’ordre de deux cents transactions à la seconde. Aucun être humain n’est capable de prendre une décision à cette vitesse. Cet argent ne sert à rien : on crée de l’argent pour de l’argent. Nous sommes dans ce qu’Aristote appelait une crise chrématistique . L’argent devient une finalité et non plus un moyen d’échange. Un grand krach financier nous menace et peut précipiter l’effondrement de notre civilisation.
Nous sommes entrés dans une période de baisse durable du pouvoir d’achat des ménages occidentaux, condamnés à nous appauvrir. C’est déjà le cas en Europe, en Italie, en Espagne, en Grèce, au Portugal, en Irlande… Des signes de ralentissement se font même sentir en Chine. L’économie étant mondialisée, interconnectée, le ralentissement en Asie nous concerne, et réciproquement, il ne faut pas se leurrer ! Mais cet effondrement est une bonne nouvelle !
La rédaction : J’avoue que j’ai du mal à voir en quoi !
Y.R. : La fin d’un monde, ce n’est pas la fin du monde. Nous avons la chance de vivre une période nouvelle dans l’histoire, et un défi qui devrait mobiliser tous les ingénieurs, dirigeants, citoyens : faire cohabiter en paix plus de 7 à 10 milliards d’individus dans un monde fini. C’est un enjeu colossal ! La révolution numérique que nous vivons depuis vingt ans est comparable à l’introduction de l’agriculture au néolithique. Nous étions nomades, nous vivions en tribus. Il y a cinq mille ans, les premiers villages apparaissent dans le croissant fertile (Iran, Irak, Koweit) : les hommes se sédentarisent, structurent des sociétés, élaborent des règles… c’est l’apparition d’une nouvelle technologie, l’agriculture, qui a rendu possible ce basculement sociétal.
Aujourd’hui, les technologies numériques, les réseaux sociaux et l’Internet, jouent ce rôle : la société va se structurer différemment. Notre rapport à l’autre va changer, notre rapport à la propriété, à l’argent, au travail, à l’entreprise… le numérique change tout !
Nous vivons une période inédite, une transition comparable à la Renaissance italienne. À ce moment-là, des mécènes ont financé des artistes, des créatifs, des intellectuels… pour inventer un monde nouveau. On a armé des bateaux pour aller chercher les plus belles soies, et vous connaissez la suite : un certain Christophe Colomb découvre les Antilles, et ouvre ce qui sera un nouveau monde. La Renaissance est une période durant laquelle notre conception du monde a complètement changé. D’une vision géographique limitée à l’Europe, l’Afrique et l’Asie, nous sommes passés à un monde immense, gorgé de richesses agricoles, minières, d’or, de terres. C’est d’ailleurs de là que provient le mythe d’une croissance infinie. Cinq siècles après, nous croyons encore à l’immensité du monde. Aujourd’hui, notre appréhension géographique du monde est à nouveau en train de changer. Après avoir découvert l’immensité du monde au XVe siècle, nous découvrons progressivement sa finitude. Sept milliards d’individus avides de consommer, ça change la donne. Il va falloir ménager notre planète, et non seulement l’aménager comme dit Edgard Morin, parce qu’il n’y a pas beaucoup de place.
Autre point commun avec la Renaissance, l’intense créativité. On invente la perspective, l’imprimerie, Léonard de Vinci explore de nouvelles voies… Aujourd’hui nous vivons aussi une période d’intense créativité : l’impression en 3D, l’Internet, la création de start-up qui bouleversent nos modes de vie...
Mais la Renaissance fut aussi une période extrêmement violente. Les croisades, les guerres de religions, le génocide amérindien, l’esclavagisme… Nous sommes aujourd’hui aussi dans une période marquée par les conflits armés, les guerres civiles, les massacres, qui signalent la manifestation de puissantes résistances de la part de groupes ou d’individus qui n’acceptent pas le changement. Mais ils ne l’empêcheront pas, il a déjà commencé !
Pendant la Renaissance, on a inventé un nouveau média pour transmettre la connaissance : l’imprimerie mécanisée. Aujourd’hui, la connaissance est diffusée mondialement via les réseaux. Tablettes, smartphones, ordinateurs, nous permettent de partager la connaissance mondiale en quelques clics. Une conférence peut en quelques instants toucher 100 000 personnes à travers les réseaux sociaux. Une pétition peut rassembler 500 000 signatures en une semaine : c’était matériellement impossible il y a moins de dix ans.
Dernier parallèle avec la Renaissance : c’est une période où les certitudes volent en éclat. Jusqu’au 16e siècle, nous pensions que la Terre était immobile, au centre de l’univers. Aujourd’hui cela fait sourire, mais ces certitudes étaient solidement ancrées. Depuis Aristote, le géocentrisme était LA vérité acquise, non négociable. En Europe, quiconque remettait en cause cette « Vérité » avait affaire à l’Inquisition. Il a fallu attendre des décennies après la mort de Copernic pour l’héliocentrisme soit reconnu. Aujourd’hui, les choses n’ont pas vraiment changé : nous avons de nouvelles vérités acquises, non négociables… quiconque s’attaque au dogme de la Croissance, a affaire à une forme d’inquisition. Rappelez-vous David Cameron, qui voulait en finir avec « les foutaises vertes » au sujet de l’exploitation du gaz de schiste! Dès lors que l’on remet en question la pensée unique, on est catalogué dans les anti-systèmes, les empêcheurs de tourner en rond. Il est très difficile de remettre en cause le modèle économique et social dans lequel nous sommes entrés il y a seulement quelques décennies.
Fort heureusement, les choses bougent. Nous assistons déjà à l’effondrement de certaines vérités : la croissance, le nécessaire sacrifice du vivant pour assurer cette croissance économique… sont des croyances sérieusement remises en question. Face à l’urgence écologique, la démographie galopante et le mal-être social, nous sommes contraints de tout repenser, de tout recommencer. À court terme nous sommes obligés de modifier notre rapport à l’économie. Nous entrons dans une phase d’appauvrissement. Les pays « émergés » ont la richesse : des liquidités, de la main-d’œuvre dynamique, pas de dette. Les occidentaux sont riches de dettes : plus l’occidental s’appauvrit, plus il va être amené à réfléchir à sa manière de consommer, de manger, de travailler, de s’investir dans une entreprise. On entre dans l’ère de l’économie du sens. Toute une jeunesse, dans le monde, descend dans la rue pour revendiquer un nouveau modèle politique (Indignés, Occupy wall street, Podemos… ). Ce sont encore des mouvements marginaux, mais ces signaux faibles en disent long sur le changement en cours.
Ce questionnement va déboucher sur une nouvelle pyramide des priorités : si un produit de grande consommation ne répond pas à la question du sens, il risque de sortir des priorités d’achat. Par exemple, la voiture individuelle perd de son attractivité, en particulier dans les grandes villes où l’offre de transport est riche. La consommation responsable se développe d’année en année. Autre exemple, Biocoop enregistre une forte croissance malgré des prix plus élevés que la distribution classique. Le taux de croissance du chiffre d’affaires de Biocoop est supérieur à 10 % par an, alors que la pauvreté se développe. Paradoxal ? En fait, ce sont les classes moyennes qui arbitrent en faveur d’une meilleure alimentation, une éthique. Consommer mieux était insignifiant il y a dix ans, aujourd’hui c’est une part de marché qui intéresse les grandes enseignes.
Un autre signal faible découle de la pénurie : une nouvelle idée du bonheur. Moins de biens, plus de liens ! On rentre dans le post-matérialisme, parce qu’on ne peut plus faire autrement. Faites le test, demandez autour de vous : quel a été le meilleur moment de l’année ? Dans 95 % des cas, c’est un moment de convivialité, entre amis, en famille, pas l’achat du dernier Ipad ! Une métamorphose philosophique est en train de se jouer en Europe, et les émergés vont se poser ces questions-là très rapidement. Ils vont passer de la case « boulimie de consommation » à « consommation responsable » sans passer par la case « Trente Glorieuses ». Bien sûr le mouvement ne sera pas uniforme, mais il est déjà en cours en Chine où l’indignation gagne les classes moyennes à chaque accident industriel ou lors d’un scandale alimentaire.
Les individus sont en train de prendre conscience de leur rôle systémique, nous sommes les maillons d’une grande chaîne : la pollution en Chine, c’est notre pollution exportée. Les outils technologiques, et les communautés qui se développent autour, donnent accès à la connaissance et remettent en cause l’autorité : on se fie de moins en moins aux labels accordés par une autorité obscure, mais à l’avis de ses pairs sur les réseaux. On va donner une part de plus en plus importante à la collaboration, au détriment de la compétition. La nature est beaucoup plus collaborative que l’homme. Par exemple, chez les bonobos, c’est l’intérêt collectif qui prime sur l’intérêt particulier. Si l’un des individus met en péril le groupe, il est exclu. En revanche, la compétition entre mâles est possible quand elle est essentielle à la pérennité du groupe. La compétition entre nos leaders économiques est-elle essentielle au bien-être collectif ? Je suis dubitatif…
Compte tenu de la pénurie à venir des ressources, de l’appauvrissement et de la recherche de sens, nous entrons donc, par la force des choses, dans l’économie du partage (share economy) : les outils numériques rendent possible et accentuent la consommation collaborative. C’est une porte ouverte à la créativité. Le partage de la connaissance a permis l’invention d’une révolution technologique : l’impression 3D. Le fait de faire soi-même ses objets aura des conséquences : on va relocaliser la production de biens que l’on importait. Cette économie du partage remet sérieusement en question la notion de propriété. Nous passons du copyright aux licences Creative Commons. Des individus se mettent ensemble pour inventer. Dans le commerce, ils court-circuitent des intermédiaires, en créant des communautés d’acheteurs, comme la Ruche qui dit Oui.
Le partage des connaissances, ce sont aussi des entreprises qui se regroupent pour mettre en commun des bonnes pratiques. À Montpellier par exemple, So Éco regroupe dix-sept entreprises de toutes tailles, pour travailler ensemble. À Vannes, Venetis est un réseau de partage de compétences très efficace. Le partage se développe, grâce aux réseaux sociaux dont c’est l’Adn, et avec lui, se développe le pouvoir latéral, qui nous permet de réagir sans l’accord des élites, du haut de la pyramide. Les supermarchés collaboratifs vont se développer : à Paris
La Louve a complètement repensé le modèle économique, d’une part en supprimant les intermédiaires, d’autre part, en réduisant les coûts de main-d’œuvre, en demandant aux clients d’adhérer et de donner du temps. Les prix sont donc maintenus à un niveau abordable et des produits de bonne qualité sont accessibles aux moins riches. Des individus sont en train de réinventer le champ de la distribution. La banque est aussi en train d’évoluer. Une question court sur les réseaux sociaux : et si on se passait des banquiers ? Les plateformes de prêts solidaires entre particuliers émergent, comme Hellomerci.com, qui permet à des particuliers de prêter de l’argent, sans intérêt. Le financement participatif nous offre les moyens de financer des projets ou des entreprises, en direct : Ullule, Lendopolis, Goteo, Lemonway… fleurissent. La pyramide se renverse.
Tout cela va s’accélérer car la génération Y est une génération connectée. Celle-ci a de nouvelles attentes, en particulier en matière de travail. La génération Y, et celle qui suit, les digital natives, sont dans une vision collaborative du monde : j’ai une question, je la lance dans la communauté, et je trouve la solution. Ils vont arriver dans l’entreprise avec la même attente collaborative, et il va falloir en tenir compte, en allant vers un management ouvert, décloisonné, collaboratif. Pascal Picq, professeur au collège de France, nous dit : « L’innovation ne doit pas être le seul apanage des ingénieurs, mais résulter du “ bricolage ” collectif d’un ensemble d’acteurs : philosophes, artistes, scientifiques, designers, etc. » Il va falloir ouvrir l’entreprise à des individus au regard décalé, artistes, musiciens…
L’entreprise a besoin de réfléchir mieux à sa mission et à ses valeurs, et proposer une autre voie. Par exemple, Botanic (les jardineries) a commencé par supprimer le plastique PVC de ses rayons, puis le Round-up. Ce faisant, ils ont renoncé à 2,5 millions de chiffre d’affaires par an. Mais ils ont gagné la confiance de clients et de collaborateurs, en phase avec un discours sur le développement durable traduit dans les pratiques.
Les valeurs sociétales et environnementales sont encore très peu prises en compte dans la finance, mais on peut sentir des frémissements. Un analyste financier a défrayé la chronique, fin 2013, en dégradant Apple, Amazon et Philip Morris à cause de leur comportement éthique. Il a expliqué être choqué par le fait qu’Apple paye ses employés chinois deux dollars de l’heure alors qu’il y a en banque 150 milliards de dollars. Selon moi, une entreprise comme Apple est en danger, parce que les conditions sociales et les conséquences environnementales de son activité sont catastrophiques, parce qu’ils font tout pour que vous ne puissiez pas réparer votre Iphone, et parce qu’un challenger va débouler, en proposant des produits beaux, efficaces, écologiques, socialement éthiques …
Progressivement, nous allons passer d’une économie fondée sur la création de valeur chère à Milton Friedman, à la création de valeurs, au pluriel. Les entreprises qui auront la cote en bourse dans quelques années seront celles qui feront du cash et auront des valeurs : le bien-être de leur collaborateurs, l’impact environnemental… L’entreprise ne doit plus se penser comme un noyau, mais comme une organisation complexe, inscrite dans un périmètre de responsabilités ; il lui faut traiter simultanément l’impact financier, social et environnemental.
Nous citoyens, sommes aussi concernés : il est nécessaire d’apprendre le découplage entre la production et l’utilisation massive de ressources non renouvelables, dont l’extraction a des effets collatéraux très coûteux à long terme. C’est un champ d’exploration colossal. Quand on achète une alliance en or, on ne sait pas que derrière, il y a cinq tonnes de déchets miniers. La dépollution des sols, le sac écologique de nos biens de consommation, devrait être compris dans le prix de vente !
Il va falloir passer à l’économie circulaire : tout produit devrait être pensé pour revenir dans le cycle de production. Une voiture devrait être conçue pour être réutilisée. L’économie circulaire, c’est aller plus loin que le recyclage. Cela va créer des emplois. Mais cela passe par une révolution dans notre façon d’appréhender le vivant : il va falloir accepter de mettre un prix sur des biens qui n’en ont pas encore. Pourquoi continue-t-on à vendre du Gaucho qui détruit les abeilles ? Parce que le prix de la pollinisation n’a pas été évalué. Qui paye les abeilles ? Elles rendent un service gratuit. C’est de notre responsabilité de les protéger. Il va falloir vivre avec le vivant, et non contre ou sans le vivant !