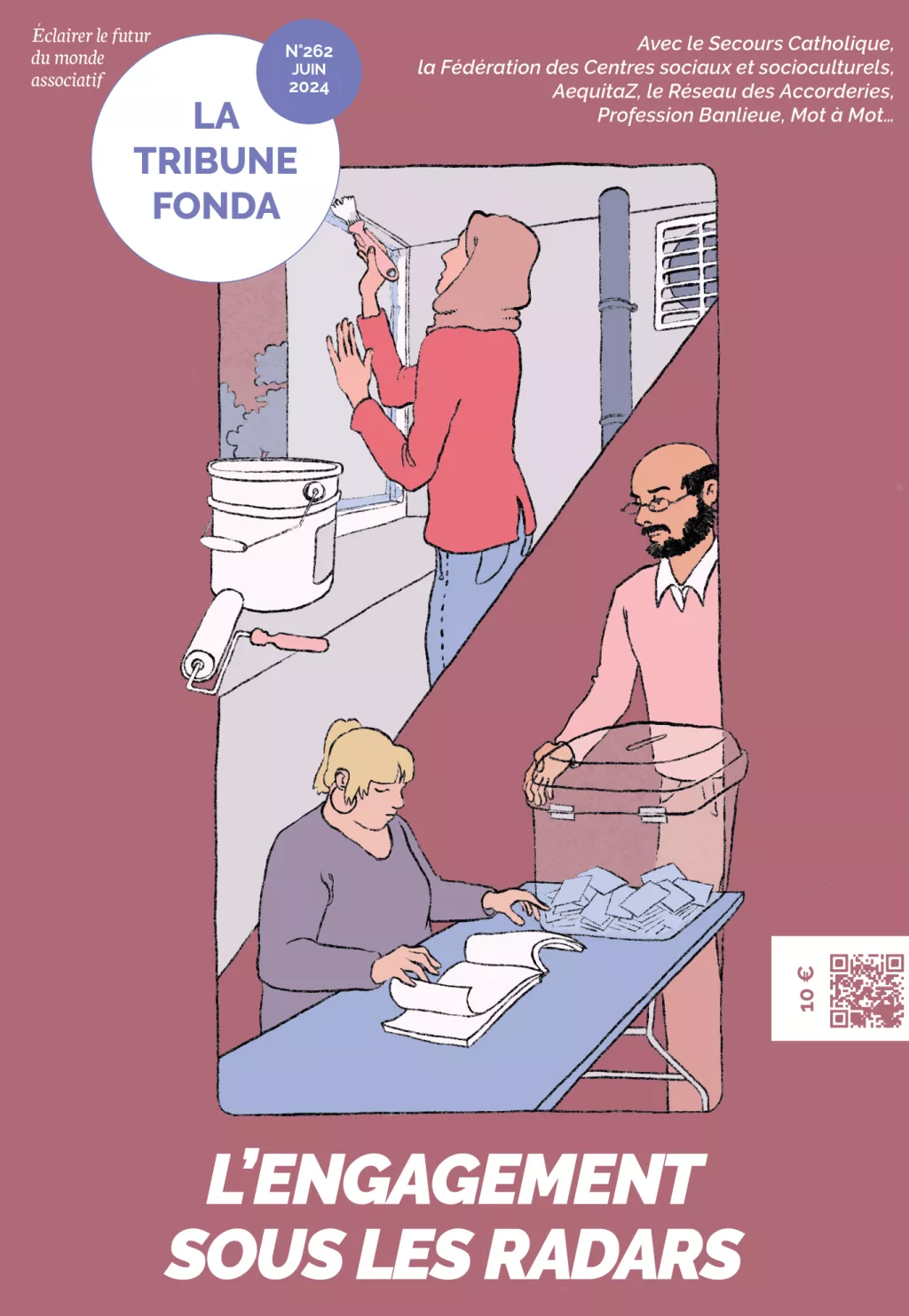Propos recueillis par Anna Maheu.
Comment est né le Centre d’entraide pour les demandeurs d’asile et les réfugiés (CEDRE) ?
Hélène Ceccato : Le lieu a été créé en 1989 pour répondre aux demandes croissantes d’accompagnement de personnes exilées sous différents statuts. Le Secours Catholique a donc ouvert ce lieu où des travailleurs sociaux multilingues assuraient un accompagnement individualisé, une domiciliation, etc.
Thibaut Largeron : Le CEDRE n’était composé que de salariés au départ, ce qui n’est le cas d’aucune autre délégation du Secours Catholique, plutôt même à rebours. Ce n’est pas sans conséquences sur notre modèle actuel.
Hélène Ceccato : Oui, notre fonctionnement, notre budget et notre gouvernance diffèrent nettement des délégations. Aujourd’hui nos locaux sont ouverts au public trois jours par semaine et nous proposons diverses activités, principalement animées par des bénévoles : un accueil, des permanences d’accès au droit, des ateliers d’apprentissage du français (ADF), etc.
De plus, 1 447 personnes étaient domiciliées au CEDRE et 2500 personnes ont participé aux informations collectives sur les droits en 20221.
Comment votre projet associatif a-t-il évolué ?
Hélène Ceccato : Au gré de l’évolution du projet du Secours Catholique, de celle des autres acteurs et de la structuration du secteur. Aujourd’hui, de nombreuses associations accompagnent et hébergent les personnes exilées. Il existe aussi à présent des Structures du premier accueil des demandeurs d’asile (sPADA)2. Cela faisait des années que nous demandions leur création au ministère de l’Intérieur et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) pour que chaque demandeur d’asile ait un référent unique qui l’accompagne de bout en bout.
Un des grands principes du Secours Catholique est d’agir en complément dans l’accompagnement social des personnes. Nous nous emboîtons avec l’action publique, aussi défaillante puisse-t-elle être. L’accompagnement des demandeurs d’asile que nous proposions jusqu’alors a été remis en cause par la création des sPADA.
Thibaut Largeron : L’association a choisi à ce moment-là de se recentrer sur plusieurs axes dont la convivialité, l’engagement citoyen et le développement du pouvoir d’agir des personnes.
Comment ce changement de positionnement a-t-il été pensé et mis en place ?
Thibaut Largeron : La fin de l’accompagnement individuel a entraîné une vraie remise en question au CEDRE fin 2017, avec le départ de nombreux bénévoles. À ce moment-là, les bénévoles et salariés enchainaient les rendez-vous, sans pause déjeuner et réalisaient l’accompagnement à la place des sPADA. Nous avons décidé de fermer le lieu au public et d’arrêter l’activité pour quelques semaines. Nous nous sommes retrouvés pour réfléchir ensemble sur l’avenir du lieu.
Hélène Ceccato : Nous ne voulions pas juste y réfléchir entre bénévoles et salariés. De fait, des personnes qui avaient besoin d’un accompagnement individuel continuaient de venir à l’entrée !
Les premiers jours de fermeture, nous étions plusieurs à la grille d’entrée pour leur expliquer pourquoi nous fermions temporairement, vers qui ils pouvaient se tourner, mais aussi les inviter à participer à nos échanges sur l’avenir du lieu.
Après ces premières réunions, nous avons lancé une recherche-action Bénévoles et concernés3 pour retravailler notre gouvernance et nourrir une réflexion au niveau national sur le bénévolat.
Le besoin de cette recherche-action préexistait-il à ce moment de réflexion en 2017 ?
Hélène Ceccato : Oui, les équipes s’interrogeaient déjà sur l’accompagnement plus individualisé dont pouvaient bénéficier les exilés qui devenaient bénévoles.
Le besoin est remonté de questions pratiques telles que celle des aides financières pouvant être mises en place pour permettre aux bénévoles de s’engager sans que la question financière soit une contrainte, pour les transports ou les repas notamment.
Notre secrétaire-comptable Mary ne savait pas qui avait le droit à quoi et à quelles conditions, cela n’avait jamais été écrit noir sur blanc !
Nous savions par ailleurs que d’autres délégations et équipes locales du Secours catholique comptaient des bénévoles exilés, mais qu’elles n’avaient pas les ressources humaines pour ce genre de recherche avec une méthode rigoureuse.
Nous avons donc utilisé le luxe dont nous disposons au CEDRE : de ressources salariales et du temps pour réfléchir.
Quels ont été les grands apprentissages de cette recherche-action ?
Thibaut Largeron : Déjà la différence entre l’efficacité et l’efficience. Des fois, un salarié pourrait faire la même activité qu’un bénévole beaucoup plus vite, ce serait efficace, mais pas efficient.
Par exemple, j’ai coanimé des ateliers de français avec un bénévole exilé nommé Jihadul. Cela nous demandait à tous les deux plus de temps de préparation, mais c’était bien plus riche pour nous deux.
Comme l’a dit Hélène, c’était un véritable choix politique de laisser les bénévoles s’emparer des sujets qui leur parlent et de les traiter à leur façon.
Hélène Ceccato : Oui, le bénévolat peut aussi agir comme déclencheur et permettre aux personnes exilées de faire des choses qu’elles n’auraient pas faites par ailleurs. Par contre, la recherche-action nous a appris que le bénévolat des personnes exilées se réfléchit en amont. Comme d’autres organisations, nous nous étions un peu lancés tout feu tout flamme, en construisant des règles au fur et à mesure. Capitaliser nous a permis de remettre un cadre, sur les aides financières entre autres.
Les bénévoles exilés sont-ils des bénévoles comme les autres ?
Hélène Ceccato : Nous le pressentions, mais la recherche-action nous a aussi permis d’identifier un point de vigilance : leur possible surinvestissement. Nous accueillons pas mal de personnes qui sont en cours de demandes d’asile ou sous Dublin4. Souvent, ils n’ont de contact qu’avec des travailleurs sociaux ou des agents des guichets de l’administration. Ils n’ont pas le droit de chercher un travail et la procédure semble interminable. Ils ont vraiment besoin d’une raison pour se lever le matin. L’engagement, au CEDRE ou ailleurs, les valorise et leur donne un rythme. Du coup, certains bénévoles exilés veulent venir tout le temps, ce qui n’est pas souhaitable.
Thibaut Largeron : Plus que pour d’autres bénévoles, l’aspect lien social est hyper important pour les bénévoles exilés.
Hélène Ceccato : L’importance du lien n’est pas spécifique aux bénévoles exilés. Les bénévoles les plus intégrés, exilés ou non, sont ceux qui ont trouvé un binôme, comme Thibaut et Jihadul.
Avez-vous pu objectiver d’autres phénomènes spécifiques aux bénévoles exilés ?
Hélène Ceccato : Oui, la recherche- action a aussi mis en lumière que nous avions tendance à leur assigner certaines activités. Par exemple, participer au Café Papote5 ou faire de l’aller-vers6, deux équipes qui sont déjà composées majoritairement de bénévoles exilés.
Thibaut Largeron : Au contraire, nous proposions moins facilement aux bénévoles exilés de participer à l’accès aux droits ou aux cours de français.
C’est une liberté appréciée au CEDRE : réinventer sa mission de bénévole au gré du temps.
Hélène Ceccato : Notre mission en tant que salariés est d’accompagner les bénévoles, pour qu’ils soient bien dans leur mission. Ma collègue Immaculée, qui est référente de l’animation de l’équipe Café Papote, fait très attention à soigner les débuts de l’engagement, pour renforcer notamment l’apprentissage de la culture du bénévolat qui ne va pas de soi selon les cultures et les histoires personnelles. Cela passe aussi par l’écoute des envies d’évolution ou de changement de mission selon la montée en compétences et la personnalité des bénévoles.
Thibaut Largeron : C’est une liberté que j’apprécie personnellement au CEDRE : réinventer notre mission de bénévole au gré du temps. Hélène Ceccato : Oui, comme tous les bénévoles, les personnes qui s’engagent au CEDRE ont besoin de voir tous les engagements possibles, de faire un peu d’immersion et même de changer de mission en cours de route.
Thibaut Largeron : Ce n’est pas parfait, mais j’ai l’impression que nous sommes aujourd’hui beaucoup plus souples sur la façon dont nous pensons le bénévolat. Dans l’équipe des cours de français, nous faisons par exemple plus facilement appel de façon ponctuelle à d’anciens apprenants pour qu’ils puissent être interprètes lors des temps d’inscription, d’accueil ou de premiers cours.
Nous réfléchissons aussi aux autres activités qui pourraient leur plaire comme bénévoles et les leur proposons, comme les brunchs mensuels.

Certains bénévoles sont-ils référents d’une équipe ?
Hélène Ceccato : Les référents des équipes sont des salariés, à l’exception de Thibaut.
Thibaut Largeron : Il y a aussi l’équipe de foot dont le référent est un bénévole en parcours d’exil ! Nous essayons justement d’avoir plus de bénévoles qui ont des mandats de responsable d’équipe. Mais être responsable d’une équipe fait peur, surtout pour des raisons de disponibilité. Personnellement, j’ai arrêté les cours de français en prenant le mandat parce que je n’avais pas l’impression d’arriver à bien faire les deux.
Hélène Ceccato : Certains n’ont tout simplement pas envie ! Une majorité des bénévoles viennent au CEDRE pour nouer des liens avec les personnes exilées autour d’activités, parce qu’ils croient en notre projet de défense collective des droits et de développement du pouvoir d’agir. Prendre un mandat de responsable conduit à s’éloigner du terrain et à diriger une équipe, avec les rapports hiérarchiques que cela implique.
Thibaut Largeron : Oui, je pense à une bénévole qui a eu une mauvaise expérience professionnelle, et ne veut pas du tout revivre ce type de rapports dans son bénévolat.
C’est une vraie problématique pour l’ensemble du monde associatif : le bénévolat de gouvernance ne fait pas rêver. De plus, la présence des salariés sur le site fait que les bénévoles se reposent beaucoup sur eux. Ils ont l’impression que le lieu n’a pas besoin d’eux pour tourner.
Comment penser alors d’autres formes d’implication, plus légères ?
Hélène Ceccato : Déjà nous avons aussi ouvert d’autres espaces d’engagement, comme le Conseil des Alliés. Au-delà des outils qui nous permettent de contourner l’écrit, comme les notes vocales, ou de traduire instantanément, nous essayons aussi d’adapter le format des réunions, en en limitant la durée par exemple et en utilisant le moins d’écrit possible.
Thibaut Largeron : Cela nous demande d’aller à contre-courant de notre culture française de la réunionite.
Nous interrogeons nos pratiques de réunion : comment la fait-on, de quoi parlons-nous pour aller à l’essentiel, avons-nous besoin de traduction, quelles techniques d’animation, etc. ?
Hélène Ceccato : Ou au moins d’identifier d’autres techniques d’animation pour rendre la réunion accessible à tous. Ma collègue Immaculée a beaucoup de bénévoles exilés dans son équipe du Café Papote. Pour s’adapter à leurs contraintes, les réunions de l’équipe ont lieu un mardi midi par mois et ils partagent un repas. C’est à la fois très régulier, mais aussi plus convivial.
Pour faire venir les bénévoles du Café Papote aux réunions générales, Immaculée leur a proposé d’animer les temps de convivialité et de faire des crêpes. Souvent ils restent à la réunion et y participent. C’est souvent aussi simple que de dire : « On a besoin de vous. »
- 1CEDRE, Rapport d’activité 2022, 2023.
- 2La loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile réforme en profondeur le droit de l’asile pour renforcer les garanties des personnes ayant besoin d’une protection internationale et statuer plus rapidement sur les demandes d’asile. Elle instaure un guichet unique d’accueil des demandeurs d’asile (Guda) lequel regroupe les services de la préfecture et de l’antenne territoriale de l’Office français de l’im- migration et de l’intégration (OFII). Les sPADA sont l’interface entre les demandeurs d’asile et ce guichet.
- 3Secours Catholique, Bénévoles et concernés. Agir avec des bénévoles exilés au Secours Catholique, 2019.
- 4Du nom du Règlement de Dublin de 2003, le système Dublin établit la responsabilité de la demande d’asile d’un seul État membre de l’Union européenne ; cet État étant celui par lequel le demandeur d’asile est entré en premier sur le territoire de l’Union. « Être sous Dublin » ou « être Dubliné » désigne donc être dans l’attente de l’examen de sa demande d’asile dans un autre pays ou du transfert de sa demande pour un examen en France.
- 5Le Café Papote est une porte d’entrée du CEDRE. Trois jours par semaine, des bénévoles accueillent, écoutent et discutent avec des personnes exilées, en leur offrant une boisson chaude dans les locaux du CEDRE.
- 6L’équipe d’aller-vers du CEDRE va à la rencontre des personnes deux soirs par semaine lors de distributions alimentaires.