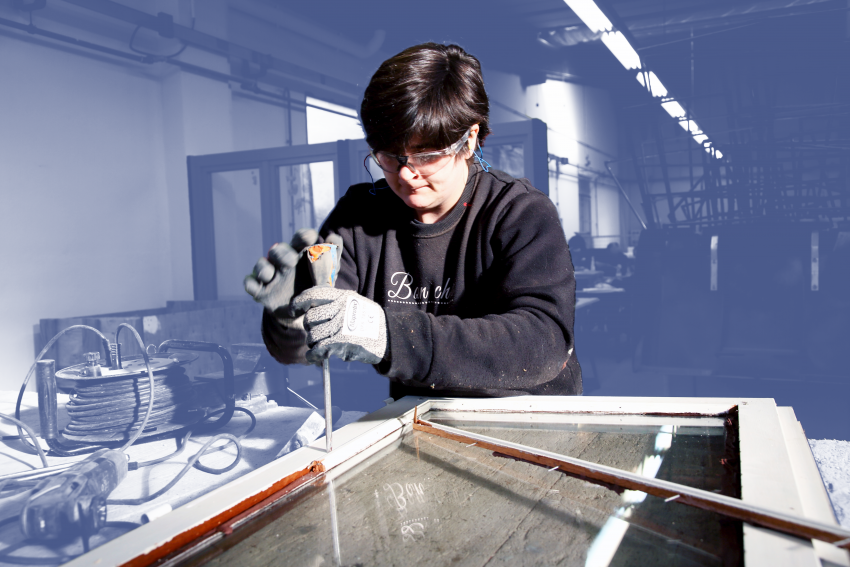L’inventivité dont font preuve les associations de lutte contre la pauvreté ne date pas d’hier : c’est notamment aux œuvres qu’on doit, au XIXe siècle, la création des crèches et des «salles d’asile» (aujourd’hui garderies), des patronages, des asiles de nuit ; ou, au tout début du XXe siècle, du travail social.
Mais la main est ensuite passée aux pouvoirs publics, rompant avec le libéralisme (non-intervention de l’État) qui avait caractérisé le XIXe siècle et renvoyant la religion à la sphère privée. Toutes les grandes lois d’assistance adoptées entre 1893 (loi sur les indigents malades) et 1976 (allocation parents isolés) émanent ainsi soit d’expérimentations des municipalités, soit du sommet de l’État.
En revanche, depuis la crise économique et sociale des années 1980, le centre de gravité de l’inventivité politique a rebasculé vers le monde associatif (actions locales ensuite transformées en dispositifs publics, mais aussi pressions pour le changement législatif). On examinera ce basculement dans trois champs, non-exhaustifs, mais centraux : l’insertion, la lutte contre le sans-abrisme et les grandes lois de lutte contre la pauvreté.
Les expérimentations associatives, motrices des politiques d’insertion
Les structures d’insertion ont d’abord été une réponse au chômage des jeunes, croissant depuis la fin des années 1960 et exponentiel durant la première moitié des années 1980. Rapidement toutefois, leur public cible s’est étendu aux femmes et aux chômeurs de longue durée, puis à tout individu privé d'emploi.
ATD Quart Monde (ATDQM) en est semble-t-il la pionnière en France. Dans le bidonville de Noisy-le-Grand, où l’association est née en 1956 et s’est durablement implantée, des ateliers de travail pour femmes et jeunes filles, puis également pour hommes, avaient été créés dès 1958, développés dans les années 1960 et, par progressives transformations, (co)financés par les pouvoirs publics.
Suite au constat de leur très fort chômage, l’association souhaitait en effet aider les habitants « à retrouver les habitudes du travail régulier » et acquérir des qualifications professionnelles.
Au tout début des années 1980, Emmaüs compte parmi les quelques associations emboîtant le pas, avec des inspirations étrangères. Elle crée d’abord en 1983, dans le giron de la communauté de Strasbourg, Entreprises nouvelles vers l’insertion économique (ENVIE ). ENVIE fonctionne par récupération d’électroménager au service de la réinsertion des jeunes, sur un modèle scandinave. Viendra ensuite la gestation en 1983-1985 du Relais, dans le giron d’Emmaüs-Artois, qui organise la récupération de textiles au service de la réinsertion des jeunes, puis plus largement des chômeurs, sur le modèle de la communauté belge de Namur2.
Ce sera, comme ENVIE, un succès : en quatre ans, 140 salariés sont embauchés.
En ce début de pouvoir de la gauche mitterrandienne, soucieuse de trouver des dispositifs de lutte contre le chômage (en particulier des jeunes), les pouvoirs publics soutiennent ces innovations par le développement de mesures légales, qui accompagnent le rapport Schwartz (1981) et la création des missions locales. En 1983, les TUC sont créés3. En 1985, c'est le statut d’« entreprise intermédiaire » qui est lancé, suivi en 1987 de celui d’« association intermédiaire ». Dans les années 1990, une succession de dispositifs d'emplois-aidés se succèdent.
Adossées à ces nouveaux statuts, les initiatives associatives se multiplient : en 1984, Comité chrétien de solidarité avec les chômeurs et les précaires (CCSCP) ; en 1985, COORdination des associations d’aide aux chômeurs par l’emploi (COORACE) et Solidarités nouvelles face au chômage… Depuis 1988 et la loi sur le revenu minimum d’insertion (RMI), quantité d’associations et fédérations y recourent, sous les modalités les plus diverses.
Au fil des années cependant, les politiques d’insertion ont été aussi saluées sur leur principe que critiquées dans leurs modalités.
Elles ne donnent en effet droit ni à une rémunération décente, ni à une protection sociale de qualité, ni souvent à une réelle formation.
Faute d’emplois suffisants à la sortie, elles s’avèrent en outre moins « une étape » qu’un « cul-de-sac4» . Et quand les personnes parviennent à accéder à l’emploi de droit commun, celui-ci est souvent pénible, sous-payé et peu protégé — c’est à dire maintenant davantage dans la pauvreté monétaire et la précarité polymorphe (du logement, de la santé, du travail, etc.) que permettant d’en sortir.
C’est pour tenter de remédier à ces apories qu’une nouvelle génération de structures d’insertion voit le jour, depuis les années 2000. ATDQM figure de nouveau parmi les moteurs. Depuis 2002, son dispositif « Travailler et apprendre ensemble » repense l’entreprise à partir de ceux qui en sont exclus (priorité d’embauche aux plus défavorisés, attention portée au rythme de chacun et à l’ambiance de travail, pédagogie de la coopération, etc.) et propose à ceux qui le souhaitent, à l’issue du contrat aidé, un CDI à temps plein et au SMIC.
ATDQM a aussi servi de pépinière au projet Territoires zéro chômeur de longue durée, forgé depuis 1994 par Patrick Valentin. Il montre lui aussi que « nul n’est inemployable » et qu’il peut y avoir, sur des territoires, davantage d’emplois potentiels et utiles que de chômeurs de longue durée. Mais l’inventivité est plus largement partout : les Pôles territoriaux de coopération économique (PTCE) réinventent le développement local durable ; Emmaüs-Défi, le « travail à l’heure » ; la Ferme de Moyembrie, le travail rural des détenus en fin de peine ; etc.
Révolutions dans le traitement du sans-abrisme
Dans un autre secteur, celui du sans-abrisme, le rôle des associations est tout aussi fondamental : « Il n’y a pas un élément de la politique publique qui n’ait été en réalité initié, inventé ou à tout le moins validé par les associations. La politique publique consiste essentiellement à traduire dans le moule de dispositions réglementaires des initiatives associatives.5 »
Le tournant des années 1980-1990 est celui de la médiatisation des « nouveaux pauvres », des « SDF » et des morts de froid dans les rues, mais aussi de la dépénalisation du vagabondage et de la mendicité — qui fait officiellement des sans-abri non plus des délinquants, mais des victimes ; non plus des personnes à incarcérer, mais à secourir et héberger6.
Depuis, les associations ont témoigné d’une considérable inventivité : création des accueils de jour ; du Samu social, fondé sur le double principe d’immédiateté et d’inconditionnalité ; du 115 ; des « lits halte soins santé » (ou « lits infirmiers ») ; des « maisons-relais » et des « pensions de famille » ; des haltes de nuit, etc. Au-delà de ces nombreuses expérimentations, rapidement reprises par les pouvoirs publics sous forme de « dispositifs publics », les associations ont aussi impulsé deux changements de paradigme.
Le premier est le passage, avec la crise économique et sociale, à des politiques d’urgence, de réactivité et de turn-over, visant à maximiser le nombre des hébergés — mais au détriment de la durée d’hébergement (généralement trois à sept jours) et de la qualité de l’accueil7. La grande majorité des associations y a contribué.
Par réaction, un second tournant a été initié au milieu des années 2000, d’abord à l’instigation de Médecins du Monde à l’hiver 2005-2006, puis des Enfants de Don Quichotte un an plus tard, rapidement soutenus par les grandes associations et fédérations du secteur. D’où, depuis 2007, le passage à des politiques de « stabilisation », consistant inversement à ne plus remettre à la rue, chaque matin, des hébergés qui devront passer leur journée à rappeler le 115 pour retrouver, au même endroit ou ailleurs, une nouvelle place le soir.
Les associations, motrices dans l’approfondissement des droits
C’est encore aux grandes associations qu’on doit la considérable redéfinition du système assistantiel français depuis les années 1980, avec la création de nouveaux droits. Le RMI d’abord (devenu fin 2008 RSA) qui permet pour la première fois en France, en 1988, à toute personne dépourvue de ressources d’avoir accès à un revenu minimum.
Les expérimentations menées par ATDQM au milieu des années 1980, puis le rapport Wresinski au Conseil économique et social en février 1987, en ont été des catalyseurs majeurs.
ATDQM a également été la tête de file de la loi de lutte contre les exclusions (1998). Dans le même temps, des coalitions d’associations du secteur sanitaire et social œuvraient à faire aboutir la CMU et l’AME (1999). Pour parachever le droit au logement (1990), c’est encore aux associations qu’on doit la genèse et l’aboutissement du droit au logement opposable (DALO, 2007).
Plus largement, les associations effectuent au quotidien un travail de fourmi dans quantité d’arcanes — du Conseil national de lutte contre les exclusions au Haut Comité pour le logement des défavorisés, du Conseil économique, social et environnemental au Haut Conseil à la vie associative, etc. — pour partager leur plaidoyer et leur expertise.
Que seraient donc, sans les associations de solidarité, les politiques françaises de lutte contre la pauvreté ?
Tout autre chose. Il n’est même pas sûr qu’on pourrait parler de « modèle » français ou de « voie » française.
Laquelle existe pourtant bel et bien : la voie anglo-américaine est depuis les années 1970 séduite par le workfare et consiste souvent à imposer aux chômeurs des prestations très rognées et durcies, pour réduire les dépenses sociales et contraindre à accepter les « bad jobs ». L’Allemagne a réduit son chômage par une forte précarisation des emplois. Dans les pays scandinaves, les politiques socio-économiques ont plutôt visé « l’activation » vers la formation et l’emploi qualifié, avec une sécurisation des allocations de chômage et « l’investissement social » en faveur de la petite enfance et du travail des femmes.
La France a quant à elle opté pour une autre voie encore, à la fois médiane et originale, mêlant réponse aux urgences sociales, politiques d’insertion et édification d’un socle de droits fondamentaux répondant aux différents facteurs de pauvreté (revenu, logement, santé…) comme levier d’action. Dans ce modèle, le rôle des associations a été fondamental — et continue de l’être —, grâce aux réflexions et innovations du quotidien ensuite transformées en dispositifs publics.
- 2Parvenue en quatre ans à embaucher 140 salariés par la collecte et la récupération de vêtements.
- 3Travaux d’utilité collective ; stages effectués à mi-temps par des jeunes en recherche d’emploi, indemnisés la moitié du SMIC.
- 4Robert Castel, Les Métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat, Fayard, 1995 (p. 699 Folio essais).
- 5Pascal Noblet, Pourquoi les SDF restent dans la rue, L’Aube, 2010, p. 50.
- 6Stéphane Rullac, Le Péril SDF. Assister et punir, L’Harmattan, 2008, introduction.
- 7Édouard Gardella, L’Urgence sociale comme chronopolitique. Temporalités et justice sociale de l’assistance aux personnes sans-abri en France depuis les années 1980, thèse pour le doctorat en sociologie, ENS de Cachan, 2014.
- 1Didier Fassin, « L’humanitaire contre l’État, tout contre », Vacarme, n°34, 2006-1, p. 15-19.