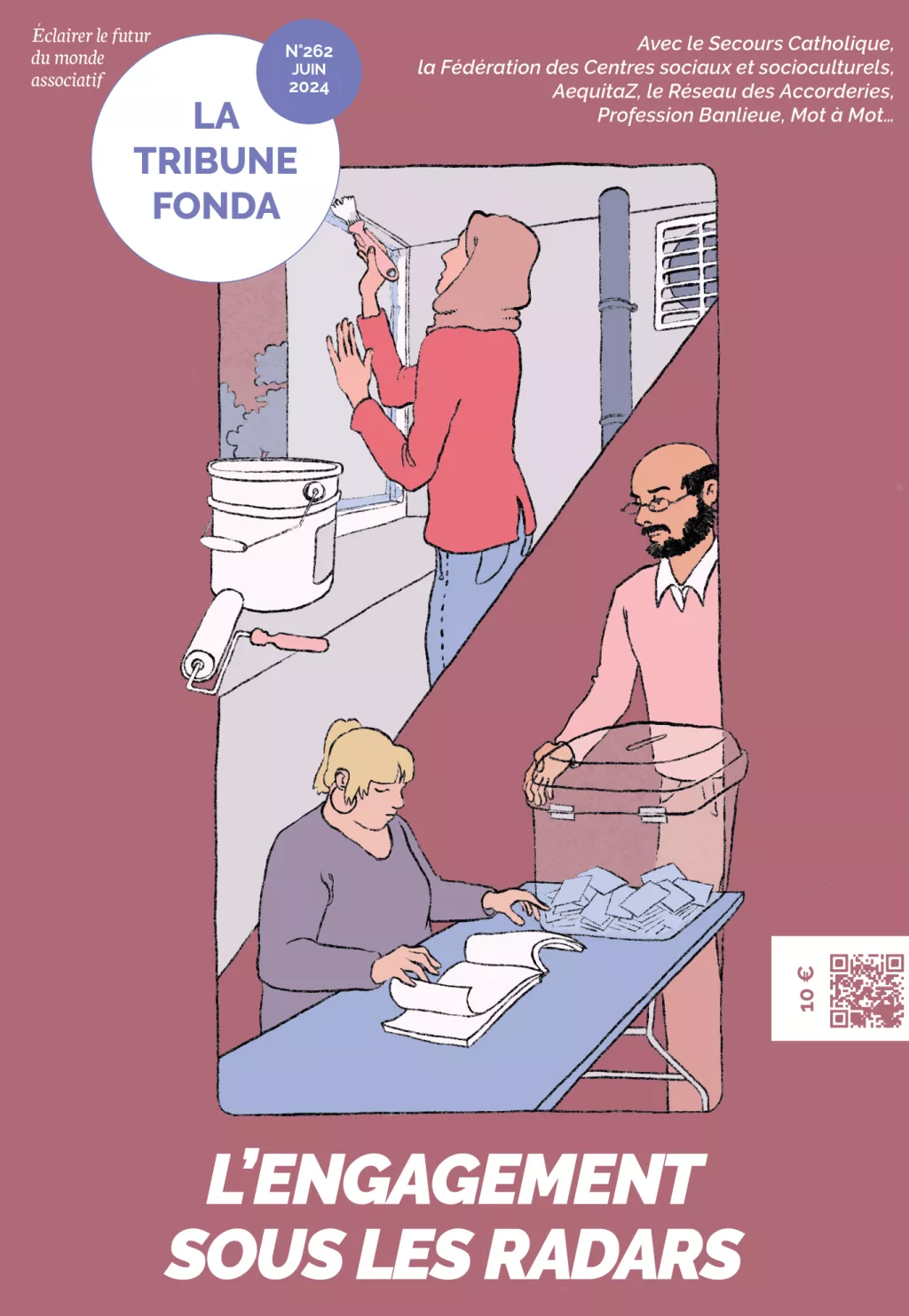LE « BOULOT DE DINGUE » DES PERSONNES EN SITUATION DE PRÉCARITÉ
L’idée du rapport Un boulot de dingue1 est née pendant les confinements, où nous nous sommes collectivement interrogés sur la notion de « biens et services essentiels »2. En France, l’emploi salarié est la clé de voûte de notre système de protection sociale. Par les salaires, employeurs et salariés cotisent et ces derniers ont ainsi accès à des droits tels que la formation, le chômage ou encore la retraite.
Le système de protection sociale français est unique et précieux, car il apporte une très large sécurité à la population, mais il protège moins bien les personnes qui travaillent également, mais en dehors de l’activité rémunérée.
En effet, les personnes sans emploi sont actives, n’en déplaise à la statistique qui classe nombre d’entre elles parmi les « inactifs »3. Leur travail est par contre invisibilisé : entraide de voisinage, soins à un parent, un proche en situation de handicap ou à un enfant, bénévolat et solidarité, tâches ménagères et familiales…
Ce travail hors emploi — très majoritairement réalisé par des femmes — est essentiel à l’ensemble de la société. Les personnes en précarité prennent leur part dans ces activités, loin de seulement coûter un « pognon de dingue »4.
Ces activités, mises bout à bout, jouent un rôle de protection sociale de proximité selon les termes de Robert Castel5. Or, elles ne sont pas reconnues, alors que sans elles, c’est toute la société qui s’effondrerait.
INTERROGER LE DIPTYQUE TRAVAIL/PRÉCARITÉ
Les personnes en précarité vivent une triple injustice : le manque d’argent, le mépris social et la non-reconnaissance de leur contribution.
Agir comme bénévole ou comme aidant alors qu’on vit au Revenu de solidarité active (RSA) cela veut dire 607 € par mois pour une personne qui vit seule6. Comment alors avancer les faux frais, couvrir ses déplacements, s’offrir un droit au répit ? L’activité n’en est que plus difficile à réaliser, c’est ce que notre travail de recherche a permis de révéler en scrutant le quotidien de ces actifs de l’ombre.
Début 2025, l’obtention du RSA va devenir conditionnée à la réalisation de 15 heures d’activité obligatoires7. Ce n’est pas une reconnaissance de ce que les gens font déjà, mais un engagement supplémentaire à réaliser davantage d’activités dans la perspective unique du retour à l’emploi.
Les personnes en précarité vivent une triple injustice : le manque d’argent, le mépris social et la non-reconnaissance de leur contribution.
Comme si les personnes ne faisaient rien et avaient tout le loisir d’adapter leur agenda ! C’est bien méconnaitre les réalités de la pauvreté vécue dans notre pays. Selon nous, la priorité devrait être du côté de la confiance et de la sécurisation des ressources stables et réévaluées pour sortir de la survie.
Dans ce rapport, AequitaZ et le Secours catholique plaident notamment pour la mise en place d’un revenu minimum garanti et inconditionnel qui sécuriserait les personnes et leur capacité à continuer de prendre soin d’elles et leurs proches. La loi Plein Emploi fait reculer cette perspective et plonge les allocataires du RSA dans davantage de peurs et d’incertitudes.
L’INDISPENSABLE RECONNAISSANCE DES CONTRIBUTIONS VITALES À LA SOCIÉTÉ
Garantir un revenu décent permettrait à chacun de se projeter sereinement, entre autres dans des activités du care. Toute une part de la société s’engage dans de telles activités du « prendre soin », en dehors du travail-emploi.
En 2018, la France comptait par exemple 9,3 millions d’aidants familiaux qui soutiennent au quotidien 15 millions d’enfants et 5 millions d’adultes malades, en situation de handicap ou âgés8.
Nous devons sécuriser ces activités essentielles à la société. Avec le rapport Un boulot de dingue, nous avons initié un inventaire des activités utiles et vitales, qu’elles soient rémunérées ou non. Nous avons bien vu que l’idée d’élargir le spectre de la protection sociale aux activités utiles socialement et écologiquement apparaît comme un vrai changement de modèle. Mais nous avons aussi constaté que des formes hybrides de reconnaissance du « hors emploi » existent déjà : les élus ont des statuts spécifiques, les pompiers volontaires et les aidants également.
Nous nous sommes interrogés sur la nécessité d’évaluer ces nouvelles « cases » : sont-elles adaptées, suffisantes ? Doit-on en créer d’autres ou bien repenser le système dans son ensemble ?
Ce chantier démocratique doit avoir lieu, nous en sommes convaincus. Et il doit tenir compte de l’expertise d’usage, de la parole des premiers concernés, et embarquer les personnes dans l’analyse de ce qui est en jeu.
Notre travail est un appel au débat, ce n’est qu’une première marche : c’est en partant de la vie des gens que nous ferons remonter des sujets politiques et que nous trouverons collectivement des solutions.
- 1Marion Ducasse, Célina Whitaker, Jean Merckaert, Daniel Verger (AequitaZ et Secours catholique), Un boulot de dingue, 2023, [en ligne].
- 2Lors des confinements instaurés en 2020 et 2021 pour contrer la propagation du COVID-19, le gouvernement a publié plusieurs décrets distinguant les commerces dits de première nécessité ou « essentiels » de ceux qui étaient soumis aux obligations de fermeture. Ces décrets ont suscité des débats vifs sur ce qui peut être considéré comme essentiel.
- 3Selon le Bureau international du travail, la population « active » regroupe la « population active ayant un emploi » et les chômeurs. Les « inactifs » sont les personnes âgées de 15 ans ou plus qui ne sont ni en emploi ni au chômage. En 2020, sur 67 millions de personnes en France, 36,4 millions sont comptabilisées comme « inactives ».
- 4Le 12 juin 2018, à l’occasion d’un entretien informel avec ses conseillers enregistré à des fins de communication, le Président de la République française Emmanuel Macron déclare « On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens, ils sont quand même pauvres. On n’en sort pas. Les gens qui naissent pauvres, ils restent pauvres. Ceux qui tombent pauvres, ils restent pauvres. »
- 5Robert Castel, Les Métamorphoses de la question sociale, Fayard, 1995.
- 6En juin 2024, le montant du RSA pour une personne seule est de 635,70 €. Une hausse de 4,6 % a eu lieu le 1er avril 2024.
- 7Le conditionnement du RSA à 15 heures d’activité imposées aux allocataires est un dispositif déployé dans le cadre de la loi « plein emploi » promulguée le 18 décembre 2023. Après une expérimentation menée depuis 2023 dans 19 territoires (18 départements plus la métropole de Lyon), la moitié des départements français est entrée dans l’expérimentation début mars 2024.
- 8Drees, « Les proches aidants en France », Études et résultats n° 1255, Enquête Vie quotidienne et santé 2021, [en ligne].