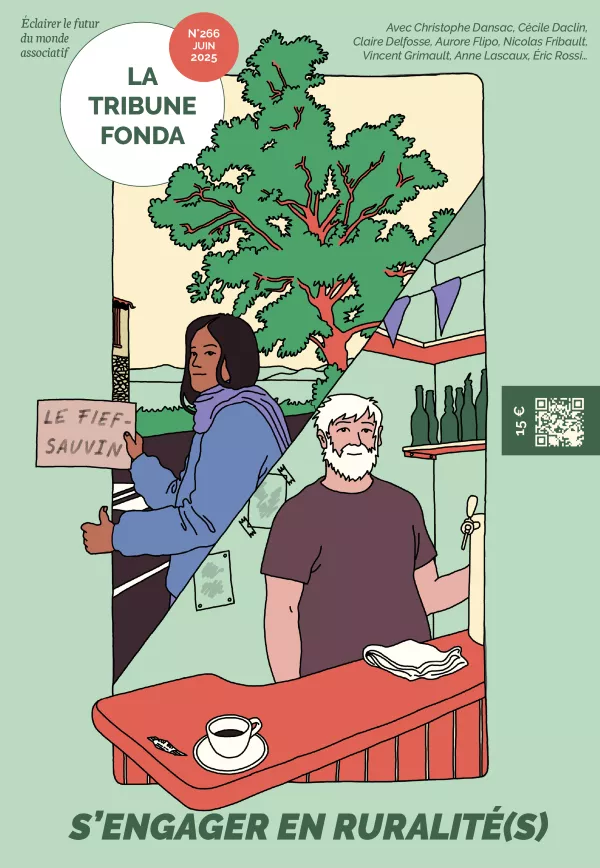Propos recueillis par Anna Maheu.
Pourquoi la mobilité est-elle un sujet central pour les Français qui vivent en zone rurale ?
La faible densité se caractérise par l’éloignement géographique, c’est sa définition même. Le retrait des services publics au cours des dernières décennies qui a concerné tout le territoire français se traduit en ruralité par une augmentation des distances. Aussi les activités se sont éloignées des villages.
Auparavant le bourg se pensait souvent avec l’atelier, pour reprendre les travaux du sociologue Julian Mischi1, c’est-à-dire qu’une usine pouvait fournir l’essentiel du travail au niveau du village.
Aujourd’hui ces usines ont disparu, et les lieux de travail sont beaucoup plus éclatés.
Attention néanmoins : dans les territoires ardéchois et drômois que nous avons étudiés, un actif sur deux travaille encore dans la commune où il vit2.
Le grand navetteur qui parcourt 80 km par jour pour se rendre à son lieu de travail existe donc, mais ce n’est pas la seule configuration possible, les comportements sont bien plus divers.
L’aménagement du territoire a-t-il favorisé une mobilité motorisée ?
C’est un peu le serpent qui se mord la queue : la voiture a modifié les pratiques et les paysages jusqu’à devenir indispensable. C’est la voiture qui a rendu possible et désirable l’aménagement des périphéries, qu’il s’agisse de périurbanisation résidentielle avec les lotissements ou de périurbanisation productive avec les zones commerciales et artisanales. Tout cela s’est développé par et pour la voiture.
Quelles sont les conséquences de cette dépendance induite à l’automobile pour les plus précaires et les plus fragiles ?
L’inégale répartition des ressources de transport renforce les inégalités sociales. Ces inégalités sont exacerbées dans le contexte rural du fait de distances plus importantes. Sans moyen de mobilité, on ne peut accéder à des ressources qui sont dispersées sur le territoire : le travail, l’éducation, l’approvisionnement, etc.
Le système automobile repose uniquement sur les individus : en ruralité, c’est à l’individu de se procurer son moyen de transport alors qu’en ville les plus vulnérables peuvent tout de même se déplacer grâce à des services publics.
Outre le coût de la voiture elle-même, de l’essence et de son entretien, conduire demande des compétences et des capacités que l’on est susceptible de ne pas avoir, par exemple quand on est jeune, âgé ou en situation de handicap. Pourtant ces populations ont autant, voire plus que les autres, des besoins de mobilité.
Comment les problématiques de mobilité sont-elles devenues un sujet de politiques publiques ?
Il y a eu un début de réflexion autour de la mobilité avec le rapport Oliver Paul-Dubois-Taine remis en 2012 au Premier ministre3, puis bien sûr le mouvement des Gilets jaunes.
Au niveau de l’État central, c’est véritablement ce mouvement qui a déclenché une prise de conscience.
Jusqu’alors les mobilités rurales étaient un angle mort des réflexions sur la transition écologique.
L’État n’avait pas de réponses satisfaisantes à y apporter, et c’est toujours le cas pour être honnête.
Comment expliquer un tel angle mort ?
Pendant longtemps, les territoires ruraux ont été totalement mis à l’écart des politiques de transport, avec une invisibilisation des questions sociales liées à la mobilité. On se disait alors qu’il n’y avait pas de problème de mobilité en ruralité, puisque la voiture était abordable même pour celles et ceux qui avaient de petits salaires.
Différents acteurs associatifs se sont néanmoins saisis tôt de cette question ?
Oui les acteurs de l’action sociale ont été les premiers à se saisir de la question de la mobilité, justement parce que cela a toujours été une question sociale. Depuis longtemps les acteurs du social ont développé des initiatives sur la mobilité comme des garages solidaires ou des taxis bénévoles.
Ensuite sont apparues des associations dont l’objet est la défense d’un mode de transport en particulier : le train, les transports publics, ou plus récemment le vélo. L’Association française pour le développement des véloroutes et des voies vertes (AF3V) est une exception à ce titre : elle existe depuis plus de 25 ans !
Enfin vous avez les associations dont l’enjeu principal est l’environnement, et qui se sont intéressées à la mobilité par ce biais. Jusqu’à récemment, les associations écologistes rurales avaient peu investi la question de la voiture.
Qui constitue cet écosystème associatif ?
Bien que les milieux associatifs autour de la mobilité aient souvent été décrits comme des univers de néoruraux, ce n’est pas ce que nous avons observé dans nos terrains d’enquête.
Oui les nouveaux habitants sont nombreux dans ces associations, parce qu’ils ont été habitués à se déplacer sans voiture au quotidien et souhaitent pouvoir continuer à le faire. Mais ils ne sont pas seuls, ils viennent compléter des effectifs déjà présents, dont les retraités qui y sont aussi présents que dans les autres associations4.
Les associations sur la défense des modes de transport comptent au contraire plus d’actifs parce que cela touche à l’organisation domicile-travail et au déplacement des enfants, des questions qui les concernent dans l’immédiat.
Ces engagements ne seraient donc pas spécifiquement ceux des catégories socioprofessionnelles dites supérieures ?
Non, même si tous les publics ne défendent pas les mêmes modes de transport. Le train au quotidien par exemple va concerner plutôt des cadres.
De plus, il existe un monde très actif de l’action non organisée au sens institutionnel du terme, qui est beaucoup plus populaire et féminin. Sur le covoiturage par exemple vous n’avez pas plus expertes que les mamans. Pour les matchs de foot, pour les anniversaires, pour les sorties scolaires, elles s’organisent pour mutualiser les trajets.
Cela fait vraiment partie de la charge mentale d’une mère en milieu rural : ce sont de véritables logisticiennes !
De même, ce sont souvent les aidantes, des femmes donc, qui emmènent les personnes âgées à leur rendez-vous médical ou qui se déplacent à domicile pour venir les voir ou leur apporter leurs courses. Une grande partie des aides à la mobilité pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer est assumée de façon informelle par les femmes, qu’elles soient membres de la famille, voisines, infirmières, aides-soignantes, auxiliaires de vie ou encore femmes de ménage.
Dans votre contribution à L’écologie depuis les ruralités, vous défendez que « les associations ont émergé pour répondre à une demande sociale forte qui ne trouvait pas d’interlocuteur [en matière de mobilité] »5. L’ensemble de ces engagements fournit-il des services qui feraient défaut autrement ?
Oui, le milieu associatif pallie une forme d’absence, mais cela ne suffit pas malheureusement. L’action associative est venue d’abord en soutien aux plus précaires qui ne pouvaient pas rentrer dans le schéma de la voiture individuelle.
Plus tard elle est venue sauvegarder ce qu’il restait de transports publics là où ils étaient menacés, puis défendre de nouveaux usages. Tout cela a été l’œuvre exclusive de l’engagement associatif.
Néanmoins pour mettre en place des activités et des services à plus grande échelle il faut des financements plus importants qui font encore défaut.
Les différentes associations sont-elles en compétition ou coopèrent-elles ?
Lors de notre étude, nous avons observé de nombreuses coopérations, mais cela dépend beaucoup de la configuration du territoire. La Drôme et l’Ardèche diffèrent à ce sujet. Une ligne de train drômoise avait failli disparaître à un moment donné, et avait fait l’objet d’une mobilisation, lutte au cours de laquelle un écosystème s’était structuré autour de la mobilité.
C’est cette coopération à l’échelle territoriale qui a permis plus tard l’émergence d’un opérateur de mobilité associatif que nous avons étudié : Dromolib.
Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de concurrence entre acteurs, notamment sur les questions d’attribution de crédits. Les associations sont souvent plus nombreuses que les subventions disponibles. Mais globalement, les associations qui se connaissent ont tendance à faire front commun.
Par ailleurs on observe dans le milieu rural un phénomène prégnant de « multicasquétisme ». Le président d’association est aussi conseiller municipal et membre de trois ou quatre autres associations.
Ces participations croisées font du milieu associatif un réseau social dense, avec beaucoup d’interconnaissance.
En Ardèche, nous avons observé au contraire que les associations sont moins interconnectées au niveau territorial. Il s’agit le plus souvent d’initiatives très locales qui concernent un village ou un axe. Il y a moins de fédérations au niveau territorial. Même si elles coopèrent moins, ces associations sont rarement en concurrence, à l’exception notable des appels à projets.
Il y a bien assez de besoins sur chacun de leurs territoires pour justifier leur existence. En outre elles vont pouvoir se fédérer autour de projets particuliers, comme la mise en œuvre d’un schéma directeur cyclable.
Les pouvoirs publics sont-ils conscients du rôle de la société civile dans la mobilité en ruralité ?
Oui bien sûr, et c’est comme dans beaucoup d’autres domaines à la fois une force et une limite. Les pouvoirs publics ont tendance à se reposer entièrement sur la société civile et donc à se dédouaner d’autres formes d’action.
J’ai regardé beaucoup de débats à l’Assemblée nationale et au Sénat sur la mobilité rurale : ils étaient nombreux à se conclure sur la nécessité de se reposer sur la société civile. Parce qu’elle est compétente, mais aussi, soyons honnêtes, parce que cela demande moins de moyens que de réfléchir à une vraie politique publique.
La gouvernance est l’un des aspects les plus problématiques pour pouvoir effectuer de réels changements.
Les acteurs sont éclatés, à la fois spatialement et en termes de de compétences, la mobilité concernant à la fois les communes, les intercommunalités, les départements et les régions depuis la loi LOM6.
Cette loi a été un grand changement pour les collectivités territoriales rurales, en leur permettant de s’emparer de ces sujets, mais sans leur donner plus de financements pour le faire.
Même si des fédérations comme celle des associations d’usagers des transports (Fnaut), des usagers de la bicyclette (FUB) ou les Villes et Territoires Cyclables le réclament, il n’y a pas de vrai plan d’action pour la mobilité rurale au niveau de l’État.
La faible densité est-elle un handicap indépassable pour une transition mobilitaire en ruralité ?
Non je ne pense pas. On ne peut d’ailleurs pas le penser, parce qu’on n’a simplement pas le choix. Les élus sont conscients que l’ère du tout automobile est révolue.
Se déplacer en voiture n’est plus aussi abordable que dans les années 1970.
Les élus ne savent néanmoins pas quoi proposer d’autre parce que nous peinons à imaginer d’autres modèles de développement rural. Encore une fois on manque d’une vision d’ensemble.
Vous ne croyez pas à la voiture électrique comme remplacement de la voiture thermique ?
La voiture électrique peut être une partie de la solution, mais pas toute la solution, parce qu’elle va reproduire les inégalités du système thermique et même les amplifier. Les voitures électriques ne seront jamais bon marché, du fait des batteries coûteuses à produire.
Et puis encore faut-il avoir accès à de l’électricité bon marché !
Investir dans une voiture électrique est intéressant pour les propriétaires de maison individuelle avec des panneaux solaires sur leur toit. Les ménages plus pauvres quant à eux vivent en appartement, n’ont pas accès à des prises électriques privées, ils n’ont même pas de place de parking privée la plupart du temps et n’ont pas non plus les moyens de produire leur propre électricité.
Donc la généralisation de la voiture électrique risque d’aggraver les inégalités sociales.
Par ailleurs, la voiture électrique a longtemps été une solution de facilité : il suffisait de changer de source d’énergie pour que la question de la mobilité soit réglée. Nous savons pourtant aujourd’hui qu’il ne sera pas possible de remplacer chaque voiture thermique par une voiture électrique équivalente, du point de vue de la gestion de la demande en électricité cela paraît, en tous cas aujourd’hui, impossible.
C’est tout notre système sociotechnique que nous allons devoir changer, et cela au plus vite ! Et aussi s’appuyer sur d’autres leviers comme imaginer des voitures plus légères, moins gourmandes en ressources à l’image des « véhicules intermédiaires » développés dans plusieurs territoires.
- 1
Julian Mischi, Le bourg et l’atelier ? Sociologie du combat syndical, Agone, 2016.
- 2
Aurore Flipo, Madeleine Sallustio, Nathalie Ortar, Nicolas Senil et Kevin Cariou, La transition mobilitaire en territoire peu dense, Ademe, 2021, [en ligne].
- 3
Olivier Paul-Dubois-Taine (Centre d’analyse stratégique), « Les nouvelles mobilités dans les territoires périurbains et ruraux », La documentation française, Rapports & documents n° 47, 2012, [en ligne].
- 4
43 % des bénévoles dans une association en 2024 ont plus de 50 ans. Recherches et solidarités, La France bénévole en 2024 – 19e Édition, mai 2024..
- 5
Aurore Flipo, « La décarbonation des mobilités quotidiennes en ruralité », L’écologie depuis les ruralités, Fondation de l’écologie politique, 2025.
- 6
Promulguée en décembre 2019, la Loi d’orientation des mobilités (LOM) transforme en profondeur la politique des mobilités.