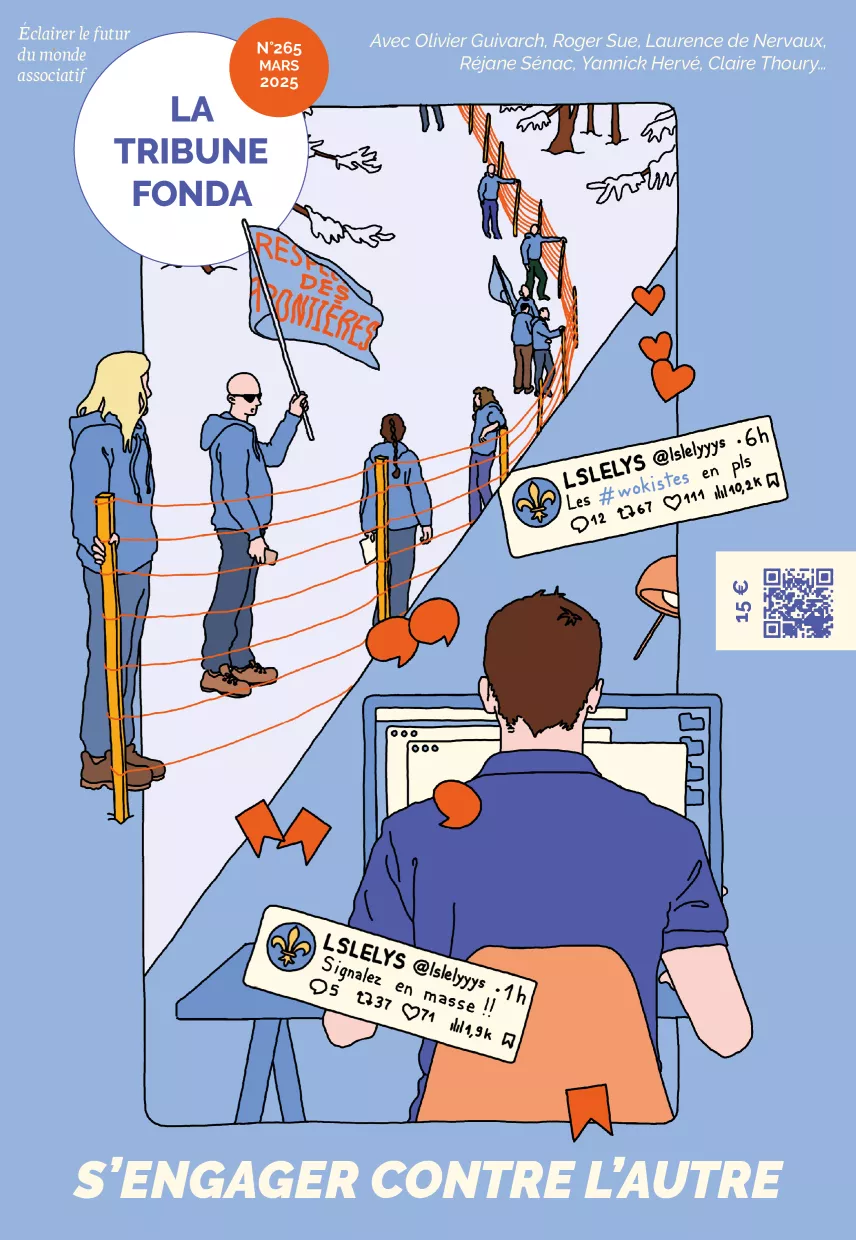Propos recueillis par Anna Maheu et Gabriela Martin.
Comment la société civile argentine a-t-elle évolué depuis les années 1960 ?
Entre les années 1960 et 1980, la société civile argentine s’est dissoute au sein de la politique. À l’origine, le réseau associatif trouvait ses racines dans les migrations italiennes, espagnoles, françaises d’un côté et de l’autre, des sociabilités catholiques. Pendant les années 1960, puis les années 1970, la politique fonctionnait comme un catalyseur de la vie sociale en Argentine.
La dictature militaire des années 1966 à 19831 s’est accompagnée d’une mise à l’arrêt brutale. Les hauts gradés militaires, les cadres politiques et les administrateurs de ces dictatures ont oscillé entre deux positions : le libéralisme conservateur et le néocorporatisme. Cela s’est traduit par une répression du réseau associatif.
Ce n’est qu’après la fin des dictatures militaires, soit la seconde moitié des années 19802, que le réseau associatif argentin s’est progressivement relevé. Nécessité faisait loi : notre pays connaissait alors une terrible crise économique nourrie par l’hyperinflation.
Comment est-ce que vous situez dans cette temporalité les mouvements que l’on pourrait qualifier de contestataires comme celui des Mères de la place de Mai ?
Les mouvements tels que celui des Madres de Plaza de Mayo (Mères de la place de Mai) ou des Abuelas de Plaza de Mayo (Grands-mères de la place de Mai)3, comme d’autres organisations de promotion des droits humains, se situent en réalité hors du réseau associatif argentin. Mes collègues qui ont étudié ces organisations parlent de mouvements sociaux, et non de réseaux associatifs. Pourquoi ? Du fait des profonds liens de ceux-ci avec le catholicisme, et donc le système politique en place.
De nombreuses associations avaient et ont encore leurs bureaux dans des couvents catholiques. Des organisations comme le Centre d’études légales et sociales (CELS) sont rattachées à toute une militance catholique. Le fondateur du CELS était un ancien ministre de notre dictature militaire et il était par ailleurs cadre de l’action catholique. J’ai conscience d’avoir un propos polémique, c’est l’un de mes sujets de recherche les plus sulfureux.
Pendant longtemps, seules les organisations liées au catholicisme social constituent le secteur associatif argentin ?
Il est anachronique de parler d’un monde associatif à l’époque. Le terme « secteur associatif » n’apparait que dans les années 1990 en Argentine. Il se développe en parallèle de l’apparition du mouvement écologique, porté principalement pas des organisations conservationnistes. Ces organisations écologistes se structurent en réseau au début des années 1990 grâce au financement international, et notamment aux dons privés.
À ce moment, la législation évolue et les dons aux organisations non gouvernementales deviennent éligibles à une déduction des impôts, ce qui remodèle en profondeur le secteur associatif.
J’ai étudié précisément dans les années 2000 la structuration du réseau associatif en Argentine. D’après mes résultats, en 2005, entre la moitié et les trois quarts des organisations étaient fondées directement par l’Église catholique ou par des activistes catholiques. Aujourd’hui, la situation est complètement différente.
Comment expliquez-vous cette porosité jusqu’aux années 2000 entre mondes catholique et associatif ?
Je crois que ce phénomène est vraiment lié à la défaite du nationalisme catholique, et ce depuis la guerre de Malouines4. Le nationalisme catholique est intimement lié au destin des cadres militaires, que ce soit au moment de la guérilla ou du péronisme5.
Après la guerre des Malouines, ce monde catholique tombe malade de désenchantement. Une manière de sortir de ce désenchantement est de chercher des utopies, et cela en dehors des partis politiques. Être catholique se traduit alors par une volonté de transformation du monde, mais au-delà de la politique, au-delà même de la religion dans son expression institutionnelle.
En 2002, vous publiez un article sur les liens entre catholicisme et résistance au néolibéralisme dans les 19906.
Oui, pour étudier ce sujet, j’ai adopté une approche qualitative et ethnographique. Pour de nombreux dirigeants du réseau catholique, la division entre société civile, politique et catholicisme n’est ni claire ni même nécessaire. Au contraire, cette distinction est totalement artificielle à leurs yeux.
Pour eux, associativisme politique et religieux sont deux faces d’une même pièce qu’ils recherchent : le salut. Le profil des dirigeants, et même celui des activistes, a cependant beaucoup évolué à la sortie de la crise de l’année 2000 en Argentine. Tout comme la crise économique de la fin des années 1980 a renforcé la place des associations comme lieu politique privilégié.
Nous, Argentins, connaissons une crise économique tous les 20 ans. Je ne suis pas économiste, je ne me lancerai pas sur ce sujet. Ce que je peux vous dire c’est qu’à la sortie des années 2000, une partie des militants est désenchantée par la politique judicialiste portée par le kirchnérisme7.
En 2015, l’opposition politique, une coalition de partis argentins de centre droit et de droite nommée Propuesta Republicana, remporte des élections face au candidat péroniste Daniel Scioli. Ce n’est pas la majorité, mais une partie des dirigeants, des cadres et des activistes de cette force politique qui va porter Mauricia Macri au pouvoir, est issue du monde associatif.
Est-ce un mouvement dans les deux sens : des associatifs qui s’engagent en politique et des politiciens qui investissent le secteur associatif ?
Oui et ce phénomène est lié à l’instabilité institutionnelle de l’Argentine pendant tout le XXe siècle. Seuls deux ou trois partis politiques fonctionnaient alors comme des partis. La majorité des forces politiques n’avaient pas de fonctionnement bureaucratique et donc pas de possibilité de former leurs futurs cadres.
Au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, les cadres politiques sont donc formés au sein d’un réseau associatif profondément marqué par le catholicisme. Aujourd’hui, la situation est complètement différente et il est difficile de savoir si le réseau associatif a définitivement perdu ce rôle de formation politique.
Le divorce est-il consumé entre mondes associatif, politique et catholique ?
Moins que l’on ne pourrait le penser. Aujourd’hui, je travaille sur une cartographie des réseaux associatifs liés à l’économie des soins de Buenos Aires8. Avec des collègues de l’université de Buenos Aires, nous avons réalisé une enquête statistique sur les caractéristiques socioculturelles des associations de promotion des droits humains9. 35 % d’entre elles étaient liées à l’Église catholique et 45 % au monde catholique en général.
Le poids du monde catholique sur les réseaux associatifs a changé, mais reste important. Aujourd’hui, les réseaux associatifs s’inscrivent dans une démarche plus laïque et plus vaste, du moins en façade. Nous avons besoin de plus d’enquêtes ethnographiques à ce sujet pour étudier l’ampleur de cette bascule et ses conséquences.
L’Argentine connaît-elle l’avènement d’un secteur associatif laïque ?
Oui, il existe aujourd’hui des associations de professeurs socialistes qui font des distributions alimentaires pour les enfants, des collectifs de mères qui soignent les plus jeunes ou des organisations de personnes à la retraite qui organisent des activités.
Au premier abord, ces organisations sont apartisanes et areligieuses. Pour autant, chacune de ces organisations a des liens avec des partis politiques, qui peuvent les financer par exemple. De telles relations ne peuvent s’observer que sur le terrain, association par association. C’est une relation plus organique qu’institutionnalisée, un modèle à l’allemande.
Au niveau national, le secteur associatif argentin est-il structuré ?
Non, ce n’est pas le cas, et c’est un important problème. Jusqu’à la fin de la présidence d’Alberto Fernandes en 2023, la fonction d’enregistrement des organisations revenait au ministère du Développement social. C’est l’un des premiers que le président actuel, Javier Milei, a visé dans son effort de destruction de l’État. Les mots sont forts, mais ce sont les siens : « détruire l’État »10.
Pour cela, le président fraîchement élu a réduit les moyens du ministère du Développement social et l’a fusionné avec les anciens ministères du Travail et de l’Éducation. Nous avons donc à présent un unique ministère du Capital humain. Cette baisse importante de moyens a des conséquences concrètes : le bureau en charge d’enregistrer les créations et fermetures d’associations a par exemple cessé de fonctionner.
Savez-vous néanmoins combien d’associations compte l’Argentine ?
Avant que le bureau d’enregistrement des associations ne parte à la dérive, j’avais mesuré la composition du monde associatif selon ces registres. En 20 ans, le nombre d’associations avait été multiplié par 5.
Aujourd’hui, il n’existe plus d’information vraiment fiable à ce sujet. Les rares études à ce sujet sont parcellaires. L’Université de Buenos Aires avait par exemple collaboré avec feu le ministère du Développement social pour mieux évaluer la quantité d’organisations de soins existantes et qui s’y engagent. Nous souhaitions compléter la cartographie mentionnée précédemment d’études qualitatives. Malheureusement ce projet de recherche a été abandonné faute de financements.
Aujourd’hui, en Argentine, sait-on combien de personnes s’engagent ?
Il n’existe pas de statistiques fiables à ce sujet, toutes doivent être prises avec des pincettes. La dernière liste d’organisations enregistrées dans l’ancien bureau du ministère du Développement social contenait une approximation très faible : entre 40 000 et 100 000 activistes sur une population de 45 millions d’habitants.
Quel futur voyez-vous pour la société civile en Argentine avec le contexte politique que vous avez décrit ?
Il est difficile pour moi de parler du futur, étant avant tout un scientifique. Je peux néanmoins vous dire que les défis sont nombreux. Le plus grand d’entre eux est la reconstruction de la société alors que les cinq prochaines années vont être terribles.
En plus de mon travail de recherche, je milite depuis de nombreuses années pour l’environnement. J’ai même travaillé pour une organisation écologiste au début des années 1990. C’est après avoir quitté cette organisation, que je suis revenu au monde universitaire. En 2005, j’ai à nouveau rejoint le mouvement écologiste, mais cette fois en tant que sociologue. J’ai alors collaboré avec l’association internationale Green Drinks qui promeut les entreprises B-Corp11.
Avec ces lunettes de militant écologiste, je vois un avenir un peu moins sombre, grâce à la progression de la conscience écologique. Je me désole néanmoins du nihilisme de la jeunesse argentine. Son modèle de réussite se résume à la cryptomonnaie. Qui rêve encore d’être chercheur ou de protéger l’environnement ?
- 1De 1966 à 1983, deux dictatures militaires distinctes se succèdent. La première dure de 1966 à 1973, il s’agit de la dictature de la Révolution argentine. La dictature militaire argentine connue sous le nom de « Processus de réorganisation nationale » est en place jusqu’en 1983.
- 2La dictature militaire prend officiellement fin le 10 décembre 1983 avec l’élection démocratique de Raúl Ricardo Alfonsín.
- 3Les Mères comme les Grands-mères de la place de Mai sont deux associations de résistance non violente qui cherchaient à retrouver et rendre à leurs familles légitimes tous les enfants et bébés volés lors de la dictature militaire (1976-1983). Elles se réunissaient tous les jeudis à partir du 30 avril 1977 sur la place de Mai à Buenos Aires, située en face du siège du gouvernement.
- 4La guerre des Malouines a opposé l’Argentine au Royaume-Uni dans les îles Malouines et les îles Sandwich du Sud du 2 avril au 14 juin 1982. La défaite argentine en juin 1982 précipite la chute de la junte militaire qui gouvernait jusqu’alors le pays, remplacée par un gouvernement démocratiquement élu.
- 5Le péronisme, aussi appelé le justicialisme est un mouvement de masse argentin fondé au milieu des années 1940 autour de la figure de Juan Perón et composé de divers courants. Entre 1946 et 2023, le justicialisme a remporté dix élections présidentielles en Argentine.
- 6Luis Donatello, « El catolicismo y la resistencia al neoliberalismo en la Argentina de la década de los 90¨: ¿nuevos sujetos colectivos? » Fragmentación social y crisis política e institucional en América Latina y el Caribe, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), 2002.
- 7Mouvement politique argentin de centre gauche, le kirchnérisme, du nom des époux Kirchner, s’inscrit dans le mouvement plus large du péronisme.
- 8Verónica Giménez Beliveau, Florencia Calvo, Luis Miguel Donatello et Carla Zibecchi, Representaciones, tejido asociativo y redes de política pública: factor religioso y políticas de cuidado, 23 mars 2023.
- 9Carla Zibecchi et Luis Miguel Donatello, « Aspectos socio-religiosos del cuidado comunitario », Políticas Sociales, 2020.
- 10Élu président de l’Argentine en novembre 2023, l’économiste libertarien Javier Milei a fait campagne sur un « programme à la tronçonneuse » : en finir avec les travaux publics et privatiser toutes les entreprises.
- 11Les entreprises labellisées B Corp évaluent et tentent d’améliorer leur performance sociale, sociétale et environnementale.