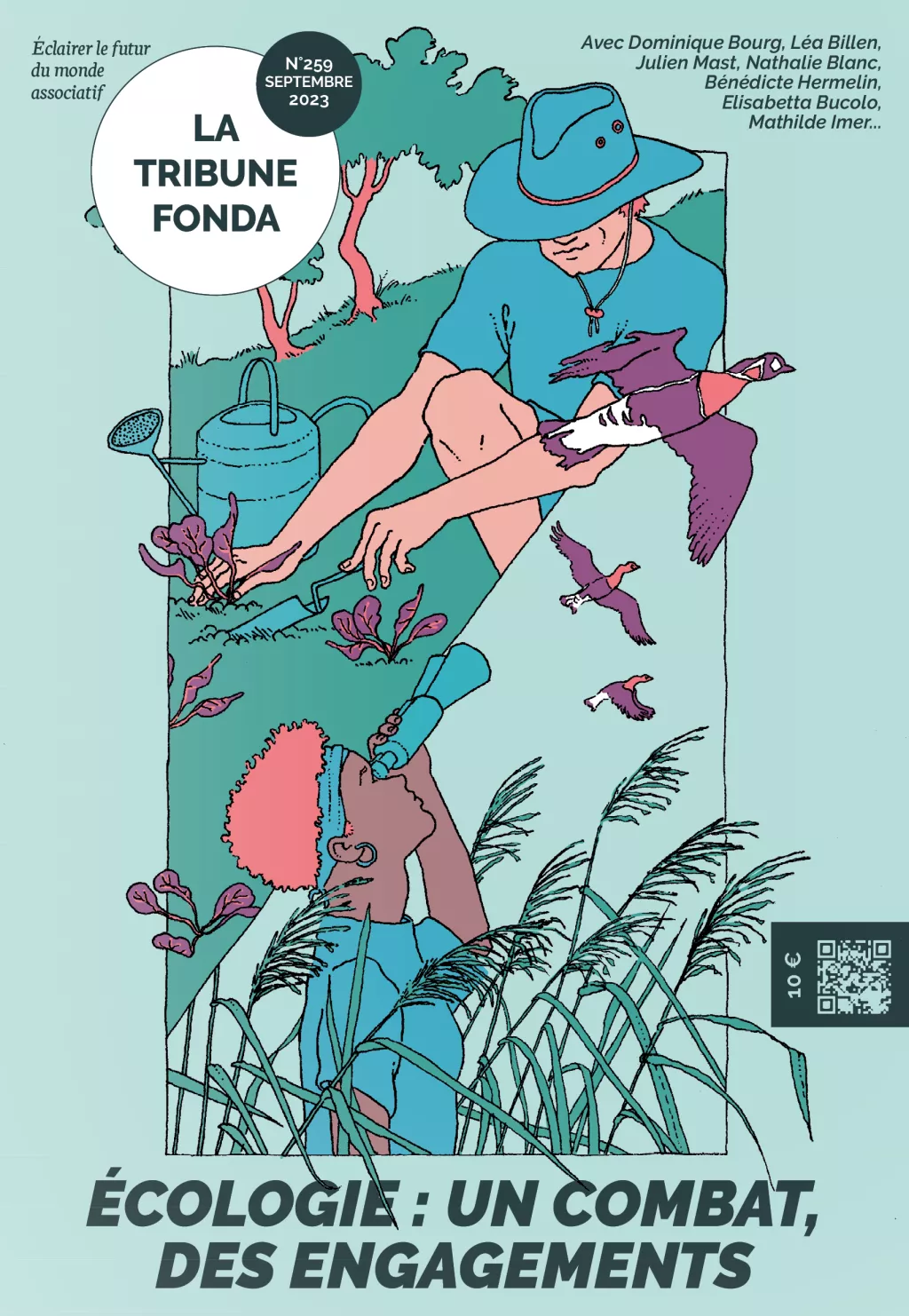Mathilde Imer répond aux questions d’Hannah Olivetti et Anna Maheu de la Fonda.
Quelles sont les formes d’engagement pour la cause écologique ?
Mathilde Imer : Il y en a plein ! Tout le monde connaît les écogestes, auxquels l’écologie est trop souvent résumée bien qu’ils soient insuffisants1. Après, il y a l’engagement associatif et celui au sein d’entreprises pour les faire changer de l’intérieur. Et puis, évidemment, l’engagement politique pour faire changer ou appliquer les lois de transition écologique, que ce soit au niveau local, régional, national ou international.
À ces formes d’engagement s’ajoutent différents modes d’action.
Je commencerai par l’action en ligne et la désobéissance civile non violente. Il y a aussi le travail sur les imaginaires : comment est-ce qu’on crée de nouveaux récits, de nouveaux codes culturels ? L’action juridique se développe quant à elle de plus en plus, que ce soit pour faire bouger des États ou des entreprises. Puis il y a évidemment ce que j’appellerai des mobilisations classiques comme les marches pour le climat ou le lobbying. Enfin, des personnes interviennent dans les médias pour sensibiliser les citoyens.
Est-ce qu’un de ces modes d’action vous semble plus puissant à court ou long terme ?
Ce que je trouve très compliqué en tant que militante écolo, c’est qu’en réalité nous les avons tous essayés sans grand succès. Nous avons lancé des marches, initié des pétitions, intenté des recours en justice et, sur le papier, nous avons tout « gagné ». Les quatre associations qui ont déposé un recours en justice contre l’État pour inaction climatique l’ont remporté2.
Les marches pour le climat ont rassemblé plusieurs centaines de milliers de Français dans la rue3. La pétition L’affaire du Siècle a été signée par plus de deux millions de citoyens et citoyennes. Et pour autant, rien de tout cela n’a permis d’avoir une action suffisamment rapide et radicale. D’où la question qui se pose aujourd’hui dans le mouvement écologiste de la désobéissance civile avec le sabotage.
Comment ces modes d’action ont-ils évolué au cours des années ?
Je milite depuis une dizaine d’années maintenant, et je vois plutôt une évolution dans les objectifs. Les mobilisations assez classiques de type « marche pour le climat » cherchaient à faire prendre conscience du diagnostic scientifique.
J’ai l’impression que nous avons globalement gagné cette première bataille du diagnostic, il faut passer à celle de l’action.
Les actions juridiques qui se multiplient cherchent plutôt à forcer l’État et les entreprises à s’adapter. D’autres acteurs vont essayer d’appliquer une pression financière pour stopper les projets climaticides, en encourageant les banques et les assurances à ne plus les assurer ni leur prêter de l’argent par exemple. Les actions de désobéissance civile vont plus loin en sabotant et en bloquant directement les projets.
Qui s’engage pour la cause écologique ?
Le milieu militant est blanc, assez diplômé et, cela m’a marquée au cours de ces dernières années, de plus en plus jeune. Ma conscience écolo et celle des militants de ma génération apparaissaient à 17 ou 18 ans pour les plus précoces. Aujourd’hui, des gamins de 13 ans vont participer à des actions de désobéissance civile, engagent leur responsabilité vis-à-vis de la justice et se retrouvent avec des casiers judiciaires.
Ce qui ne représente donc pas l’ensemble de la société française.
Oui, car la plupart de nos concitoyens n’ont pas le bon diagnostic sur le niveau d’urgence et l’ampleur des modifications de services qu’un monde à +4 degrés induit. Je l’ai observé à la première session de la Convention citoyenne pour le climat. Pour les 150 tirés au sort, comme pour la grande majorité des Français, le dérèglement climatique existe, il est d’origine humaine et il faut agir dessus. Néanmoins ils avaient cette sensation que c’était lointain et qu’avec des pistes cyclables et le tri des déchets, des modifications à la marge donc, nous allions pouvoir nous adapter.
Comment les 150 ont-ils réagi à la présentation de cette urgence climatique et ses multiples ramifications4?
À la fin de la première session, les membres de la Convention étaient sous le choc, ils s’étaient « pris une claque » de leurs propres aveux. Sauf que dans ce contexte, ils avaient un pouvoir d’action, ils étaient là pour proposer des politiques publiques. Or, la majorité des Français n’a pas ce pouvoir d’action et le sentiment d’impuissance est bloquant. Tout est renforcé quand les politiques ne proposent pas de cap, qu’il n’y a pas de planification écologique.
Il est très difficile pour les individus, comme pour les entreprises d’ailleurs, d’accepter des changements profonds quand le cap n’est pas donné en termes de politiques publiques.
Le manque de volonté politique serait donc l’un des principaux freins à l’engagement pour la cause écologique ?
Oui, on ne peut s’engager si on ne sait pas ce que ça peut nous apporter en bien. L’écologie est aujourd’hui encore vue comme un mouvement punitif. Pourtant, la société que nous souhaitons créer sera bien plus joyeuse, avec plus de lien, plus de temps et plus d’humain. Ce qui est tout de même plus désirable que notre société actuelle atomisée.
Faites-vous référence aux réflexions autour de la convivialité dans les années 19705 ?
Oui, nos aînés militants avaient déjà posé un diagnostic assez clair et proposé beaucoup de choses. Ils avaient notamment déjà identifié un ressort très puissant de l’engagement : les émotions. Beaucoup de personnes qui s’engagent, moi y compris, le font pour transformer leur peur, leur sentiment d’impuissance et leur colère en quelque chose de positif.
Transformer son écoanxiété en action, c’est le seul moyen pour éviter qu’elle nous autodétruise : « au moins, j’agis. » Ou comme le dit la militante Corinne Morel-Darleux, nous pouvons choisir une dignité du présent qui nous permet d’être fier de qui nous sommes et de la manière dont nous avons lutté contre la catastrophe6.
- 1Alexia Soyeux et César Dugast (Carbone 4), Faire sa part, juin 2019.
- 2En décembre 2018, Notre Affaire à Tous, la Fondation pour la Nature et l’Homme (FNH), Greenpeace France et Oxfam France ont assigné l’État français en justice pour inaction face aux changements climatiques. Lire à ce sujet Charlotte Debray, « Rendre l’inaction climatique illégale : l’Affaire du Siècle », Tribune Fonda n° 250, juin 2021.
- 3Rémi Barroux et Audrey Garric, « « Et un, et deux, et trois degrés » : une vague verte déferle en France pour le climat et la justice sociale », Le Monde, 16 mars 2019.
- 4La première session de la Convention citoyenne pour le climat qui s’est tenue début octobre 2019 était entre autres consacrée à décoder le changement climatique et ses conséquences. Une quinzaine d’experts étaient intervenus pour exposer aux 150 membres l’état actuel du climat, dont la paléoclimatologue Valérie Masson Delmotte.
- 5Le prêtre et philosophe Ivan Illich a notamment publié La Convivialité au Seuil en 1973.
- 6Corinne Morel Darleux, Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, Éditions Libertalia, 2019.