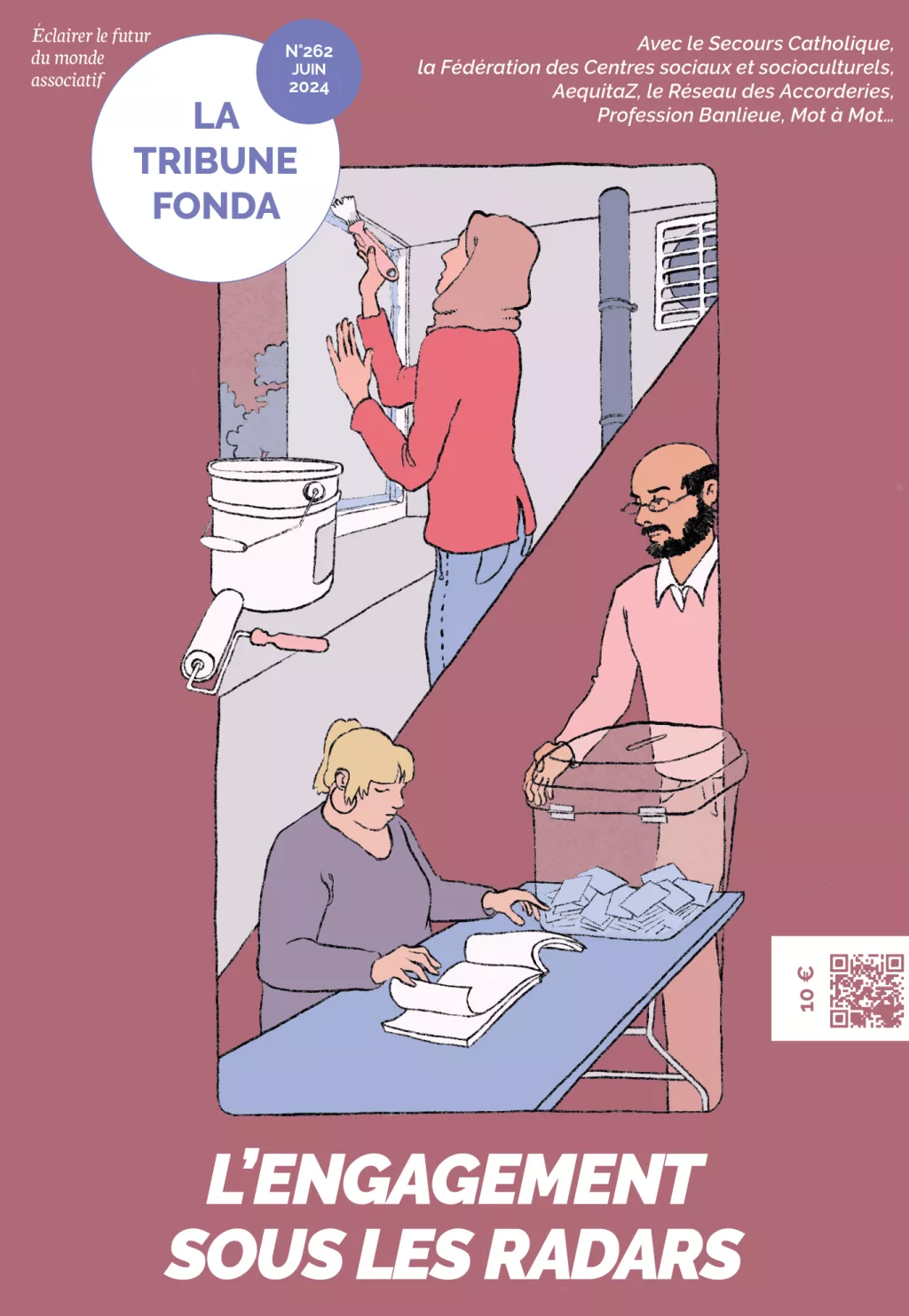Propos recueillis par Anna Maheu.
Aujourd’hui, qui est bénévole au Canada ?
Il n’y a pas de profil-type, mais nous avons une idée générale de qui est bénévole, pourquoi et comment.
Nous savons également que, dans l’ensemble, les heures moyennes de bénévolat diminuent et ce, depuis un certain temps1. Les GenZ2 et les Millenials3 donnent environ moitié moins d’heures que les Boomers4, ce qui représente un défi pour les structures reposant sur le bénévolat5.
Moins de personnes donnent de leur temps, ce qui signifie qu’un petit groupe de personnes doit donner beaucoup plus d’heures pour compenser.
Soyons néanmoins prudents, ces tendances varient d’une région à l’autre. Le Canada est un grand pays, et certaines provinces, notamment le Québec, ont des dynamiques spécifiques.
Quelles sont les principales causes qui mobilisent les bénévoles ?
Cela dépend des générations et des âges de la vie. Par exemple, vous ne serez pas bénévole de la même manière si vos enfants font du sport.
Depuis le début des années 2000, nous savons par ailleurs que les femmes âgées consacrent un nombre impressionnant d’heures à s’occuper des personnes plus âgées, avec des visites dans des maisons de retraite, ou d’autres plus informelles auprès de leurs connaissances les plus isolées6. En vieillissant, elles cessent de s’engager ainsi et nous ne savons pas très bien qui va les remplacer.
Le bénévolat est également très répandu parmi les membres de la génération Z, plus encore que dans la cohorte qui les précède, les Millenials. Les jeunes adultes ont davantage tendance à être des activistes. Ils n’ont pas peur de s’exprimer pour des causes qui leur tiennent à coeur, en rejoignant des mouvements sociaux et des organisations de terrain.
Les Français de la génération Z n’hésitent pas non plus à s’engager politiquement, mais ils le font dans des structures informelles plutôt que dans des associations. Avez-vous constaté une évolution similaire du bénévolat formel vers le bénévolat informel au Canada ?
Nous ne pouvons pas en être sûrs, car nous ne disposons pas de données fiables sur le bénévolat informel à ce jour. Les enquêtes gouvernementales recensent principalement le bénévolat formel par le biais des associations caritatives.
Même au sein de ces organisations, le bénévolat semble être de plus en plus informel. Les citoyens ne sont plus disposés à s’engager sur de longues périodes. Ils refusent d’être membres d’un conseil d’administration ou de consacrer un week-end entier à une cause. C’est particulièrement vrai pour les baby-boomers.
Le bénévolat semble être de plus en plus informel.
Nous n’en savons pas assez sur le bénévolat informel, mais nous avons un angle mort particulier sur les organisations communautaires de terrain. Nous savons que les communautés noires, indigènes et de couleur (BIPOC) donnent et s’engagent à des taux au moins égaux à ceux de la population générale7.
Mais ces contributions empruntent probablement un chemin autre que celui des organisations formelles, comme de l’entraide ou des dons au sein de sa famille élargie et de sa communauté.
À l’été 2020, le gouvernement Trudeau a attribué à la WE Charity Foundation le contrat relatif à la Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant (CSSG), qui aurait versé à des étudiants canadiens jusqu’à 5 000 dollars pour leur « bénévolat ». Le bénévolat obligatoire ou rémunéré est-il courant au Canada ?
Nous connaissons depuis longtemps différentes formes de bénévolat obligatoire. Dans de nombreuses provinces, les élèves doivent effectuer 40 heures de travaux d’intérêt général pour obtenir leur diplôme d’études secondaires, l’équivalent de votre baccalauréat.
Cette obligation est basée sur la croyance qu’initier les élèves au bénévolat dès leur plus jeune âge leur met le pied à l’étrier pour s’engager tout au long de leur vie. Néanmoins, cette croyance n’est que partiellement prouvée. Les jeunes qui étaient déjà enclins à faire du bénévolat trouvent l’expérience positive et la prolongent souvent au-delà du lycée. Ceux qui le font simplement pour obtenir leur diplôme ne sont par contre pas enclins à s’engager au cours des années suivantes1.
Certaines formes de bénévolat obligatoire existent donc déjà au Canada, notamment pour l’obtention d’un diplôme d’études secondaires, pour bénéficier de certains dispositifs d’assistance sociale, pour apprendre lors de projets communautaires ou pour purger une peine de justice alternative.
L’idée d’une bourse pour le bénévolat étudiant était donc prévisible ? C’était une surprise, et plutôt une mauvaise idée. Revenons en arrière : pendant la pandémie, le gouvernement fédéral savait que les étudiants allaient être durement touchés. Ils n’auraient pas de boulots d’été et auraient donc du mal à payer leurs frais de scolarité. De plus, ils n’avaient pas droit aux aides débloquées pour les entreprises et, par ricochet, leurs employés.
Dans le même temps, les organismes sans but lucratif et les associations caritatives étaient frappés de plein fouet par la pandémie et ses conséquences. À l’époque, nous avions évalué qu’une association sur cinq pourrait fermer ses portes à cause de la pandémie8.
Le gouvernement Trudeau a donc eu l’idée d’aider à la fois les organisations à but non lucratif et les étudiants en proposant de rémunérer ces derniers pour qu’ils fassent du « bénévolat » pendant l’été.
Volunteer Canada s’est opposé à cette idée dès le départ. Non seulement il ne s’agit pas de bénévolat, mais le gouvernement avait prévu de le faire à une ampleur déraisonnable, encouragé par le succès de WE Charity. Imaginez : de la mi-mai à septembre, 100 000 étudiants seraient placés dans des organisations à but non lucratif, alors que celles-ci fonctionnaient à distance ou avaient réduit leurs activités en prévision de l’été.
Finalement, le programme a été annulé le 25 juin 2020 sans qu’aucun bénévole n’ait été placé. Cet incident montre à quel point le gouvernement comprend mal le secteur associatif et ses besoins9.
Que savons-nous des structures au sein desquelles les Canadiens s’engagent ?
La plupart de mes compatriotes font du bénévolat dans des organisations caritatives. Attention, les organismes de bienfaisance et les organismes sans but lucratif sont deux catégories distinctes de ce côté-ci de l’Atlantique.
Les associations caritatives sont les quelque 86 000 organisations à but caritatif déclarées. Elles sont enregistrées par la Direction des organismes de bienfaisance de l’Agence du revenu du Canada (ARC). Un grand nombre d’entre elles sont confessionnelles, mais elles agissent sur des sujets extrêmement variés. Les organismes de bienfaisance enregistrés comprennent des fondations hospitalières, des universités et des collèges. Ces organisations faussent d’ailleurs totalement les chiffres en matière d’actifs et d’employés.
Nous connaissons moins les organismes sans but lucratif (OSBL), principalement parce qu’ils ne sont soumis qu’à des exigences minimales en matière de déclaration. En termes juridiques canadiens, les OSBL sont donc toutes les structures à but non lucratif qui ne sont pas caritatives. Il s’agit de petits groupes d’entraide et de clubs de lecture, comme d’associations professionnelles telles que l’Association médicale canadienne (AMC).
Comment les ressources sont elles réparties au sein du secteur ?
C’est une erreur commune de l’appréhender à l’échelle du secteur. Pour comprendre les ressources que se partagent les organismes caritatifs canadiens, il faut exclure les hôpitaux et les autres organismes quasi gouvernementaux.
Même sans eux, il y a encore un grand écart : près de la moitié des organismes de bienfaisance ont déclaré ne pas avoir de salariés en 2017 et un peu plus d’un tiers ont déclaré avoir moins de 10 employés10.
Il y a ensuite un petit groupe d’organismes caritatifs dotés d’un personnel et d’un budget importants. Ces organismes ont tendance à être davantage des groupes de soins de santé, à recueillir des fonds auprès d’autres organismes comme United Way Canada, ou des fédérations telles que les Young Men’s Christian Associations (YMCA).
Cet écart important n’a fait que s’accentuer à la suite de la crise liée au COVID-19. Près de 70 % des organismes de bienfaisance canadiens ont connu une réduction de leurs revenus au cours des années marquées par le COVID-19, soit une baisse moyenne d’environ 30 %11.
La moitié des associations caritatives n’avait pas de salariés en 2017.
Et ce sont les petites organisations qui ont été le plus durement touchées, à commencer par leur porte-monnaie. Quatre ans plus tard, elles tentent toujours de s’en remettre.
Tout comme le bénévolat, le don est en déclin et se concentre entre quelques mains. Le taux et la participation des donateurs, ainsi que le montant et la fréquence de leurs dons, sont en baisse.
Toutefois, le montant global de la philanthropie est resté le même grâce aux dons importants effectués pour les soins de santé et la protection de l’environnement. Ces dons importants vont des grands donateurs aux grandes organisations caritatives.
À l’opposé, les petites organisations tentent de survivre plus que jamais. Elles se battent pour trouver des bénévoles, des dons, voire des revenus, qu’il s’agisse de recettes d’activités ou de commandes publiques.
Avec environ un organisme caritatif sur cinq qui constate une augmentation de la demande de services en 2023 et 2024, le secteur est confronté à un double défi : allouer ses ressources déjà tendues pour répondre à des besoins croissants. En effet, la demande a énormément augmenté au cours des deux dernières années, en particulier dans les domaines de la sécurité alimentaire et de la santé mentale.
Que savons-nous des employés du secteur non lucratif canadien ?
L’ensemble du secteur représente un emploi à temps plein sur dix12, grâce aux organisations quasi gouvernementales dont je parlais précédemment.
Les Millenials représentent désormais 50 % des effectifs du secteur, et près de 30 % d’entre eux occupent déjà des postes de direction13. L’emploi associatif est très diplômé et ses employés sont en général plus susceptibles d’avoir un diplôme universitaire que dans le secteur privé.
75 % des salariés du secteur associatif sont des femmes, en particulier dans les secteurs des soins à domicile et du grand âge14. Ces postes sont souvent occupés par de nouvelles arrivantes, qui y trouvent un point d’entrée sur le marché du travail.
À Toronto, 48 % des femmes travaillant dans le secteur à but non lucratif sont d’origine étrangère15. Que le travail des soins à domicile soit précaire et souspayé n’est pas propre au Canada.
Nous assistons par contre à une véritable remise en cause du secteur, qui tente aujourd’hui d’offrir de meilleures conditions de travail, avec entre autres des régimes de retraite, des avantages réels et des contrats moins précaires.
Au début des années 1800, le philosophe et diplomate Alexis de Tocqueville a fait deux rapports très différents lors de ses visites successives aux États-Unis et au Canada. Les États-Unis étaient une nation d’adhérents, de « joiners », où la société civile garantissait la démocratie16. Le Canada était décrit par la force de l’État par rapport aux associations. Pensez-vous que ce parallèle soit encore pertinent aujourd’hui ?
Tout d’abord, Tocqueville ne s’est rendu qu’au Bas-Canada, ce qui est aujourd’hui le Québec. Il n’y a pas passé beaucoup de temps, probablement une semaine environ, et il a rapporté qu’il avait vu un État fort, mais pas d’associations.
Quoi qu’il en soit, le Canada, comme les États-Unis, a évolué vers un État-providence libéral. Cela ne date pas d’hier.
Nous devrions examiner la situation à rebours : le récit de Tocqueville a donné aux États-Unis l’image d’une nation d’adhérents. Ce mythe fondateur n’a jamais existé au Canada. L’une des nombreuses conséquences est que le secteur associatif est beaucoup moins étudié qu’aux États-Unis, y compris en tant que domaine de recherche.

leur communauté typique de Calgary (stampede breakfast) en juillet 2019. © Repsol
Vous étudiez le secteur associatif canadien depuis plus de vingt ans. Quelles sont les principales évolutions que vous avez constatées ?
Le vieillissement des effectifs est le moteur des principales évolutions. Nous sommes aujourd’hui confrontés à un passage de relais dans le secteur.
De nombreux dirigeants bénévoles, membres de conseils d’administration et directeurs exécutifs sont restés en poste bien qu’ils avaient atteint l’âge de la retraite. Ils sont aujourd’hui nombreux à partir17.
Une véritable relève générationnelle devrait avoir lieu, mais le secteur n’a pas développé son vivier de talents au fil des ans.
Une véritable relève générationnelle devrait avoir lieu, mais le secteur n’a pas développé son vivier de talents au fil des ans. En outre, les successions ne sont pas bien pensées au sein des organisations. Il y a donc aujourd’hui un énorme roulement dans les organisations et de nombreux postes ne sont pas pourvus.
Ne soyons pas pessimistes : c’est une période passionnante. Je suis entourée de personnes qui veulent changer les choses et pour qui le secteur associatif est le véhicule idéal.
Je suis certaine que les diplômés de notre programme de maîtrise à l’Université Carleton apporteront de réels changements dans le secteur.
Enfin, le secteur essaie encore de comprendre la transition numérique et ses implications sur la façon dont nous fournissons des services, nous mobilisons nos bénévoles et nos donateurs, etc. Il s’agit d’un point de transition où toutes ces grandes forces se rencontrent : augmentation de la demande, évolution démographique, transition technologique et nouvelles formes de bénévolat.
Que pourrait-on faire pour faciliter la transition ?
Nous devons mieux former l’ensemble du secteur. C’est aussi simple que de pouvoir être un employeur de choix, en proposant des salaires décents et en investissant dans les infrastructures.
Pour ce faire, il faut que les donateurs acceptent l’idée des frais généraux. Donner pour des frais généraux, c’est investir dans le personnel, des technologies, de la formation.
Nous commençons à voir un certain changement parmi les fondations qui acceptent lentement d’investir dans les infrastructures, ce à quoi elles étaient historiquement réticentes. Les choses commencent à changer, mais pas assez rapidement.
- 1a1bAllison Russell (University of Pennsylvania), Paula Speevak (Volunteer Canada), and Femida Handy (University of Pennsylvania), « Chapter 20 - Volunteering: Global Trends in a Canadian Context », In Susan D. Phillips and Bob Wyatt (Eds.), Intersections and Innovations, 2021.
- 2La génération Z (GenZ) désigne le groupe de personnes nées entre la fin des années 1990 et le début des années 2010.
- 3Les « Millenials » sont un groupe de personnes nées entre 1981 et 1996.
- 4Un baby-boomer, ou boomer, est une personne née entre 1945 et 1965, après la Seconde Guerre mondiale.
- 5Susan D. Phillips, « Five Trends in 2023 », Philanthropy and nonprofit leadership (PANL) Perspectives, January 30, 2023.
- 6Susan D. Phillips, Laura Goodine and Brian Little (Carleton University), « Caregiving volunteers : a coming crisis », Volunteer Canada, 2002.
- 7Krishan Mehta (Seneca College and University of Toronto) and Patrick Johnson (Borealis Advisors), « Diaspora philanthropy and civic engagement in Canada: Setting the stage », The Philanthropist, n°24.
- 8Mary Giles, « Changing Times for Charities in Canada - Susan Phillips, Philanthropy and Nonprofit Leadership », Another Take, Faculty of Public Affairs – Carleton University, 23 juin 2021, [en ligne].
- 9Susan D. Phillips (Carleton University) « WE scandal an opportunity to update policy for charities », The Toronto Star, 1er septembre 2020.
- 10David Lasby and Cathy Barr (Imagine Canada), « Chapter 2 - State of the Sector and Public Opinion about the Sector », In Susan D. Phillips and Bob Wyatt (Eds.), Intersections and Innovations, 2021.
- 11Mary Giles, Ibid.
- 12CanadaHelps, The giving report, 2018.
- 13Jim Link (Randstad North America), « Engaging the workforce of the future: The emergence of Generation Z », Human Resources Professionals Association (HRPA) 2018 Conference, 2018.
- 14Susan D. Phillips (Carleton University) and Bob Wyatt (Muttart Foundation), « Chapter 1- Intersections and Innovations: Change in Canada’s Voluntary and Nonprofit Sector », Intersections and Innovations, 2021.
- 15Tom Zizys (Ontario Nonprofit network), Not working for profit: a labor market description of the non-profit sector in Toronto, 2011, [en ligne].
- 16Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, 1838.
- 17Susan D. Phillips (Carleton University) and Bob Wyatt (Muttart Foundation), Ibid.